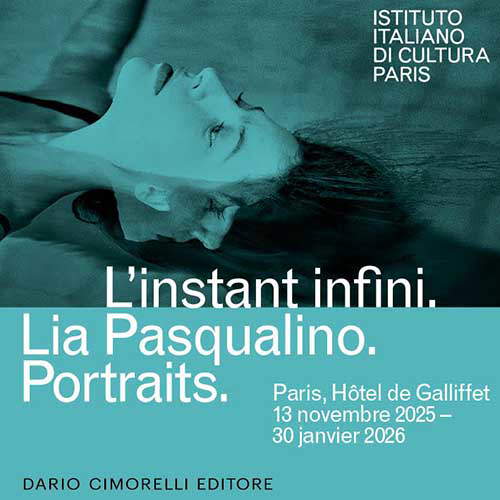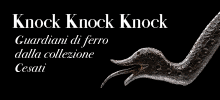Ferrara juive, 10 lieux à connaître
Un voyage à travers dix lieux emblématiques de Ferrare pour découvrir l'histoire millénaire de sa communauté juive, ses traditions, ses événements dramatiques et sa contribution à la culture de la ville.
Par Redazione | 07/08/2025 16:17
Ferrare est la gardienne d'une histoire juive extraordinairement riche et complexe, dont les racines remontent au XIIIe siècle et qui continue à laisser une marque indélébile sur le tissu urbain et culturel de la ville. La présence juive à Ferrare est attestée de manière continue depuis le Moyen Âge, et sa communauté juive est toujours l'une des plus anciennes et des plus influentes d'Italie. L'âge d'or se situe sous le duché des Este, lorsque la cour des Este, et en particulier les ducs Ercole I et Ercole II, se sont distingués par une politique d'hospitalité magnanime, offrant un refuge à de nombreux intellectuels juifs, notamment ceux qui fuyaient l'Espagne en 1492. Cette période se caractérise par un dialogue culturel fructueux entre les Juifs et la culture chrétienne majoritaire.
Cependant, l'histoire n'a pas toujours été marquée par la tolérance. Avec la cession de Ferrare aux États pontificaux en 1597, la situation change radicalement. Après la publication de plusieurs édits, la construction du ghetto juif a commencé en 1624 et a été imposée quelques années plus tard aux quelque 1 500 Juifs vivant dans la ville. De 1627 jusqu'à l'unification de l'Italie, la communauté juive est isolée et contrainte à une réclusion totale du crépuscule à l'aube, avec des périodes de tolérance intermittentes. Le retour tragique du ghetto s'est produit avec les lois raciales de 1938, qui ont déclenché de terribles persécutions, culminant avec la destruction des biens et la déportation de près de 200 Juifs entre 1941 et 1945.
Malgré les difficultés et les tragédies, la communauté juive de Ferrare a continué à être active et à contribuer à l'histoire et à la culture de la ville. Son patrimoine est aujourd'hui retracé et mis en valeur à travers un parcours qui comprend des sites historiques, religieux et mémoriels. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans cette histoire fascinante d'identité, de mémoire et d'intégration, un podcast produit par la municipalité de Ferrare, avec la contribution de Destinazione Turistica Romagna et la collaboration de la communauté juive de Ferrare, de l'Institut d'histoire contemporaine et du MEIS, offre un regard intime et approfondi. Voici les 10 lieux à visiter pour connaître l'histoire de la ville juive de Ferrare.
1. Le ghetto juif
Le quartier médiéval de Ferrare conserve les souvenirs de l'ancien ghetto juif, où la communauté a été isolée de 1627 jusqu'à l'unification de l'Italie. La rue principale de ce quartier historique est la Via Mazzini, qui abritait autrefois les boutiques et les activités sociales juives, et qui a conservé sa structure d'origine. À l'entrée de la Via Mazzini, en direction de la Piazza della Cattedrale, se trouvait l'une des cinq portes qui fermaient le quartier, et une plaque entre deux arcs commémore l'établissement du ghetto.
Outre la Via Mazzini, la Via Vignatagliata, la Via Vittoria et la Piazzetta Isacco Lampronti constituaient également le cœur du quartier juif. En se promenant dans ces rues, on peut observer de vieux bâtiments en terre cuite, certains simples et d'autres ornés de portails richement décorés ou de balcons en fer forgé. Ce quartier comprenait également l'école juive, où Giorgio Bassani enseignait pendant la ségrégation raciale, l'ancien four à pain azyme, le jardin d'enfants et l'hospice. La création du ghetto a été imposée par l'État pontifical après qu'il eut repris le contrôle de la ville en 1597. Les lois raciales de 1938 ont remis le ghetto en service, marquant une période de terrible persécution pour la communauté. Parcourir ces rues, c'est explorer le dialogue culturel fructueux entre les Juifs et la culture majoritaire, mais c'est aussi toucher du doigt les souvenirs d'un passé difficile, qui se perpétue également dans les récits de Giorgio Bassani.

2. Le complexe de la synagogue
Le complexe de la synagogue est situé au numéro 95 de la Via Mazzini, au cœur de l'ancien ghetto. L'histoire de ce lieu sacré remonte à 1485, lorsque le banquier romain Ser Samuel Melli acheta une grande maison et en fit don à la communauté juive de Ferrare pour en faire le siège de ses institutions. À l'intérieur, le bâtiment abrite trois synagogues. Jusqu'en 2012, il abritait également le musée juif au deuxième étage du bâtiment. L'ancien temple allemand (ashkénaze), le plus grand, est toujours utilisé pour les cérémonies les plus solennelles. Doté de cinq fenêtres qui l'éclairent depuis une cour intérieure et de grands médaillons en stuc avec des illustrations allégoriques du Lévitique, il possède un aron (armoire sacrée) du XVIIe siècle en bois sombre. L'ancien temple italien est aujourd'hui une salle utilisée pour des conférences et des célébrations communautaires, avec trois précieux arons du XVIIIe siècle restaurés. L'oratoire Fanese, un petit temple du XIXe siècle, est utilisé pour les rites du sabbat. Sa porte provient de la synagogue de Cento et l'intérieur est décoré de stucs, avec une chaire proéminente du XIXe siècle. Les synagogues ont été pillées et dévastées pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier en 1941 et pendant l'occupation nazie en 1943-44, lorsque la Scola Italiana a même été utilisée comme camp de concentration. Le complexe est fermé pour restauration depuis 2012.

3. Le MEIS - Musée national du judaïsme italien et de la Shoah
Le MEIS - Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (Musée national du judaïsme italien et de la Shoah) est situé à Ferrare, Via Piangipane, 81. Sa mission principale est de raconter plus de deux mille ans d'histoire juive en Italie, des origines à nos jours. Le musée retrace les phases d'intégration et d'échange culturel, ainsi que les périodes difficiles marquées par la persécution et l'isolement, en mettant en lumière une expérience commune qui concerne tout le monde. Le MEIS est également un lieu de mémoire et de réflexion sur la Shoah, qui promeut le dialogue interculturel et la valeur de la diversité.
Le choix de Ferrare comme lieu d'accueil n'est pas fortuit : la ville concentre les diverses expériences de l'histoire millénaire des Juifs italiens, caractérisée par une relation inextricable avec la ville, culminant dans la politique d'accueil de la Maison d'Este, mais ensuite éclipsée par l'établissement du ghetto et la persécution nazie-fasciste. Le musée, qui a ouvert ses premières salles en 2011, présente des objets traditionnels et religieux, de nombreux livres et documents reconstituant l'histoire de la communauté de Ferrare. Après le tremblement de terre de 2012, une grande partie du matériel précédemment exposé dans le musée juif du complexe de la synagogue de Via Mazzini a été transféré au MEIS. L'exposition comprend de la documentation sur les différents aspects de la vie juive, de la naissance au mariage, en passant par les moments de culte religieux et communautaire.

4. L'ancienne école juive
Via Vignatagliata, au numéro 33, se trouve le bâtiment qui abritait l 'ancienne école juive de Ferrare. Ce lieu représente une pièce importante dans l'histoire de la communauté juive de Ferrare, car il offre un aperçu des caractéristiques de l'éducation juive, où tradition et modernité s'entremêlaient pour éduquer les nouvelles générations. Ce bâtiment médiéval, qui abritait à l'origine un jardin d'enfants et des écoles primaires, a joué un rôle crucial après la promulgation des lois raciales en 1938. À la suite de ces lois discriminatoires, l'école est devenue le seul endroit où tous les étudiants et enseignants juifs de Ferrare pouvaient poursuivre leurs études.
Parmi les enseignants de l'époque se trouvait un jeune diplômé, Giorgio Bassani, qui a enseigné pendant la ségrégation raciale. L'école offrait un équilibre entre les connaissances religieuses et laïques, combinant l'étude de la Torah et de l'hébreu avec des matières classiques. Cette institution était fondamentale pour la transmission des valeurs, de l'identité culturelle et de l'ouverture au monde. Son fonctionnement a été interrompu en 1943, avec l'arrestation des enseignants, dont Bassani, et la fermeture subséquente de l'institution. Un voyage dans ce lieu permet de comprendre l'originalité d'un système éducatif qui a su allier la préservation de l'identité culturelle et l'ouverture sur le monde.

5. La maison d'Isacco Lampronti
Au numéro 33 de la Via Vignatagliata se trouve également la maison d'Isacco Lampronti (Ferrare, 1679 - 1756), illustre rabbin et médecin du XVIIIe siècle, dont l'importance pour la communauté juive de Ferrare est attestée par deux plaques apposées dans la même rue. Lampronti est célèbre pour son œuvre monumentale, le Pachad Yitzchak, une encyclopédie halachique qui a profondément influencé des générations d'érudits. Sa contribution à la jurisprudence juive a été considérable, caractérisée par une rare combinaison de connaissances traditionnelles et d'approche scientifique. Isacco Lampronti n'était pas seulement une éminente personnalité religieuse et universitaire, mais aussi un éducateur engagé et un citoyen activement impliqué dans la vie civique de Ferrare. À une époque de profondes mutations, sa pensée visait à mêler harmonieusement foi, culture et science, représentant un exemple d'érudition et de modernité. Connaître la figure de Lampronti à travers sa maison et son héritage intellectuel offre une perspective unique sur la vie culturelle juive animée de Ferrare au XVIIIe siècle et sur l'importance de la transmission du savoir de génération en génération.

6. La colonne de Borso d'Este
La colonne de Borso d'Este, située sur la place de la cathédrale, recèle une histoire peu connue mais profondément significative qui lie le monument à la communauté juive locale. Cette colonne, érigée en l'honneur du duc Borso, a été construite avec des matériaux provenant des tombes d'un ancien cimetière juif. Cet événement, qui s'est produit sur ordre de l'Inquisition au XVIIIe siècle, soulève des questions complexes sur la relation entre le pouvoir, la mémoire et le respect des minorités. L'affaire est un exemple de la manière dont l'histoire officielle peut parfois chevaucher et effacer les traces d'autres cultures et d'autres mémoires.
Pourtant, Ferrare a choisi de ne pas oublier cet épisode, à tel point qu'une plaque symbolise la volonté de la ville de renouer avec la culture juive ferraraise. La colonne sur laquelle repose Borso d'Este, avec ses couches de pierres tombales juives provenant des anciens cimetières de la ville, est un rappel silencieux qui nous invite à réfléchir aux événements du passé et à la manière dont les différentes communautés ont coexisté dans la ville. C'est un lieu qui invite à un voyage à travers l'histoire, la mémoire et les controverses qui ont façonné le patrimoine culturel de Ferrare.

7. Le Muretto du Château Estense
Le Muretto del Castello Estense, dans le Corso Martiri della Libertà, est le lieu symbolique dumassacre du 15 novembre 1943, également connu sous le nom de Massacre du Château Estense, l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus brutaux de l'histoire de Ferrare pendant l'occupation nazie-fasciste. Cet événement tragique a vu l'assassinat sommaire de onze civils innocents, dont plusieurs juifs, en représailles à l'assassinat d'Igino Ghisellini, le Fédéral de Ferrare, deux jours plus tôt. Parmi les victimes se trouvait également Girolamo Savonuzzi, alors ingénieur en chef de la municipalité de Ferrare.
La nouvelle de la mort de Ghisellini, dont les circonstances sont encore controversées, déclenche une réaction immédiate d'Alessandro Pavolini au congrès du parti fasciste républicain à Vérone, qui ordonne des représailles à Ferrare. Des escouades fascistes arrivent dans la ville et, dans la soirée du 14 novembre, arrêtent 74 citoyens de Ferrare considérés comme des antifascistes ou des opposants au régime. À l'aube du 15 novembre, dix d'entre eux sont fusillés devant le muret du château d'Estense et sur les murs près des Rampari di San Giorgio. Un onzième civil, Cinzio Belletti, est assassiné dans la Via Boldini pour ne pas s'être arrêté à la halte. Les corps des victimes furent exposés en guise d'avertissement, avant d'être retirés grâce à l'intervention de l'archevêque Ruggero Bovelli. Cet épisode, considéré par certains historiens comme le premier massacre de la guerre civile en Italie, est raconté par Giorgio Bassani dans la nouvelle Una notte del '43 (Une nuit de 1943 ) et repris dans le film La lunga notte del '43 de Florestano Vancini. Quatre plaques sur le petit mur et sur les colonnes d'accès aux douves du château commémorent l'événement.

8. Le cimetière juif
Le cimetière juif de Via delle Vigne, au numéro 22, est un lieu chargé d'histoire, de mémoire et de profonde spiritualité pour la communauté juive de Ferrare. Il s'agit de l'un des plus anciens cimetières juifs d'Italie encore en activité, dont les premières pierres tombales suggèrent une origine remontant au XVIe siècle, bien que la zone n'ait été officiellement acquise qu'en 1626. Le cimetière est un symbole tangible de la présence juive dans la ville et accueille les sépultures de personnages illustres, dont celle de l'écrivain Giorgio Bassani, honoré par un monument réalisé par Arnaldo Pomodoro et Piero Sartogo.
Accessible par un portail Art nouveau datant de 1912, le cimetière est divisé en cinq zones principales qui reflètent les différentes acquisitions au fil du temps. On y trouve des sépultures récentes, des pierres tombales du XIXe siècle, une zone dédiée aux victimes des déportations et des traces d'une zone du XVIIIe siècle marquée par les destructions de l'Inquisition. Sur les quelque 800 pierres tombales, beaucoup portent des inscriptions en hébreu, en italien ou bilingues. Ce lieu silencieux et contemplatif a inspiré Bassani lui-même, qui l'a décrit de manière émouvante dans son roman Gli occhiali d'oro (Les lunettes d'or), y percevant un sentiment de profonde pacification. C'est ici que Bassani, dans sa réinvention littéraire, a également placé la tombe monumentale et stylistiquement éclectique de la célèbre famille Finzi-Contini, symbole de son importance et des vicissitudes complexes de la communauté.

9. Maison Bassani
La maison Bassani, située au centre de la Via Cisterna del Follo, est l'ancienne demeure où Giorgio Bassani, ses parents et ses frères et sœurs ont passé leur enfance et leur adolescence. Ce lieu intime, profondément ancré dans la biographie de l'écrivain, a été le creuset de sa poésie et de son grand engagement civil, comme le rappelle une plaque apposée par la municipalité de Ferrare en 2009. Bassani quitta cette maison en mai 1943, lorsqu'il fut arrêté pour ses activités antifascistes ; après sa libération et son entrée dans la clandestinité, sa famille, qui avait échappé aux rafles allemandes en se cachant dans une armoire, le rejoignit à Florence, puis revint à Ferrare après la guerre. La maison est également célèbre pour le grand magnolia qui se détache du mur entourant le jardin intérieur, un arbre qui revêt une forte signification symbolique dans le célèbre poème de Bassano, Les lois raciales.
Bien que dans certaines de ses œuvres, comme Dietro la porta (Derrière la porte), Bassani place la maison dans la Via Scandiana, le bâtiment de la Via Cisterna del Follo est le centre réel et imaginatif de sa production. La maison et son jardin, avec ses hauts murs et sa tortue domestique, sont devenus pour Bassani un lieu frontière entre le monde commun et le mystère, une source de rêves et de cauchemars. C'est [...] dans ces regards lancés depuis les fenêtres les plus hautes de la maison, depuis les lucarnes les plus audacieuses descendues pour saisir un secret, que nous vivions de toute notre âme", écrit Bassani dans ses carnets.

10. École espagnole
L'école espagnole de Via Vittoria est un témoignage significatif de la richesse et de la diversité des synagogues qui peuplaient Ferrare. Au XVIe siècle, la ville comptait au moins dix synagogues, publiques et privées, disséminées dans différentes rues. Les Juifs séfarades, connus sous le nom d'"Espagnols et Levantins", sont arrivés à Ferrare en 1492 à l'invitation du duc Ercole Ier d'Este, après leur expulsion d'Espagne. Considérés comme une "nation" distincte de l'administration papale à l'égard des Juifs italiens et allemands, ils furent autorisés à tenir leur propre synagogue, la Scola Spagnola, dans la Via Gattamarcia (aujourd'hui Via della Vittoria, 41). Ce privilège fut maintenu même après que la législation papale de 1620 eut imposé la présence d'une seule synagogue dans la ville, entraînant la fermeture d'autres lieux de prière privés.
Tragiquement, comme d'autres synagogues de Ferrare, l'École espagnole a été dévastée par les nazis-fascistes en 1944. Aujourd'hui, la synagogue est fermée et une partie de son mobilier a été déplacée. La documentation photographique a permis de reconstituer ses caractéristiques : des murs décorés, un grand aron sur le mur oriental et une bimah (sorte de chaire) séparée de l'aron, semblable à la poupe d'un navire, d'où le rabbin dirigeait la communauté. Une plaque sur le mur extérieur commémore l'invitation du duc Hercule Ier en 1492 et la destruction de la synagogue en 1944, symbole de la diffusion de la culture séfarade en Italie et en Europe.