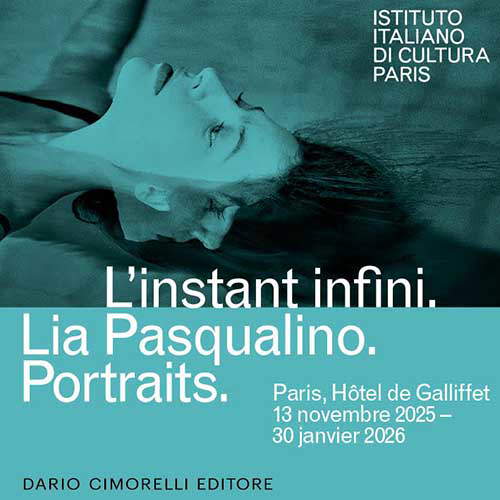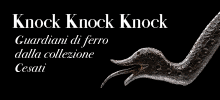La Wallace Collection, maison londonienne dépositaire de grands chefs-d'œuvre
Au cœur de Londres, une somptueuse demeure, la Wallace Collection, est ouverte au public : ancienne propriété des marquis de Hertford, elle est aujourd'hui accessible à tous et habitée par d'importantes œuvres d'art.
Par Jacopo Suggi | 11/07/2025 17:19
Un voyage à Londres comporte certains rituels incontournables, parmi lesquels figure certainement la visite de quelques-uns des musées les plus célèbres du monde, tels que la National Gallery, le British Museum ou la Tate Modern. Il se trouve que même les personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées sont amenées à se confronter à ces gigantesques collections, en ayant peut-être prévu dès le départ de consacrer une demi-journée à la visite. Le résultat ? Après une succession de bousculades, on parvient à se frayer un chemin dans la foule pour voir une infinité d'œuvres, photographier celles dont on se souvient dans nos souvenirs d'école comme étant célèbres, ou imiter les foules qui se sont déjà formées. Pour repartir, épuisé, les pieds douloureux, anesthésié par une succession de chefs-d'œuvre que l'on n'a pas su contextualiser, hiérarchiser, s'approprier, bien qu'ils soient tous de grande qualité. Ne vous méprenez pas, je ne diabolise pas ces musées, ils sont incroyables et pour un amateur d'art ils peuvent procurer des émotions uniques. Mais ce sont des visites épuisantes, qui font plier les genoux même des professionnels, elles sont censées être épuisées en plusieurs visites, en regardant juste quelques pièces et en sortant, mais nous qui sommes maintenant dans la capitale anglaise - qui sait quand nous les reverrons - nous ressentons le besoin de nous tenir devant chaque œuvre. Le résultat est dévastateur, des milliers de peintures et de sculptures admirées en quelques heures ne laissent pratiquement rien derrière elles. Je ne cache pas mon abattement devant les dimensions monumentales du British Museum.
Les musées encyclopédiques sont créés pour contenir tout ce que l'humanité a pu offrir de meilleur au cours des siècles ou des millénaires : le résultat est que l'individu en sa présence disparaît, est submergé. C'est pourquoi je voudrais recommander un musée où l'on peut se sentir à l'aise, où la visite devient aussi légère et tranquille que les verres, les porcelaines et les peintures qu'il renferme, sans pour autant sacrifier l'observation de chefs-d'œuvre d'une qualité indéniable. Je veux parler de la Wallace Collection, un musée du centre de Londres, ou plutôt une maison-musée. C'est pourquoi nous lui trouvons un certain degré de familiarité : nous avons tous l'expérience de la maison et, aussi riche et majestueuse soit-elle, elle garde la trace de vies différentes, de frivolités et de routines quotidiennes, avec lesquelles nous nous moquons constamment et qui nous ressemblent certainement plus qu'un défilé de chefs-d'œuvre dans des temples gigantesques.
L'institution située à Manchester Square, à quelques centaines de mètres de la célèbre Oxford Street, compte parmi les plus anciennes maisons appartenant à un collectionneur à avoir été muséifiées et ouvertes au public depuis 1900. La collection est le résultat stratigraphique des quatre premiers marquis de Hertford et de Sir Richard Wallace, fils probablement illégitime du quatrième marquis. Le premier et le deuxième marquis sont crédités de quelques achats épisodiques d'œuvres importantes, notamment des peintures de Canaletto, Gainsborough et Reynolds, tandis que le troisième marquis avait un intérêt organique pour la collection et l'art en général, acquérant d'importantes peintures hollandaises du XVIIe siècle, du mobilier français et de la porcelaine de Sèvres. Mais c'est surtout son fils, le quatrième marquis, qui a façonné la collection et lui a imprimé les caractéristiques qu'elle présente encore aujourd'hui. Richard Seymour-Conway était un homme d'une immense richesse, mais il n'est certainement pas entré dans l'histoire pour son caractère bienveillant, à tel point que les frères Goncourt se souviennent de lui comme d'un "monstre complet, absolu et impudent", qui déclara un jour avec fierté : "Quand je mourrai, j'aurai au moins la consolation de savoir que je n'ai jamais rendu service à personne". Ayant grandi et vécu longtemps à Paris, il développa une passion pour l'art français qui complétait celle pour la peinture anglaise, ainsi que pour la porcelaine, le mobilier, les armes et les armures. Richard Wallace, qui était probablement le fils illégitime de Conway, bien que détaché de lui par son altruisme qui le distinguait comme philanthrope, hérita de la collection et de l'amour de l'art de son père et l'agrandit. C'est plus tard la veuve de Wallace qui décida de faire don de la collection à l'État britannique.










La Wallace Collection est installée à Hertford House, anciennement Manchester House, construite en 1776 pour le quatrième duc de Manchester. Il s'agissait d'un bâtiment de style géorgien, dont il reste les quatre colonnes blanches qui soutiennent les pronaos de l'entrée. C'est plus tard Wallace qui, ayant racheté le bâtiment à un cousin éloigné, le redessina radicalement en ajoutant des ailes à la façade. Dans les dernières années du XIXe siècle, la résidence fut transformée en musée par l'architecte John Taylor.
Aujourd'hui, la Wallace Collection offre une splendide visite d' une somptueuse demeure aux pièces aérées et luxueuses et à la collection variée, comprenant un très important noyau d'art français du XVIIIe siècle, ainsi que des œuvres médiévales, Renaissance et baroques et l'une des plus belles collections d'armes et d'armures de Grande-Bretagne. Le visiteur est accueilli dans l'atrium par un élégant escalier d'honneur orné d'une balustrade en fer forgé provenant de la Banque Royale de Louis XIV à Paris. Plusieurs œuvres sont exposées dans l'espace, parmi lesquelles les deux bustes d'un homme et d'une femme africains du XVIIe siècle, en marbre noir et jaspe, provenant de Rome, méritent d'être mentionnés. Les deux sujets traités avec un grand réalisme ne présentent pas les caractères stéréotypés des portraits contemporains de Noirs, généralement caricaturaux et teintés d'exotisme. Au rez-de-chaussée se trouvent également les State Rooms, des pièces représentatives de l'opulence de la résidence londonienne et qui servaient à recevoir les visiteurs importants. Ces pièces sont toutes richement décorées avec des tissus aux murs, des rideaux prestigieux et des lustres grandiloquents. Le tableau de Thomas Lawrence représentant l'écrivain et la comtesse Marguerite de Blessington, exposé à la Royal Academy et salué par Lord Byron : "Il rend fou tout Londres", est suave. De grande qualité également, certains des bustes féminins de Jean-Antoine Houdon dans la salle à manger, dont celui de Madame de Sérilly, une dame de la haute société, célèbre pour sa beauté et sa vie parsemée d'infortunes : avec son mari, elle fut condamnée à mort par le gouvernement révolutionnaire, sauf qu'elle échappa à ce destin tragique parce qu'elle était enceinte ; elle se remaria encore deux fois, et ses proches moururent tous deux peu après ; enfin, elle mourut elle aussi de la variole noire à seulement 36 ans. Mais bien d'autres trésors sont abrités dans ces salles : des portraits de Reynolds, des sculptures, et une vaste collection de porcelaines, horloges, carillons, encriers, coffrets, servis pour la plupart dans le style rococo. Des œuvres importantes sont également conservées dans la galerie du XVIe siècle, une salle dont Richard Wallace est le conservateur attitré. On y trouve, entre autres, une précieuse miniature attribuée à Hans Holbein le Jeune, un retable de Cima da Conegliano provenant d'une église de Mestre, représentant Sainte Catherine et surmonté d'une lunette, ainsi que de belles œuvres de Bernardino Luini, dont quelques fragments de fresques détachées de la Villa La Pelucca, à Sesto San Giovanni. Un fragment de Vincenzo Foppa, représentant un jeune homme en train de lire Cicéron, est particulièrement intéressant : il s'agit de l'unique témoignage de la fresque réalisée par l'artiste pour le Palazzo del Banco Mediceo de Milan.
Il y aurait encore de nombreux trésors à mentionner, de Beccafumi à Torrigiano et bien d'autres. Cette "incrustation" de chefs-d'œuvre est un motif récurrent dans toutes les salles de la collection. Le " fumoir " abrite aujourd'hui une magnifique sélection d'assiettes en majolique de la Renaissance. Les autres salles, en revanche, sont consacrées à l'exposition d'armes et d'armures: une immense collection qui comprend des pièces d'un intérêt historique et artistique extraordinaire. La collection a été commencée par le quatrième marquis et agrandie par Wallace. Elle comprend non seulement des spécimens européens, mais aussi des pièces provenant de l'Empire ottoman, de l'Iran, de l'Inde, de la Chine et du Ghana. La vaste sélection d'artefacts européens s'étend du Xe siècle à nos jours et comprend certaines des armes et armures médiévales les mieux conservées au monde, les pièces les plus prestigieuses provenant des armureries de souverains importants tels que Maximilien Ier, Charles Quint et Élisabeth Ier. Parmi les nombreuses reliques remarquables de cette section, citons un canon d'apparat réalisé par Giovanni Mazzaroli, décoré en relief de scènes mythologiques comme une véritable sculpture, un fusil de chasse ayant appartenu au tsar Nicolas Ier et une paire de pistolets créée pour Louis XIV.
La visite se poursuit au premier étage, qui ne perd pas de son intensité, et dans la salle à colonnades située au-dessus de l'escalier se trouvent de somptueuses œuvres de François Boucher, l'un des artistes les plus influents du XVIIIe siècle, premier peintre de Louis XV et favori de Madame de Pompadour, la maîtresse du souverain, dont le tableau de la salle est également de la main du peintre français. Et si les collections sont incroyablement variées, la matrice française reste prédominante, notamment pour raconter l'évolution de l'art rococo. Ce style apparaît à la fin du règne de Louis XIV et au début de celui de Louis XV, période au cours de laquelle le contrôle strict de la cour sur les questions artistiques se relâche, ouvrant la voie à une plus grande liberté d'expression. Le rococo atteint son apogée sous Louis XV, caractérisé par la légèreté, l'élégance et le goût de l'intimité, avant de céder progressivement la place à une nouvelle sensibilité. Sa fin coïncide avec la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Antoinette, où un profond intérêt pour l'art de la Grèce et de la Rome antiques se réveille, donnant l'impulsion au néoclassicisme.














Les arts appliqués suivent ces transitions, et des meubles et porcelaines de gaieté, on passe à des lignes plus sobres. De nombreuses pendules, bureaux, vases sont commandés par des mécènes royaux et proviennent des plus grands palais parisiens, comme les trois splendides vases de la manufacture de Sèvres, émaillés de scènes des Métamorphoses d'Ovide, si précieux que leur vente équivaut au salaire de vingt-cinq ans d'un artiste. Offerts par Louis XVI à Henri, frère de Frédéric le Grand de Prusse, ils se sont retrouvés sur le marché des antiquités et ont été payés une somme astronomique par le quatrième marquis, à tel point que la presse de l'époque a qualifié l'opération de "folie". D'autres objets ont été réalisés pour Marie-Antoinette, comme le précieux bureau à portes, créé par Jean-Henri Riesener pour le Petit Trianon, le petit château du château de Versailles qui servait de retraite à la monarque.
Des tableaux remarquables complètent la collection, parmi lesquels figurent certains des protagonistes les plus importants de l'époque, comme Antoine Watteau, qui a introduit la Fête galante, un tableau montrant des scènes idéalisées de personnes élégantes dans la campagne, et Jean-Honoré Nicolas Fragonard. Le chef-d'œuvre le plus célèbre de ce dernier, La Balançoire, authentique manifeste rococo prônant les valeurs de frivolité, de légèreté et d'élégance propres à la saison, est conservé. Le tableau représente une femme richement vêtue avec son mari plus âgé derrière elle, tandis qu'un homme plus jeune reste caché dans un buisson au-dessous d'elle. La scène est renforcée par plusieurs statues allégoriques et par la pantoufle qui s'est détachée du pied de la jeune fille et qui retombe vers l'homme caché, impliquant un triangle amoureux. L'ensemble de l'œuvre est traversé par une démangeaison érotique soulignée par la végétation luxuriante.
Les autres salles construites ultérieurement pour être transformées en galeries sont remplies de chefs-d'œuvre, à tel point qu'il est pratiquement impossible d'en suivre le cheminement. Généralement divisée par nationalité, la salle Ouest contient des portraits d'artistes britanniques du XVIIIe siècle, parmi lesquels trois portraits de Mrs Robinson, célèbre actrice de son temps et fiancée au prince de Galles, le futur George IV, peints ici par Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds et George Romney. Reynolds a également réalisé un étonnant portrait de Nelly O'Brien, une célèbre courtisane. Le tableau fait preuve d'un grand naturalisme et d'une utilisation habile des modulations de la lumière et de la restitution des valeurs matérielles. Le critique d'art Jonathan Jones a écrit à ce sujet : "Il s'agit d'une peinture urbaine, qui ne regarde pas Nelly de haut ni ne se laisse aller à l'excitation rococo en peignant une prostituée de haut rang. Son statut social ambigu libère Reynolds de la nécessité de parler ; il n'y a pas de prétention à la grandeur ici, mais plutôt une immédiateté intime".
Ensuite, une salle abrite des peintures vénitiennes, en particulier de Canaletto et Francesco Guardi, artistes appréciés des Britanniques pendant la saison du Grand Tour, et parmi les premières œuvres à entrer dans la collection. La galerie ouest, en revanche, abrite les œuvres des peintres du romantisme historique actifs dans les premières décennies du XIXe siècle, parmi lesquels Hippolyte Delaroche et Eugène Delacroix, dont le tableau L'exécution du doge Faliero, inspiré d'un poème de Byron et considéré par l'artiste comme l'une de ses œuvres préférées, est exposé. Il y a aussi de nombreuses œuvres d'artistes flamands de différents siècles, splendide est le tableau La Dentellière de Gaspare Netscher, qui trahit des inspirations et des atmosphères proches de Vermeer ; de Rembrandt nous mentionnons l'Autoportrait au bonnet noir et le Portrait de son fils Titus. Dans le Salon Est, en revanche, on trouve des œuvres d'artistes actifs à Anvers et à Bruxelles au XVIIe siècle, dont Anthony van Dyck et Rubens. De ce dernier, entre autres, sont conservés trois modèles préparatoires pour le cycle que l'auteur a réalisé pour le Palais du Luxembourg à Paris, illustrant la Vie d'Henri IV.
Mais les chefs-d'œuvre les plus étonnants se trouvent sans aucun doute dans la Grande Galerie, l'espace construit vers 1875, lorsque Wallace a transféré une grande partie de sa collection de Paris à Londres. La salle a été construite pour accueillir cette fonction, avec de grands murs ininterrompus et la lumière naturelle entrant par de grands vitraux dans la voûte, et devait à l'origine être le point culminant d'une visite de la villa. Les œuvres exposées sont toutes de très grande qualité : on y trouve des œuvres splendides de Philippe de Champaigne, comme l'Adoration des bergers (fortement influencée par la peinture du Caravage), l'Annonciation et le Mariage de la Vierge, des tableaux caractérisés par des couleurs éclatantes, en particulier des rouges et des bleus vifs, et par l'utilisation d'une lumière intense qui accentue la plasticité des figures.
Parmi les artistes français, on trouve également des œuvres de Nicolas Poussin et de Claude Lorrain, ainsi que d'excellentes œuvres de l'école espagnole, dont des peintures de Murillo et La dame à l'éventail de Vélasquez, l'un des chefs-d'œuvre incontestés du portrait, d'une grande intonation psychologique et jouant sur une gamme de couleurs très restreinte, en particulier les noirs et les rouges. D'autres tableaux de Rubens et de Rembrandt figurent dans cette salle, tout comme Van Dyck présent ici avec les portraits de Philippe Le Roy et de Marie de Raet, parmi les plus hautes manifestations de son art. Il convient également de mentionner le chef-d'œuvre de Frans Hals de 1624, Le Cavalier riant, acheté par le quatrième marquis alors que l'auteur n'avait pas encore été redécouvert par les collectionneurs internationaux, et qui témoigne d'un incroyable talent de portraitiste.
Dans la Grande Galerie, l'école italienne est également représentée à son meilleur niveau avec une belle vue du Bacino di San Marco de Canaletto, probablement achetée par le premier marquis directement auprès de l'atelier de l'artiste ; de Domenichino, une Sibylle qui faisait autrefois partie de la collection du Régent de France, Philippe II, est exposée ; La sélection est complétée par deux somptueux tableaux religieux de Sassoferrato et par la grande toile Persée et Andromède de Titien, qui faisait partie de la série de six tableaux mythologiques réalisés pour le roi Philippe II d'Espagne et achetés ensuite par le peintre Anthony Van Dyck. Et bien d'autres œuvres encore pourront être dévorées des yeux par le visiteur qui, au mépris de la pression sociale, décidera d'abandonner les circuits touristiques établis pour s'offrir une aventure sans pareille entre les murs de la Wallace Collection.