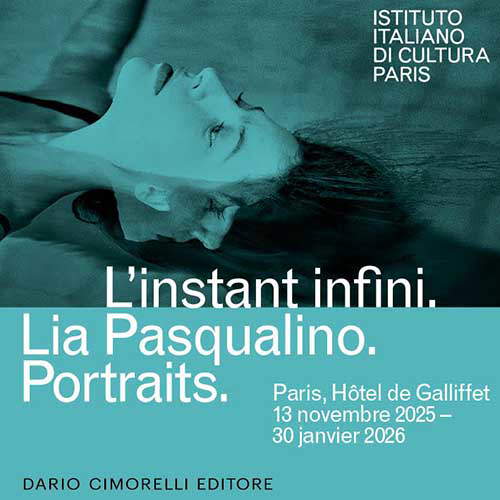La Rotonde de Rovigo, le sanctuaire qui devint le miroir du pouvoir vénitien
Fondée comme sanctuaire marial, la Rotonda di Rovigo est devenue au XVIIe siècle un somptueux temple civique, miroir du pouvoir vénitien. Entre toiles baroques et glorifications du podestat vénitien, l'église raconte la rencontre entre foi et politique, entre dévotion populaire et autocélébration de la Sérénissime. Un nouvel article dans la rubrique "Les voies du silence" de Federico Giannini.
Par Federico Giannini | 26/10/2025 13:45
Ceux qui arrivent à la Rotonda di Rovigo par la rue la plus belle et la plus commode, celle qui mène à la longue place inaugurée en 1864, risquent d'être trompés : une pelouse, des pins, deux ailes de pavés et deux rangées de maisons colorées qui vous accompagnent devant ce que vous pensez être la façade du grand temple octogonal. En réalité, la façade se trouve deux côtés plus à gauche. Et elle donne sur la rue la moins intéressante. Mais l'entrée monumentale est là, et c'est en entrant par là que l'on se retrouve avec l'autel sous les yeux, et partout l'église.l'autel sous les yeux, et partout, sur les murs, les toiles qui couvrent les huit côtés de l'église, les niches avec les statues de saints, les grandes fenêtres par lesquelles la lumière du jour entre partout, et tout en haut du plafond, l'image de la Sainte Vierge du Secours, à qui l'église est dédiée.
On se sent submergé, inondé. Si vous arrivez à la Rotonde après avoir vu le grand Panorama de Giovanni Biasin au Palais Roverella, la vue enveloppante de Venise accrochée aux murs pour donner au spectateur la sensation d'être là, sur l'eau du bassin de Saint-Marc, alors ces vingt-deux mètres de papier vous sembleront un jeu, ou tout au plus une sorte d'antichambre. Ici, à l'intérieur de cette église, il n'y a pas l'illusion d'être ailleurs, il n'y a pas la conscience d'assister à une sorte de spectacle créé exprès pour étonner, et il n'y a peut-être même pas l'intérêt de savoir qui sont les peintres qui ont recouvert tous les murs de cette église. Et la liste serait longue, car on y trouve tout le meilleur de la peinture vénitienne du XVIIe siècle : aucun grand artiste de la Venise baroque n'a reculé devant l'idée d'offrir une de ses toiles à la Rotonda di Rovigo. On ne s'intéresse pas aux figures, on ne s'intéresse pas à ces tourbillons d'air et de nuages, à ce flottement d'étoffes et de brocarts, à cette exorbitance de ciels et de lueurs dorées, à ces enchevêtrements de corps d'anges, à tout ce qui suffirait à faire plier l'âme la plus réfractaire à l'émerveillement. Les noms de Pietro della Vecchia, Pietro Ricchi, Pietro Liberi, Gregorio Lazzarini, Francesco Maffei, Andrea Celesti, Antonio Zanchi, et même deux étoiles de la grande décoration baroque toscane, Giovanni Coli et Filippo Gherardi, qui ont travaillé ensemble à Venise pendant quelques années, et beaucoup d'autres, peut-être moins célèbres, mais certainement très habiles, ne vous intéressent pas non plus. Bien sûr, en dehors du cercle des initiés, les noms d'un Ricchi ou d'un Maffei ne suscitent pas l'enthousiasme, mais il y a certainement assez de matériel à l'intérieur de la Rotonda pour composer une sorte d'échantillon de la grande peinture vénitienne de l'époque.



D'autant plus que les noms n'ont que peu ou pas d'intérêt. On se dit que la Vierge et les saints n'ont probablement jamais fait de politique, mais on a l'impression d'assister à une réunion où le sacré est une justification, un prétexte, une énorme scénographie rayonnante, de participer à une mise en scène consciente, où l'appareil divin contribue, en un lieu, à l'exaltation d'un appareil terrestre. Le long des bandes qui entourent les huit côtés du temple, des épisodes des Écritures se mêlent à des scènes célébrant les podestats de Rovigo, les administrateurs locaux qui dirigeaient la ville à l'époque, choisis parmi le patriciat de la République de Venise, dont Rovigo faisait partie, et élus par le Maggior Consiglio della Serenissima. Ils étaient bien plus que des maires : les podestà, dont le mandat était de douze mois, n'administraient pas seulement Rovigo, mais étaient aussi les surintendants généraux de tout le Polesine, ils détenaient le pouvoir judiciaire sur les terres qu'ils gouvernaient, et ils présidaient également au gouvernement des eaux, une tâche qui, dans un pays de fleuve, de mer et de marais, était certainement l'une des plus délicates. Il n'est donc pas étonnant que leur présence ici soit si insistante : Dans le bandeau inférieur, les huit histoires de la Vierge alternent avec autant de glorifications de podestats, et dans le bandeau central, vingt saints, modelés en stuc par le sculpteur comtois Davide Arrieti en 1627, guident le regard vers le bandeau supérieur, tous remplis, à l'exception d'une seule toile, des célébrations des gouverneurs de Rovigo : douze podestats et quatre provéditeurs. Enfin, sur le plafond qui décore la coupole, on trouve la fresque de 1887 représentant un miracle de la Madonna del Soccorso, œuvre de Vittorio Bressanin.
Il n'y a peut-être pas un seul endroit dans toute la Vénétie, en dehors du palais des Doges de Venise, qui célèbre avec une persévérance aussi obstinée, une splendeur aussi écrasante, un orgueil aussi ostentatoire l'administration de la Sérénissime, avec ces maires enveloppés dans leurs hermines, dans leurs robes pourpres, presque des médiateurs entre le ciel et la terre, présentés à la Madone tantôt par les vertus, tantôt par les anges, comme il en va pour le podestat Bertuccio Civico, le maire de la ville de Venise. pour le podestat Bertuccio Civran qui, dans l'une des toiles de Maffei, est accompagné, sous la colonne d'un temple classique, par la charité et l'humilité, un singulier paradoxe, ou encore pour Bartolomeo Querran qui, dans l'une des toiles de Maffei, est accompagné par la charité et l'humilité.pour Bartolomeo Querini, dans le plus sombre et le plus lugubre des tableaux de la Rotonde, où Pietro Ricchi imagine la ville de Rovigo elle-même, vêtue de deuil, conduisant le podestat. Le cycle des toiles nous apparaît comme s'il avait été peint d'un seul coup, parce qu'il évolue d'un seul tenant, parce qu'il répond selon toute vraisemblance à un programme décoratif précis, un programme d'exaltation de la ville et, peut-être plus encore, de sa capitale, mais les toiles de la Rotonde ont mis près de soixante ans à être achevées.ans et, à la fin des travaux, le sanctuaire dédié à la Madonna del Soccorso était devenu un grand et splendide temple civique, peut-être même disproportionné par rapport à la taille d'une ville qui était pourtant, même si elle n'était pas la plus grande de la Sérénissime, une ville frontalière importante et prospère, la capitale d'un territoire qui avait également connu une forte croissance démographique au début du XVIIe siècle. Il n'est donc pas surprenant qu'à un moment donné de l'histoire, quelqu'un ait jugé bon de transformer le sanctuaire de la Vierge Marie du Succès en une sorte d'hôtel de ville baigné de lumière sacrée.




L'église avait été construite quelque temps avant que la ville ne prenne cette décision. Son histoire, au départ, est identique à celle de centaines d'autres lieux sacrés : une communauté est fortement attachée à un tableau représentant la Vierge Marie parce qu'elle le considère comme miraculeux et, à un moment donné, généralement à l'occasion d'un miracle particulièrement émouvant (dans notre cas, la victoire sur une épidémie), la communauté décide de le remplacer par un tableau représentant la Vierge Marie.à un moment donné, la communauté décide que l'oratoire où elle avait jusqu'alors vénéré cette image n'est plus adapté à sa fonction. Nous disons "communauté" de manière générique car, dans le cas de la Rotonde, nous ne savons pas si l'impulsion principale est venue des autorités de la ville, de l'évêque ou des franciscains qui géraient l'ancien oratoire et qui gèreraient également la nouvelle église. Le fait est qu'à la fin du XVIe siècle, l'architecte Francesco Zamberlan, ami et collaborateur de Palladio, se vit confier la tâche de concevoir un nouveau temple, financé par des ressources publiques et par des dons de particuliers de Rovigo, qui s'avérèrent décidément très généreux. La première pierre fut posée le 13 octobre 1594, et douze ans plus tard, l'édifice était achevé (seul le clocher, conçu par le plus grand architecte vénitien du XVIIe siècle, Baldassarre Longhena, est postérieur : il fut commencé en 1655 et achevé en 1773). L'église est située dans une zone décentralisée, adossée aux murs de la ville, dans une zone peu urbanisée, ce qui a permis à Zamberlan d'opter pour un temple à plan central, un choix rare pour une église de la Renaissance en Vénétie et avec peu d'autres comparaisons, et de dimensions considérables. À l'extérieur, le corps octogonal est entouré d'un grand portique soutenu par des colonnes de style toscan, s'élevant au-dessus d'un podium. L'extérieur est également trompeur car il est extrêmement régulier, modéré, équilibré, sobre : l'œuvre d'un ingénieur, vraisemblablement animé par des idéaux humanistes, voulant célébrer l'harmonie, la rationalité, la domination de l'être humain qui veut donner de l'ordre aux choses. A l'intérieur, tout change : Franco Barbieri, spécialiste reconnu de l'architecture, a noté qu'à l'intérieur, le visiteur se sentait submergé par la cascade de dorures, de peintures et de figures qui s'écoulaient autour et au-dessus de sa tête. Nous ne savons pas si telle était l'intention dès le départ, mais il est certain qu'au moment où, à l'issue d'un litige (nous devons tenir compte du fait que nous sommes à l'époque de la persécution contre Paolo Sarpi, à l'époque de l'âpre conflit entre la Sérénissime et l'Église, à l'époque de l'interdit de Paul V contre la République de Venise), la ville de Rovigo a obtenu la propriété de l'hôtel de ville, l'hôtel de ville s'est vu attribuer la propriété de l'hôtel de ville et de l'église. de Rovigo obtint la propriété de l'église, se garantissant ainsi le droit de la transformer en ce temple civique qu'elle est devenue, les autorités durent évidemment établir un programme que l'on peut voir aujourd'hui le long des plus de deux mille mètres carrés de murs qui entourent les fidèles lorsqu'ils regardent l'autel en bois, sculpté en 1607 par un artiste local, Giovanni Caracchio.
L'intention de transformer le sanctuaire en un mausolée singulier des gloires de Rovigo a probablement existé dès le début, ou presque, mais il a probablement manqué un directeur unique, bien que les gouvernements qui ont administré Rovigo pendant presque tout le XVIIe siècle aient fait de leur mieux pour donner une certaine continuité esthétique à l'ensemble de l'appareil décoratif : Il faut souligner que les œuvres ont été données ou payées par les particuliers qui les ont commandées, c'est pourquoi il n'est même pas facile de trouver des documents précis qui permettent de reconstruire en détail l'histoire de ce cycle peint. Peu importe : l'absence d'informations n'empêche pas de saisir l'unité d'un programme qui semble prédéterminé, bien qu'il ait ensuite été complété de manière épisodique, avec un filet de toiles, données par les podestats à la fin de leur mandat, plus par autocélébration et coutume que par dévotion sincère, et qui se poursuivra presque jusqu'au seuil du XVIIIe siècle. C'était, résume Vittorio Sgarbi, qui a longtemps étudié la Rotonda di Rovigo, "un lieu de dévotion mariale où l'on célébrait surtout la République vénitienne.
.





L'attirail propagandiste de cette célébration visait à exalter Venise à travers ses administrateurs locaux, considérés comme les bras fiables de la Sérénissime sur le territoire, déterminés à gouverner Rovigo et le Polesine selon les principes qui ont permis à la République de dominer sur mer et sur terre : D'une part, l'hommage aux vertus qui guidaient l'action des podestats, et d'autre part les effets de leur bonne gouvernance, sous la bénédiction des saints et toujours avec Venise ou Rovigo elle-même comme toile de fond, représentée avec ses palais ou personnifiée, comme nous l'avons vu, en présentant le podestat en service à la Vierge. Le podestat Giovanni Cavalli, par exemple, est escorté par la Justice et la Prudence, tandis que son collègue Benedetto Zorzi est entouré par l'Abondance, la Justice, la Vertu et la Prudence, tandis qu'un autre quatuor, composé des vertus cardinales, conduit le podestat Nicolò Balbi à la présence de la Madone dans un tableau d'un auteur encore inconnu. Les tableaux d'Antonio Randa, qui représente Pietro Morosini avec une corne d'abondance et une grue tenant une pierre, symbole de vigilance, et de Francesco Maffei, qui imagine Sante Moro avec l'Abondance, allégorie des vertus cardinales, illustrent les conséquences de l'action du podestat.Abondance, l'allégorie de Venise et d'un pauvre qui participe à la glorification du podestat avec la personnification de l'Amour pour les pauvres, tandis que l'allégorie de la Vertu bannit le vice. Il n'y a pas eu non plus de podestats qui ont voulu démontrer leur pouvoir en se faisant peindre avec des figures rappelant les territoires qu'ils administraient : ainsi Andrea Celesti présente le podestat Giovanni Giustiniani avec les quatre fleuves qui traversent le Polesine, à savoir le Pô, l'Adige, l'Adigetto et le Tartaro-Canalbianco. Et au fil des ans, cette célébration, tout en conservant une tenue esthétique remarquable, tout en préservant cet équilibre qui fait que l'ensemble de l'appareil semble avoir été peint en peu de temps, a été déclinée de la manière la plus diverse : Voici donc les méditations ténébristes de Pietro Ricchi, la richesse baroque de Pietro Liberi, le néo-circularisme crépusculaire d'Antonio Zanchi, les tourbillons de nuages de Francesco Maffei, le mouvement emphatique et festif de Coli et Gherardi. Tous ceux qui, peut-être, avaient davantage foi en l'art qu'en la puissance qui commandait les toiles.
Rovigo dans son ensemble devait se sentir actif, participant à la construction d'une sorte de Venise sur la terre ferme : c'est ainsi que la ville des roses devait apparaître à quiconque y pénétrait. Avec, bien sûr, toutes les limites d'un système politique très centralisé, où l'élite gouvernante était une élite qui se transmettait ses positions de génération en génération, où la distance entre le pouvoir et la population était énorme. L'érudite Mariangela Bordin a remarqué que, dans la plupart des peintures, les deux seuls bâtiments toujours représentés où l'on peut apercevoir la silhouette de Rovigo sont le château et la Rotonde elle-même, appelée à la fonction symbolique de lieu sacré et civique dans lequel toute la communauté se reconnaît, sous la protection de la Vierge Marie, qui tient dans ses mains la fleur symbole de la ville. Un symbole, exactement comme l'église : on pourrait ajouter que, peut-être, la forme même de l'église a été décidée pour transmettre à la population un sentiment de fermeté, de solidité, de stabilité, car dès le début, dès la fondation, l'idée que la Rotonde serait le temple de tous les habitants de Rovigo, construite aussi grâce à leur générosité, a dû être bien acceptée. Et l'on peut également penser que, dans la libre République de Venise, frappée par l'interdit l'année même de l'achèvement de la construction de la Rotonde à Rovigo, il était clair dès le départ que le temple de la communauté ne devait pas être une entité séparée. Bien sûr : on dira que les podestats sont tous agenouillés devant la mère de Dieu, que dans toutes les toiles le peuple de Rovigo n'est même pas pris en compte, que le gouvernement de la ville s'est approprié un culte né de la spontanéité populaire, et que la communauté n'était représentée qu'à travers ceux qui avaient été délégués pour la représenter, et de plus non pas parce qu'ils étaient voulus par les citoyens, mais parce qu'ils étaient l'expression d'une oligarchie et de plus choisis par un corps, le Maggior Consiglio, auquel ils appartenaient par droit héréditaire. Et aujourd'hui, il semble sans doute contradictoire de célébrer la communauté à travers la magnificence du pouvoir. C'est pourtant dans cette ambiguïté, dans cette imbrication de la foi et du pouvoir, que la Rotonde de Rovigo trouve son sens le plus profond. Et elle l'était pour l'époque : sur tout le territoire qui appartenait à cette Sérénissime qui, au XVIIe siècle, lutta contre l'Église et accueillit si bien ceux qui étaient persécutés par l'autorité ecclésiastique, il n'y a pas de lieu sacré où l'affirmation d'une foi et d'un pouvoir puisse s'exprimer avec plus de force.