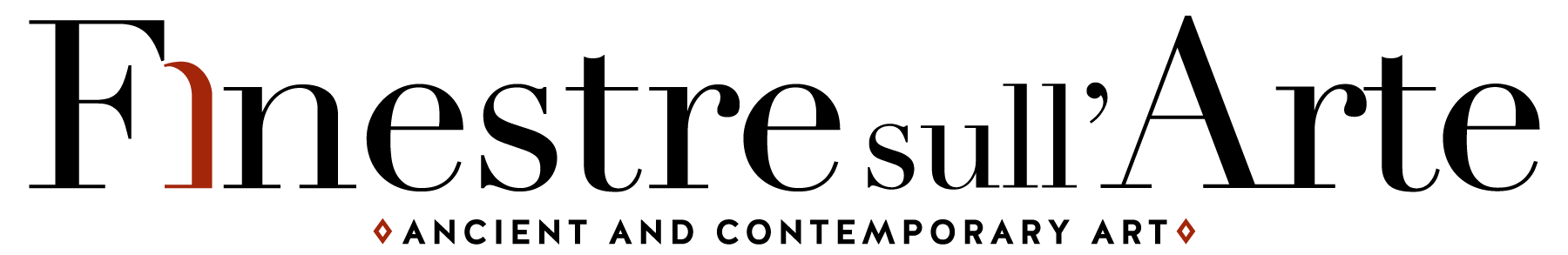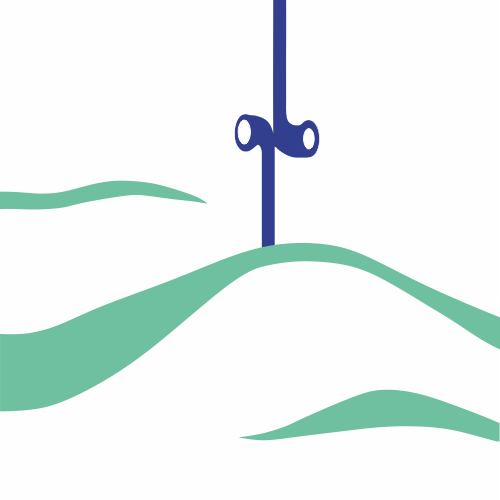L'œuvre d'art et la reproduction de ses images. Un débat ouvert
La question du rapport entre l’œuvre d’art et son image, entendue comme instrument de communication, de diffusion et de connaissance, est une figure d’un grand intérêt théorique, un symptôme qui s’impose à notre attention à l’heure actuelle, celui de la confrontation avec le phénomène de l’image culturelle et sociale, avec l’image produite par l’univers médiatique qui a transformé la société de la machine en “société de l’image”. Une affaire complexe qui confronte différentes latitudes dans les domaines de la connaissance et de la culture : de l’histoire à la philosophie, de l’histoire de l’art à la muséologie, de la sociologie à l’anthropologie, de la communication au marketing.
Pour tenter de démêler cette question, je partirais d’une œuvre de Marcel Duchamp, L’HOOQ de 1919, dans laquelle l’artiste français redéfinit la dimension théorique et linguistique de l’œuvre d’art et anticipe toutes les questions sur la relation entre l’œuvre d’art et son image. Duchamp s’empare en effet de l’image de l’une des œuvres les plus universellement connues et objet de la vénération éternelle du public et lui donne une moustache et une barbiche, réalisant ainsi l’un des gestes les plus provocateurs et iconoclastes de l’histoire de l’art. Une opération qui intervient précisément au moment où la reproductibilité technique de l’image, avec la naissance de la photographie et du cinéma, entame son parcours, long de plus d’un siècle, vers la dimension actuelle de l’hyperconsommation de l’image. La Joconde de Duchamp est-elle donc une métaphore de la marchandisation des arts et de la sanctification de la reproduction de l’image ? Ou s’agit-il simplement d’une moquerie à l’égard d’un public de plus en plus anesthésié qui vénère passivement et sélectivement des œuvres sur la base de leur célébrité ? En réalité, il s’agit des deux. Ce qui se passe depuis le geste de Duchamp - il suffit de rappeler qu’outre le Français, de nombreux artistes ont travaillé sur l’image de la gioconda ou sur des images d’autres œuvres du passé, même avant lui - c’est un changement radical de notre système de communication, non seulement médiatique mais aussi culturel. Cette orientation de l’art a, en effet, initié un processus de libéralisation des images des œuvres d’art qui ouvre certainement des perspectives possibles sur les discussions actuelles qui ont lieu au niveau mondial sur les politiques à adopter en matière de reproduction des biens culturels.

En tant que directeur de musée, je ne peux m’empêcher de penser que la protection des œuvres et de leur image est la première étape à partir de laquelle définir les principes programmatiques de l’action éducative et sociale des musées, en proposant le musée comme arme de culture active. Mais comment protéger les œuvres et leurs images ? Actuellement, deux directions se dessinent : celle d’une protection plus radicale qui envisage une redevance pour l’utilisation des images du patrimoine culturel, et celle d’une libéralisation absolue, comme cela s’est produit dans de nombreux musées américains. C’est peut-être dans ce défi entre ces deux positions que se joue une fin de partie délicate et complexe. D’un côté, l’idée que, dans la société actuelle de l’image diffuse et de l’hyper-esthétisation du monde, le patrimoine culturel doit être protégé et donc à l’abri de ces circuits, et de l’autre, l’idée de profiter de la consommation d’images pour entrer dans le système en participant à l’orgie de l’image diffuse. Peut-être que la solution, comme souvent, réside dans la coexistence de ces deux positions : nous ne pouvons pas laisser les images de notre patrimoine culturel se faire dévorer, modeler, muter et souvent mortifier par un système qui engloutit et rejette tout indifféremment - tous ceux qui postent des images ne sont pas des Duchamp - mais nous ne pouvons pas non plus risquer de priver les gens de la connaissance de notre patrimoine à travers les canaux des générations actuelles (web, social, etc.).
La relation entre l’œuvre d’art et son image semble devenir de plus en plus un oxymore culturel qui, d’une part, risque de nuire à la connaissance de notre patrimoine et, d’autre part, risque d’entraîner une disneyfication absolue des images, même de celles qui ont une valeur culturelle, avec le risque d’une homologation entre les images banales et standardisées et les images qui ont pour but de promouvoir et de développer nos processus culturels. Aujourd’hui, en effet, la prolifération continue d’images standardisées issues du bombardement médiatique a créé chez l’homme un état d’anorexie mentale, de “mémoire instantanée” marquée par une “connexion immédiate” (Jean Baudrillard). Une “mémoire momentanée” obligatoire qui résulte des flux de représentation qui nous envahissent constamment, provoquant une instabilité visuelle faite d’une inconscience de la valeur culturelle, politique et sociale de l’image, déplaçant l’attention vers sa valeur “cultuelle”.
Le risque est donc que, dans cette lutte entre liberté et restrictions, nous perdions de vue la seule chose importante, à savoir que nos biens culturels et leurs images peuvent devenir d’immenses archives de connaissances. D’autre part, Michel Foucault, dans son célèbre essai L’archéologie du savoir, définit l’archive comme un espace théorique dans lequel les documents, et donc aussi les images du patrimoine culturel, peuvent acquérir une nouvelle signification et devenir des monuments. Une archive, cependant, qui doit être capable d’éduquer les images et pas seulement de les mettre sur le web ou dans les pages d’un magazine. Mais les monuments vivent s’il existe une conscience critique collective capable de dialoguer et de se confronter avec eux. C’est pourquoi, à mon avis, nos institutions, le musée, l’école, tous les espaces dédiés à la culture et à la connaissance, doivent agir comme des structures éducatives capables de générer des connaissances et de créer une conscience critique sur l’utilisation des images de notre patrimoine culturel avec une conscience critique.
Plutôt qu’une réponse aux questions sur ce débat complexe entre droits et lois, entre ouverture et fermeture, la mienne se veut une exhortation à la réflexion sur le sens de l’art et sur la diffusion et la promotion de ses images. L’art, nous a appris Paul Klee dans sa Théorie de la forme et de la figuration, "ne répète pas les choses visibles, mais les rend visibles". C’est précisément cette ouverture au visible qui constitue aujourd’hui le principe de base d’une réflexion critique sur l’art et ses reproductions, le lieu d’investigation qui, à l’opposé du concept d’“iconoclasme moderne” exprimé par Baudrillard, permet à l’artiste de s’approprier l’art et ses reproductions. exprimé par Baudrillard, permet de se projeter au-delà de l’image, de l’étudier, de la déconstruire et de la reconstruire dans une dimension de connaissance, de voir, ou plutôt de “connaître l’image”, Wisse das Bild disait Rainer Maria Rilke dans les Sonnets à Orphée.
Cette contribution a été publiée à l’origine dans le numéro 20 de notre magazine imprimé Finestre sull’Arte on paper. Cliquez ici pour vous abonner.
Avertissement : la traduction en anglais de l'article italien original a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.