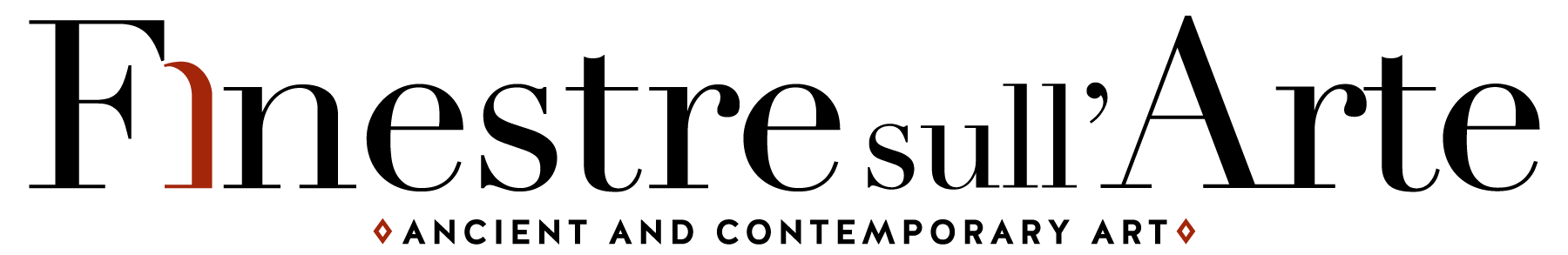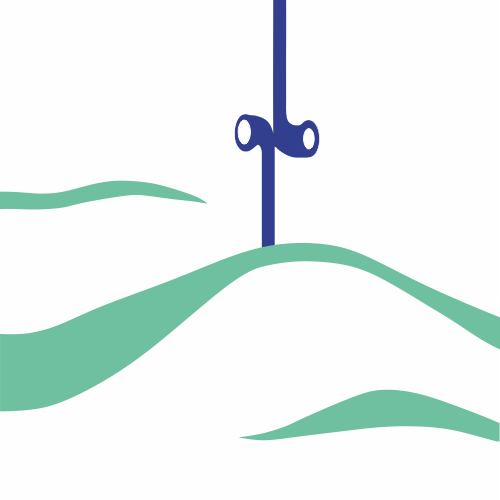La crise de la critique. Pourquoi la critique (et pas seulement celle de l'art) est en crise
En général, le critique vise à disséquer les raisons d’une œuvre de génie, à évaluer sa valeur, ses hypothèses ou à argumenter sa négligence. La critique est une forme de prise en charge des intérêts collectifs qui est née au XIXe siècle et a mûri au cours du XXe siècle avec le développement de la figure de l’intellectuel marxiste, dont l’action vise non seulement à une compréhension profonde des phénomènes, mais aussi à la recherche d’une vérité qui n’est pas toujours manifeste: la critique remplit ainsi la fonction de sentinelle du temps présent et, idéalement, de l’histoire. La crise de la critique, qui touche indifféremment toutes les disciplines, est le produit de différentes causes, qui vont de la structure du système d’information à la complexité enchevêtrée du système culturel, de l’évolution du rôle de l’intellectuel aux transformations sociales et anthropologiques des quarante dernières années.
Dans le domaine du journalisme culturel, et en particulier dans le domaine des arts visuels, le déclin progressif de la critique a parmi ses causes (A) la précarisation du travail, qui tend inévitablement à dévaloriser les instances de nature problématique que toute critique implique: quel travailleur non permanent veut prendre le risque de créer des problèmes pour une publication qui compte souvent parmi ses annonceurs ceux-là mêmes qui ont produit l’événement ? Si l’interdépendance économique entre ceux qui écrivent et ceux qui produisent (B) est en soi un problème, le manque de spécialisation typiquement italien de ceux qui écrivent sur les arts visuels (C) doit également être pris en compte. Avant de travailler comme conservateur, j’ai commencé à m’occuper professionnellement d’art en tant que journaliste, il y a une vingtaine d’années, et j’ai vu des collègues, même dans des magazines ou de grands journaux, écrire indifféremment sur les expositions, le cinéma, les voyages ou la gastronomie et le vin, souvent avec des résultats peu incisifs. Ainsi, les articles ne sont rien d’autre qu’une mise en forme textuelle des documents préparés par les services de presse, enrichis de citations des protagonistes. En outre, il existe une tendance à transformer la culture en une narration chronique (D), dans laquelle on privilégie un aperçu (donc réalisé sans avoir expérimenté les contenus) ou une lecture de divertissement visant l’histoire des protagonistes. Cet aspect atteint son apogée dans les magazines de style de vie ou de glamour, où les artistes, les conservateurs, les écrivains sont célébrés comme des personnalités - voir, par exemple, le cas du pavillon italien en 2019 - souvent au détriment du contenu qu’ils proposent eux-mêmes. D’autre part, ne vivons-nous pas dans une société du spectacle ?
À ces causes internes au monde éditorial s’en ajoutent d’autres, essentiellement imputables aux initiés. En effet, il y a souvent un chevauchement important entre ceux qui produisent des expositions, ou des livres, et ceux qui écrivent (E), tant dans les revues spécialisées que dans les encarts culturels de fond, contrairement à ce qui se passe dans des disciplines comme l’architecture ou le cinéma. Il s’agit d’une petite communauté, dans laquelle les fonctions ne sont pas strictement réparties, où l’on se retrouve, au pied levé, à assumer des rôles en conflit d’intérêt flagrant (dans le monde de la culture, les conflits reconnus sont souvent ceux des autres). Ce phénomène nous ramène à la logique familialiste du système culturel de notre pays (F) qui, à mon avis, atteint des niveaux presque incestueux dans le domaine de l’art et de la littérature, comme cela a également été dénoncé ces dernières années. Par exemple, un historien de l’art ou un critique n’ira jamais jusqu’à écraser une exposition ou une publication d’un de ses “maîtres” ou d’un “disciple” de ses pairs: tout au plus s’attaquera-t-il aux brebis d’un autre troupeau, en sachant toutefois qu’il ouvre une querelle qui n’a rien de bucolique. De même, il est difficile pour un universitaire, un essayiste ou un éditeur d’attaquer vigoureusement un auteur qui publie dans sa propre maison d’édition ou dans celle avec laquelle il pourrait collaborer plus tard: cui prodest ? E et F conduisent irrémédiablement à des revues bienveillantes, où la logique conservatrice des membres du système l’emporte sur celle de l’intérêt général.

La dissolution de la critique s’inscrit également dans la crise plus large du rôle de l’intellectuel (G) qui, dans le monde occidental liquide, ne jouit plus du statut prestigieux qui était le sien il y a quelques décennies: sa fonction de référence pour les masses, tant dans la compréhension de la société que dans sa fonction de veille active, a disparu. Le monde capitaliste a dégradé son autorité et sa signification, en le transformant d’abord en une marchandise à convoiter, puis en créant des substituts bon marché et beaucoup plus maniables. Dans les démocraties où nous vivons, matures mais désormais habituées à la logique du marché, ceux qui convainquent par des réponses faciles semblent l’emporter sur ceux qui fournissent des outils d’analyse critique problématiques (H).
Mais un autre phénomène anthropologique, observable bien avant les réseaux sociaux mais accru par eux, a progressivement conduit au développement d’un contexte hostile à la critique: la difficulté de mener une confrontation sérieuse et intellectuellement articulée (I), qui est l’une de ses conditions préalables, a fait place à une adhésion simpliste ou, parfois, à un rejet de la confrontation. Nous sommes de moins en moins éduqués à exprimer notre désaccord et à l’argumenter (J), parce que dans la famille, à l’école ou dans d’autres activités sociales, on nous demande trop souvent de nous adapter et d’adhérer à un système préétabli, malgré l’étalage rhétorique de la liberté et de l’attention à la diversité. Par rapport à une vie programmée par objectifs, pour raccourcir les processus et accélérer l’apprentissage et nos actions, poser des problèmes est trop souvent une perte de temps (ainsi, par exemple, si une exposition ou un livre est faible, au lieu de l’écraser, on finit par ne pas en parler, ce qui a aussi l’avantage d’être moins risqué).
Toutes ces raisons, à mon avis, mènent à la conclusion que la critique d’art n’est pas morte en tant que discipline en soi, loin de là, mais que les raisons sociologiques qui ont accru son importance dans le passé et l’ont rendue populaire ont en quelque sorte disparu. Je ne veux pas être apocalyptique, mais il est probable que, compatible avec l’évolution des médias, elle survive dans une certaine mesure dans une niche, comme un produit destiné à des élites (culturelles, académiques, etc.) prêtes à entreprendre une véritable étude en profondeur, onéreuse en termes de temps et peut-être de ressources. Bien que je garde intimement l’espoir que les braises qui dorment sous les cendres puissent être ravivées, la raison me pousse au pessimisme.
Cette contribution a été initialement publiée dans le numéro 13 de notre magazine imprimé Finestre sull’Arte Magazine. Cliquez ici pour vous abonner.
Avertissement : la traduction en anglais de l'article italien original a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.