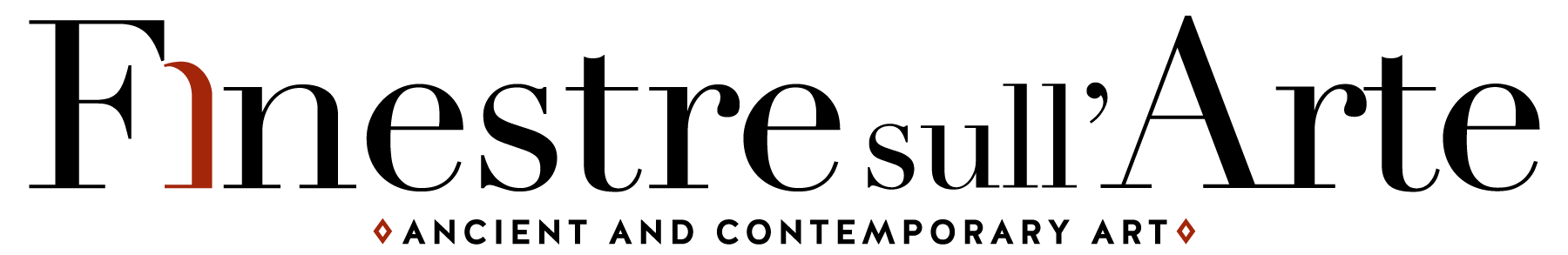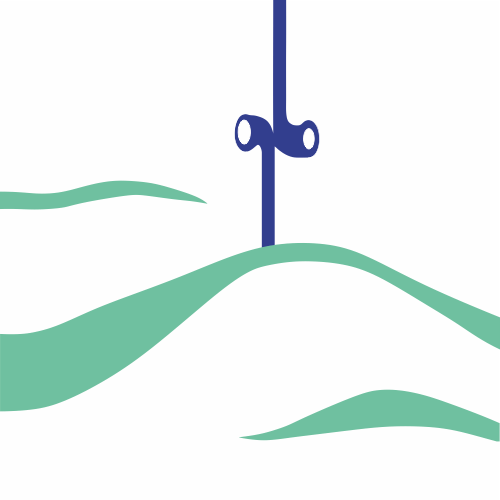La restauration de la basilique Ulpia ? Pas vraiment passionnant
On parle beaucoup ces jours-ci de l’achèvement des travaux de restauration “philologique” d’une petite partie de la colonnade de la Basilique Ulpia qui gisait sur le sol depuis des siècles et des siècles dans la zone du Forum impérial de Rome, ainsi que des marches qui se trouvaient derrière elle. Disons tout de suite que le résultat esthétique n’est pas enthousiasmant. Mais sur la “beauté”, comme on le sait, quot capita tot sententiae. Un adage qui vaut moins, cependant, sur le plan historique, donc philologique. A la fois parce que ce fragment de colonnade et ces marches telles que nous les voyons aujourd’hui n’ont jamais existé. Et surtout parce que non seulement Rome, mais toute l’Italie regorge de temples, de forums, de colonnes honorifiques, de théâtres et de toutes les autres ruines antiques sur le sol. Que faire alors ? Les reconstruire comme s’ils n’avaient jamais existé et se moquer ainsi de l’Italie du Grand Tour, celle de Richardson, de Goethe ou de Forster, pour ne citer qu’eux ? Et avec eux, se moque-t-on aussi de la Rome “quam magna fueris integra, fracta doces” dont parlait Ildeberto de Lavardin il y a plus de mille ans, ou de celle de Poggio Bracciolini “De fortunae varietate urbis Romae et de ruina eiusdem descriptio”, et nous voici dans les années 1430 ? En sommes-nous également réduits à écrire qu’Apollodore de Damas était l’“archistar” de Trajan ? Des questions que je transmettrai volontiers, d’abord à l’ancien maire de Rome Marino qui, dit-on, face à l’énorme somme d’un million et demi d’euros que lui avait donnée un oligarque russe proche de Poutine, est à l’origine de tout cela, puis à l’ancien ministre Franceschini dont “l’économie” a été la principale source de revenus de la ville.l’ancien ministre Franceschini, dont l’“économie de la billetterie” plane à l’horizon du “simulacre philologique de Disneyland” que nous venons de décrire, et les questions que je pose s’adressent également à l’actuel maire Gualtieri et au nouveau ministre Sangiuliano.
Enfin, pour eux et pour les lecteurs de “Finestre sull’Arte”, j’ajoute un texte de 1981 de Giovanni Urbani dans lequel il parle également du Colisée, afin que nous puissions comprendre qu’il y a déjà quarante ans, quelqu’un nous a dit, sans être écouté, que la préservation du patrimoine historique et artistique de l’Italie et des Italiens était une question sérieuse.

 Basilique Ulpia
Basilique UlpiaLa science et l’art de la conservation du patrimoine culturel, par Giovanni Urbani (1981)
(dans G. Urbani, Intorno al restauro, Milan, Skira, 2000, pp. 43-48)
Je crois qu’en assignant le thème “science et art de la conservation” à mon intervention, on a voulu me faire réfléchir sur la nature des rapports qui, dans l’état actuel de l’activité de conservation, existent entre les trois sujets qui ont voix au chapitre: le scientifique, l’historien et le technicien de la restauration.
Je dirais que ces relations sont plutôt bonnes, mais qu’elles seraient bien meilleures si chacun des trois sujets était libéré une fois pour toutes du doute de jouer un rôle instrumental par rapport aux deux autres, ou plutôt de la tentation de leur assigner ce même rôle.
Pour donner quelques exemples: je ne pense pas que l’archéologie ait beaucoup à gagner des ’sciences subsidiaires’ susmentionnées, qui ne sont en fait que des instruments d’analyse ou de mesure, tels que la thermoluminescence ou le carbone 14, conçus pour des besoins tout à fait différents et dont l’application au domaine de l’archéologie n’a été trouvée que par une heureuse coïncidence. D’autre part, l’application de ces instruments à l’archéologie a peut-être profité à leurs fabricants, mais elle n’a certainement pas entraîné de progrès substantiels pour les sciences dans le domaine desquelles ces instruments ont été conçus et produits. Il en va à peu près de même pour la généralité des techniques d’investigation qui sont applicables aujourd’hui dans le domaine qui nous intéresse. En dehors de la satisfaction légitime que peuvent en retirer les chercheurs qui ont été les premiers à expérimenter le nouveau type d’utilisation, et bien sûr en dehors du bénéfice des solutions ainsi apportées à certains de nos problèmes, il s’agit en tout état de cause de contributions à sens unique, si l’on peut dire, qui non seulement ne se traduisent pas par un progrès, mais se traduisent par une amélioration de la qualité de la vie. non seulement elles ne se traduisent pas par des progrès dans la recherche fondamentale chimique ou physique, ce qui serait peut-être trop demander, mais elles ne parviennent pas non plus à déterminer les conditions de la naissance d’une discipline scientifique autonome, comme nous avons longtemps rêvé que la recherche conservatrice puisse l’être.
Il ne s’agit donc certainement pas d’abandonner la partie, mais seulement de prendre conscience des limites de l’apport que l’on peut attendre des sciences expérimentales, tant que l’on ne peut leur assigner qu’une fonction instrumentale ou subsidiaire.
Sur le plan des relations de travail, cette situation conduit à une certaine difficulté de dialogue entre spécialistes du patrimoine culturel et scientifiques.
Après avoir convenu que l’objectif commun est la conservation matérielle de l’œuvre d’art, il est immédiatement demandé au scientifique de ne pas s’intéresser à l’œuvre d’art en tant que telle, mais au pur agrégat de matière qui la compose. Il en résulte que le scientifique, une fois passé le moment gratifiant de s’asseoir pour consulter l’objet célèbre et, pour lui, insolite, n’a plus qu’à retourner dans son laboratoire pour vérifier si, sur cet agrégat de matière particulier, il est possible de répéter le type d’expériences auxquelles il est habitué, mais cette fois-ci, avec la réserve mentale que la connaissance que l’on a de l’œuvre d’art et de la conservation matérielle de l’œuvre d’art n’a pas d’importance pour lui. avec la réserve mentale que les connaissances acquises n’épuisent pas, comme il est d’usage dans son travail, la réalité ultime de l’objet d’investigation, qui reste réservée aux réflexions de l’humaniste et aux manipulations du restaurateur.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le scientifique, après avoir fait l’expérience et l’avoir répétée plusieurs fois, soit de moins en moins enclin à un travail dont il n’attend plus de changements substantiels dans la manière dont la conservation des œuvres d’art est conçue et mise en pratique par les historiens et les restaurateurs.
Pour changer cette situation et faire en sorte que le scientifique ne joue pas seulement un rôle instrumental et subsidiaire, il serait évidemment nécessaire qu’il soit tenu pour responsable, comme l’historien et le restaurateur, de la réalité ultime de l’œuvre d’art, c’est-à-dire de l’œuvre d’art en tant que telle et non pas seulement de ses matériaux constitutifs.
Il ne s’agit certainement pas de dire que le scientifique doit se transformer en historien de l’art ou en restaurateur. Les exemples d’une telle polyvalence, heureusement assez rares, n’ont jusqu’à présent abouti qu’à des résultats d’un amateurisme peut-être civilisé, mais très peu utile. L’implication du scientifique devrait plutôt se faire à un niveau qui est commun aux deux autres spécialistes, mais qui, curieusement, ne semble pas jusqu’à présent avoir suscité l’attention qu’il mérite de la part de l’une ou l’autre des parties concernées.
Je veux parler du concept d’“état de conservation”, c’est-à-dire de quelque chose qui devrait constituer le moment central d’une réflexion menée sur une activité qualifiée de conservation, et qui pourtant est encore si approfondi qu’il ne peut être traduit qu’en français. qu’il ne peut se traduire que par des critères de jugement totalement subjectifs et invérifiables, comme c’est le cas lorsqu’on dit d’une œuvre d’art que son état de conservation est bon, médiocre ou mauvais.
Certains objecteront que ce sont les historiens et les restaurateurs qui se contentent de ce type de jugement, alors que le scientifique qui caractérise l’état chimique ou physique de certains échantillons des matériaux qui composent l’œuvre d’art, atteint précisément cette objectivité et cette précision de jugement dont nous déplorons l’absence. Or, nous ne pouvons juger de l’état de conservation de chaque produit ou artefact qu’avec précision par rapport à la fonction particulière que les produits et artefacts sont appelés à remplir, et qu’ils remplissent plus ou moins bien précisément selon leur état de conservation matérielle. Mais alors, s’il est incontestable que, du moins du point de vue de notre époque historique, la fonction première de l’œuvre d’art est de stimuler notre sensibilité esthétique, il est à craindre que le jugement du scientifique sur l’état de conservation des matériaux constitutifs de l’œuvre d’art ne soit pas plus précis que celui du scientifique sur l’état de conservation des matériaux constitutifs de l’œuvre d’art.Il est à craindre que le jugement du scientifique sur l’état de conservation des matériaux constitutifs de l’oeuvre d’art soit totalement inutilisable, non seulement par l’historien et le restaurateur, mais par le scientifique lui-même qui, après avoir examiné ses échantillons, retourne à l’oeuvre d’art pour vérifier si l’état de détérioration plus ou moins avancé des matériaux examinés se traduit par une capacité plus ou moins grande de l’oeuvre à remplir sa fonction de stimulation de la sensibilité esthétique.
Le risque existe non seulement que l’état du matériau, constaté en laboratoire, ne trouve pas de correspondance dans l’état de l’oeuvre d’art constaté de visu avec le sentiment esthétique, mais même qu’à un degré extrême de détérioration du matériau corresponde un épanouissement maximal du potentiel esthétique de l’oeuvre.
Je donne l’exemple d’un Renoir qui devrait encore se trouver dans les dépôts du Museum of Modern Art de New York, posé à plat, comme je l’ai vu il y a presque trente ans, au fond d’un grand carton que l’on ouvrait avec mille précautions et qui retenait presque son souffle, suscitant à chaque fois chez le spectateur une émotion esthétique qui allait bien au-delà de celle, pourtant considérable, qu’aurait suscitée n’importe quel autre Renoir. En effet, une dizaine d’années plus tôt, la maison du propriétaire du Renoir avait été pratiquement détruite par un incendie, dont les flammes avaient judicieusement évité d’atteindre le tableau, qui avait d’ailleurs été réduit en cendres par la chaleur, tout en restant aussi lisible que du Renoir. Un Renoir unique en effet, compte tenu des circonstances, et donc en quelque sorte admirable au-dessus de la moyenne.
Question: quel est le rapport, dans un tel cas, entre la fonctionnalité propre de l’œuvre d’art et l’état de conservation de ses matériaux ? Il ne s’agit pas d’un paradoxe mais plutôt d’une règle, si l’on considère que l’on peut se poser la même question face à quelque chose de beaucoup moins rare et inhabituel comme une ruine. Prenons le cas du Colisée: n’importe qui est en mesure de juger que son état de conservation est mauvais ; cependant, personne ne serait en mesure de nous dire si et dans quelle mesure notre compréhension du Colisée en tant que témoignage historique et en tant qu’œuvre d’art est compromise par ce mauvais état de conservation. On pourrait même dire que, pour notre compréhension historique et esthétique du monument, il serait sans importance qu’il perde soudainement deux ou dix de ses arches, voire qu’il s’effondre complètement.
Mais dans ce cas, à quoi sert le rituel selon lequel, dès que l’archéologue constate qu’une pierre du Colisée s’est effondrée, il s’adresse au chimiste pour qu’il analyse les produits de la détérioration, et au restaurateur pour qu’il rattache d’une manière ou d’une autre la pierre à la partie dont elle s’est détachée ?
Supposons que l’archéologue soit sérieusement décidé à tirer des conclusions des résultats de l’analyse, en vue de confier au restaurateur une mission un peu plus exigeante que le simple recollage de la pierre, disons même une mission de restauration de l’ensemble du Colisée. Comment mettra-t-il en relation l’état de sulfatation de la pierre, et combien d’autres résultats de recherches pourra-t-il obtenir auprès de géologues, d’ingénieurs structurels, etc., avec un projet global de restauration qui ne se résumera pas à une simple cosmétique superficielle du monument, mais qui parviendra à ralentir son processus naturel de détérioration dans une mesure strictement définie ?
Nous ne pouvons pas éluder le problème en nous disant qu’une telle décision de la part d’un archéologue est une éventualité hautement improbable en raison du manque de fonds, de l’inertie des administrations, etc. Reconnaissons plutôt que c’est le type de relation que nous entretenons avec les monuments du passé, c’est-à-dire la relation fondée, comme je l’ai déjà dit, sur la connaissance historique et la jouissance esthétique, qui nous rend, sinon satisfaits du mauvais état du Colisée, du moins incapables de planifier et de mettre en œuvre sa conservation efficace. Car cela impliquerait sans aucun doute des changements substantiels dans l’aspect et l’utilisation actuels du Colisée, des changements qui ne sont pas requis, et peut-être même redoutés comme “déformants”, par le type de considération historico-esthétique dans laquelle nous tenons l’art du passé. Et pourtant, de quoi dépend-il si, de la part de tous, y compris des archéologues et des historiens de l’art, la nécessité d’assurer la “conservation matérielle” de l’art du passé se fait de plus en plus sentir ?
Nous ne pouvons pas penser qu’il s’agit d’un impératif catégorique, sans rapport avec ce que l’art du passé représente dans notre conception de l’histoire humaine. Disons plutôt que dans notre conception de l’histoire humaine, au moment où l’homme commence à percevoir la terrible nouveauté historique de l’épuisement de son milieu de vie, certaines valeurs, comme l’art du passé, témoignent de la possibilité que la création humaine est intégrative et non destructrice de la beauté du monde, commencent à prendre, à côté de la dimension cognitive des objets d’étude ou de jouissance esthétique, la nouvelle dimension des composantes anthropiques de l’environnement, tout aussi nécessaires, pour le bien-être de l’espèce, de l’équilibre écologique entre les composantes naturelles de l’environnement.
Si tel est le cas, comme je le crois, il est tout à fait compréhensible que, même s’il n’a aucune pertinence en termes de compréhension historique et de plaisir esthétique, le mauvais état de nos monuments suscite en nous la même appréhension et le même désir de récupération que ceux que nous ressentons face à une nature dévastée. De même qu’il est compréhensible que, face à la dégradation de nos villes, il nous devienne intolérable que ce soient les monuments eux-mêmes qui semblent “tirer les ficelles” du processus toujours plus rapide de détérioration de l’environnement urbain, à savoir les valeurs dans lesquelles, par ailleurs, nous reconnaissons les conditions premières d’une vie urbaine à l’échelle humaine. Une reconnaissance qui, à l’évidence, ne peut plus se contenter de prendre acte du monument, pour ainsi dire, à distance, c’est-à-dire comme objet d’étude ou de contemplation esthétique, mais doit s’efforcer de le ramener dans la dimension d’un objet d’expérience réelle, c’est-à-dire dans la dimension d’un produit encore ouvert à la fabrication humaine, sur lequel, c’est-à-dire avec des actions nécessairement nouvelles et différentes, nous pouvons retrouver et répéter l’expérience de la seule forme d’activité qui n’a jamais dévasté le monde: l’activité créatrice.
En d’autres temps, lorsque l’expérience de l’activité créatrice imprégnait presque tous les aspects de la vie de la communauté et prenait ainsi forme non seulement dans le grand monument artistique, mais dans l’organisme entier de la ville, la conservation du produit créatif pouvait être mise en œuvre comme un processus vital: avec la substitution spontanée de nouveaux produits créatifs à ceux qui étaient usés par le temps ou, en tout cas, hors d’usage.
La conservation que nous pouvons mettre en œuvre ne peut malheureusement pas s’appuyer sur cette capacité d’auto-régénération, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas se faire par la création de nouvelles œuvres d’art, mais seulement par l’entretien indéfini des œuvres existantes. Nous sommes dans l’évidence. Mais il devrait être tout aussi évident que nous nous assignons ainsi une tâche strictement inexécutable ou en tout cas limitée dans le temps, puisque c’est une loi indéfectible de la thermodynamique que rien ne peut se conserver indéfiniment. Le choix est alors entre deux processus de changement différents: un changement qui est de toute façon dans la force des choses, et qui tôt ou tard aboutira nécessairement à la disparition de ce que nous aurions voulu conserver ; ou un changement qui est le produit d’une conservation enfin effective, c’est-à-dire capable de répéter l’expérience créatrice du passé non pas en termes de création artistique, qui nous est définitivement interdite, mais en termes d’imagination scientifique et d’innovation technique.
Reprenons le cas du Colisée. L’improbable décision de tenter sa restauration se heurterait aujourd’hui de toute façon à deux obstacles insurmontables: notre incapacité à rendre compte objectivement de son état de conservation, et donc l’incongruité d’une intervention, quelle qu’elle soit, qui prétendrait réparer un état de conservation indéfini.
Tout porte donc à croire que si la science a un service à rendre à la restauration, ce service est de clarifier ce qu’il faut entendre par état de conservation. Si la vitesse à laquelle les galaxies s’éloignent à des millions d’années-lumière est mesurable, de même que, à l’extrême opposé, la demi-vie de la radioactivité d’un matériau, on voit mal pourquoi la vitesse à laquelle le Colisée se dégrade, le rythme auquel l’informe l’emporte sur la forme, ne serait pas mesurable. Mesure anormale s’il en est, puisqu’il s’agit de se référer “en quelque sorte” à ce qui, dans l’œuvre, ne fait pas l’objet d’un calcul rationnel: la qualité artistique. En effet, il est facile d’imaginer, toujours dans le cas du Colisée, combien cette qualité serait peu affectée par la perte de tonnes de matériaux, et au contraire l’effet dévastateur d’une fissure, aussi petite soit-elle, s’ouvrant sur une statue de Michel-Ange (avec la variante supplémentaire de l’entité de l’infraction: si elle a été causée à un visage ou à une draperie...).
Mais il faut aussi se demander si ces difficultés conceptuelles suffisent à contrecarrer l’hypothèse d’une mesure prise sur l’état de conservation et la vitesse de dégradation, alors que la science commence à peine à s’intéresser à l’informe et au chaos. Nous disons donc que la solution au problème de la conservation doit être recherchée dans ce nouveau champ de spéculation théorique. Un effort qui, en termes d’imagination créatrice, ne serait rien de moins que celui de l’art du passé, enfin conservé de la seule manière qui compte: comme la matrice d’une expérience renouvelée de création, et non plus seulement comme un objet d’étude et de contemplation esthétique. Un objet qui ne peut certes pas être aboli ou réformé par l’innovation scientifique, mais auquel celle-ci parviendrait peut-être à ajouter ce que l’étude et la contemplation ne parviennent pas à assurer: l’intégration matérielle du passé dans le devenir de l’homme et les soucis que lui impose son être au monde.
Avertissement : la traduction en anglais de l'article italien original a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.