À Naples, dans le complexe de Santa Maria La Nova, un mystère vieux de cinq siècles a attiré l’attention des chercheurs (et aussi des médias) : la possible sépulture de Vlad III de Valachie, le prince que la légende a transformé en Dracula. L’enquête est menée par Giuseppe Reale, directeur du complexe et consultant, qui coordonne depuis plus de dix ans un groupe de chercheurs en archéologie, philologie et philosophie de la mémoire. L’étude est partie d’une dalle funéraire du XVIe siècle avec un dragon, qui a suggéré des liens avec la famille Ferillo et Maria Balsa, peut-être la fille ou la petite-fille du voïvode de Valachie. En 2014, le Codex La Nova a été découvert, une inscription interprétée comme un possible éloge de “Vlad le Pieux”. Santa Maria La Nova devient ainsi un lieu d’étude et de réflexion sur le mystère de l’histoire. L’entretien avec le directeur est l’occasion d’explorer les études et les recherches menées au sein du complexe.
NC. M. le directeur, devant une dalle qui a gardé son secret pendant cinq siècles, que signifie aujourd’hui le fait de déclarer que la sépulture de Vlad III, le prince que le mythe a ensuite transformé en Dracula, pourrait se trouver à Naples ?
GR. La dalle du monument funéraire de Matteo Ferillo n’indique pas le lieu de sa sépulture. Il s’agit plutôt d’un élément symbolique. En 2014, l’image du grand dragon sculptée sur ce monument de marbre, situé dans le cloître de San Giacomo, a donné lieu à une enquête qui a stimulé de nouvelles réflexions et recherches. Quoi qu’il en soit, nous avons quelques certitudes, acquises depuis plusieurs années. La tombe de Ferillo, comme d’autres, ne se trouvait pas à l’origine dans le cloître, mais à l’intérieur de l’église. En effet, un document récemment consulté confirme que la chapelle de Ferillo était située à côté du maître-autel, où elle est vraisemblablement restée jusqu’en 1588. Il est donc nécessaire de distinguer la dimension symbolique et imaginative de l’histoire (qui continue d’exercer une grande fascination), des preuves historiques que nous consolidons progressivement. Les sépultures de Santa Maria La Nova, comme celles de nombreuses autres églises jusqu’au début du XIXe siècle, se trouvaient pour la plupart dans des chambres funéraires souterraines. Les chapelles gentilices, les mausolées et les monuments funéraires représentaient un récit figuratif pour les fidèles, tandis que les corps étaient enterrés sous le dallage, selon diverses techniques d’inhumation. C’est également le cas à Santa Maria La Nova, où cette pratique est aujourd’hui documentée. Par ailleurs, le monument de Matteo Ferillo a permis de retracer des liens importants entre l’église de Santa Maria La Nova et la crypte de Giacomo Alfonso Ferillo et de son épouse Maria Balscia, située dans la cathédrale d’Acerenza. À partir de là, il a été possible de développer des liens plus larges entre Naples, Acerenza et les territoires de Valachie, y compris par l’étude d’autres sépultures. Parmi celles-ci, l’une des plus discutées est celle de Constantine Castriota Skanderbeg, aujourd’hui également située dans le cloître de San Giacomo, mais à l’origine placée dans la partie inférieure du chœur. Les monuments évoquent donc des présences et des histoires que la recherche historique continue d’interroger. C’est sur ce lien de symboles, de documents et d’hypothèses que s’est développée une décennie d’études visant à reconstituer des parcours et des relations encore mystérieux.

Quand et comment est née l’idée d’étudier scientifiquement les sépultures et les fragments que vous avez analysés ?
En partant des liens géographiques entre le Royaume de Naples, l’Ordre du Dragon et la péninsule balkanique, nous nous sommes posé une série de questions. Des questions qui ont été combinées à l’analyse d’un riche symbolisme, typique des monuments qui appartiennent à une longue tradition historico-artistique. Un symbolisme qui, pour ceux qui vivent dans des contextes culturels différents, exige un travail de décodage complexe et fascinant. Lors des premières inspections, qui ont débuté en 2014, j’ai observé certains éléments qui méritaient l’attention. Je me souviens avoir été frappé par une inscription placée dans une chapelle adjacente au monument de Matteo Ferillo. Je savais déjà que le sépulcre, aussi suggestif soit-il, ne se trouvait pas à cet endroit : une inscription sur le monument lui-même indiquait qu’il avait été placé à l’origine dans le sanctuaire dédié à la Vierge de l’Assomption. J’ai donc commencé à rechercher des emplacements possibles et, au cours de ces recherches, je suis tombé sur une autre inscription dans la chapelle de Turbolo, une chapelle aristocratique située presque derrière l’emplacement actuel du monument de Ferillo. En consultant le Guide de Santa Maria La Nova écrit en 1927 par le père Gaetano Rocco, un franciscain, j’ai découvert qu’il décrivait cette inscription comme une “pierre tombale en marbre” traduisant en grec une bulle papale latine de Grégoire XIII. Cette déclaration m’a incité à réfléchir. Premièrement, l’inscription n’était pas du tout en marbre, mais peinte ; deuxièmement, il ne s’agissait pas d’un véritable texte grec, mais d’une séquence de signes discontinus, qui ne pouvaient être attribués à une grammaire ou à une syntaxe unique. Je me suis donc demandé pourquoi le père Gaetano l’avait décrit ainsi et pourquoi les études ultérieures s’étaient contentées de reprendre son interprétation sans la vérifier directement. Une simple comparaison visuelle avec la bulle papale de Grégoire XIII de 1576 a clairement montré l’incohérence : le texte latin de la bulle était beaucoup plus grand que les lignes de l’inscription de la chapelle. Cette observation m’a fait comprendre que quelque chose de plus complexe se cachait. C’est ainsi qu’est née l’idée de ce que nous avons appelé plus tard le “codex La Nova”. Fait curieux, l’inscription a survécu aux nombreuses transformations de la grande chapelle dédiée à saint Jacques des Marches, à l’intérieur de laquelle se trouve la chapelle de Turbolo. En effet, à la fin du XVe siècle, le vice-roi espagnol a transformé une église préexistante en un grand espace de culte et de sépulture dédié à saint Jacques, mort en 1476. Malgré les changements ultérieurs, l’inscription est restée visible, bien que partiellement dégradée et, comme on le voit dans la restauration de 2018, camouflée dans le cadre comme s’il s’agissait d’une plaque de marbre. Après la restauration, j’ai invité l’ingénieur Falcucci à l’examiner et, bien qu’il ne soit pas membre de notre groupe d’étude, il a d’abord émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’une inscription de la fin du XIXe siècle. Cependant, les analyses ultérieures ont abouti à des conclusions différentes. Il n’y avait pas de différence de mortier entre la partie inscrite, le cadre et les fresques environnantes, qui peuvent être datées du début du XVIe siècle, ce qui suggère une construction coïncidente. Par ailleurs, l’examen des pigments prélevés sur le cadre et les lettres a montré que la couleur des lettres était deux à trois fois plus épaisse, signe d’une datation plus ancienne que celle du XIXe siècle supposée à l’origine. Il a donc été possible d’antidater l’inscription et de la situer non pas au XIXe siècle, mais plus près de 1575, année du tombeau de la famille Turbolo. Cela a permis d’exclure tout lien avec la bulle papale de 1576 et de reconnaître le codex La Nova comme un document autonome et plus ancien. À certains endroits du texte, le nom “Vlad” apparaissait clairement, ce qui rendait la recherche encore plus intéressante. J’ai ensuite invité des experts en linguistique d’Europe de l’Est à consulter l’inscription. Chacun d’entre eux a pu reconnaître des fragments, mais aucun n’a pu donner une lecture complète. Le potentiel narratif et symbolique de la figure de Dracula tend à occulter la complexité historique de Vlad III, le véritable personnage. Notre objectif était précisément de séparer la légende du fait historique, en libérant Vlad III de l’ombre littéraire de Dracula. Dans les années suivantes, grâce à une équipe de chercheurs roumains, la recherche a fait un bond en avant. Leur contribution, enracinée dans leur connaissance de la culture et du symbolisme nationaux, nous a permis de transformer nos questions en hypothèses historiques plus solides, renforçant les liens entre Naples, la Valachie et l’Ordre du Dragon.
L’éloge funèbre mentionne un souverain, Vlad le Pieux, qui a été “tué deux fois” et “honoré comme un martyr”. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? En quoi ce concept renforce-t-il l’identification à Vlad III par rapport à d’autres figures possibles de l’époque ?
Pendant dix ans, de nombreux chercheurs ont tenté de déchiffrer l’inscription. Tout a commencé par un appel international en 2014 : une discussion ouverte d’où est ressorti un fait curieux, à savoir que personne ne pouvait reconnaître les caractéristiques d’une langue connue dans ce texte. Il n’appartenait à aucune langue classique ni aux langues “archéologiques” qui transmettent la mémoire des anciennes civilisations. Le travail s’est donc fait par exclusion plutôt que par affirmation. À ce stade, de jeunes chercheurs ont également été impliqués dans l’expérimentation des techniques de décodage informatique. L’idée n’était d’ailleurs pas nouvelle : dans les mêmes années, un chercheur italien aux États-Unis avait utilisé des systèmes similaires pour déchiffrer un ancien texte aragonais. Nous allions donc dans la même direction, à la recherche d’une méthode capable de révéler le sens caché de ce code. La collaboration de Mircea Cosma, directeur de la Société historique de Ploiești, en Roumanie, a marqué un tournant. Mircea travaillait avec Christian Tufan, expert en grec byzantin, et dès les premiers échanges, Cosma avait anticipé quelques hypothèses de lecture, encore fragmentaires. Le véritable tournant se produit le 28 juin 2025, lors d’une rencontre à Snagov, l’un des lieux traditionnellement associés à la figure de Vlad III. À cette occasion, Tufan a présenté publiquement une proposition d’interprétation complète de l’inscription, accompagnée d’une translittération en grec et d’une traduction en roumain, que j’ai ensuite traduite en italien. Il a signé et assumé la responsabilité scientifique de la lecture, que nous avons publiée dans le volume Vlad, où es-tu ? Clues from the La Nova Codex of Naples, publié par La Valle del Tempo. Le livre rassemble les contributions de tous les participants au projet et documente la longue recherche qui a abouti à cette proposition interprétative. Selon Christian Tufan, l’inscription est construite sur trois niveaux linguistiques qui se chevauchent. Le niveau de pleine signification, celui du bas, est en grec byzantin et donne un texte d’une étonnante cohérence : c’est un éloge funèbre qui se termine par une invocation. Il contient des références explicites à Vlad, défini comme “prince de Valachie”, mais non identifié comme Vlad Țepeș, l’empaleur, mais comme Vlad le Pieux, “celui qui est mort deux fois”. La formule a donc un poids particulier : d’une part, elle évoque la vénération réservée à un martyr et, d’autre part, elle fait allusion à une double mort, ce qui suggère que les dates traditionnelles, décembre 1476 ou janvier 1477, doivent être dépassées. On sait que la dépouille de Vlad III n’a jamais été retrouvée. Les deux tombes roumaines de Snagov et de Comana, qui lui ont été attribuées, n’ont pas livré de restes humains pouvant être attribués au voïvode. Comme le rappelle l’historienne Carmen Bejanaru dans son livre, la tombe de Snagov a été ouverte en 1933 et ne contenait que des ossements de chevaux ; le même résultat a été obtenu à Comana, un monastère fondé par le voïvode. Aujourd’hui, notre équipe de recherche poursuit ses investigations, y compris une mission à Istanbul, où nous espérons consulter des documents relatifs aux campagnes militaires ottomanes. À ce jour, aucune archive n’atteste de l’existence du prétendu scalp de Vlad, qui, selon la tradition, aurait été offert au sultan comme trophée de guerre. Pour renforcer l’hypothèse de sa survie au-delà de 1477, Mircea Cosma a trouvé une lettre, publiée dans les Annales roumaines, dans laquelle un citoyen de Krems, près de Vienne, déclare avoir vu Vlad en 1477, toujours à la tête d’une armée. L’inscription de Santa Maria La Nova donne également une date précise de décès : le 20 novembre 1480. Cette date est importante, car elle coïncide avec la période du siège d’Otrante, qui a commencé le 14 août de la même année et s’est terminé par le massacre des 800 martyrs qui ont refusé d’abjurer la foi chrétienne. Le 16 septembre 1480, le pape Sixte IV et le roi de Naples appellent à une ligue militaire pour repousser l’invasion turque. Je pense qu’il existe des liens directs entre la campagne d’Otrante et la présence de Vlad III dans le royaume de Naples. Ce fut le point de départ, en 2014, de notre étude sur la relation entre Giacomo Alfonso Ferillo, fils de Matteo, et son épouse Maria Balscia, qui sont enterrés à Acerenza, où la crypte est décorée de motifs de dragons. Ces mêmes dragons, symboles de l’Ordre du Dragon, représentent le fil qui relie Vlad, la famille Ferillo et l’église de Santa Maria La Nova. L’inscription, interprétée aujourd’hui à la lumière de ces liens, suggère que Vlad est mort dans le royaume de Naples, dans un contexte de bataille, “tué deux fois par ses ennemis”, comme l’indique le texte. Deux autres indices artistiques renforcent l’hypothèse d’une sépulture à Santa Maria La Nova. Le premier concerne la présence, au pied de l’autel, de Jeanne III de Trastámara, lieutenant militaire engagé aux côtés de son mari puis de son beau-fils, enterré là en 1518. Le second indice est symbolique : dans la même église repose en effet Hamida, fils du dernier souverain de Tunis, qui fut fait prisonnier puis converti au christianisme sous la conduite spirituelle de Jean d’Autriche, commandant de la Sainte Ligue qui vainquit les Turcs à Lépante en 1571. Le grand plafond en bois de la nef, avec ses quarante-sept toiles de la fin du XVIe siècle dédiées à la Vierge de l’Assomption, a été précisément financé par cette famille convertie à l’islam. Il est révélateur que le cycle pictural rende hommage au rôle des femmes dans l’histoire du salut et, en même temps, à la victoire chrétienne sur l’islam, symbolisée par un croissant inversé dans les armoiries de Jean d’Autriche. Comme si Santa Maria La Nova avait assumé, au fil des siècles, la fonction de panthéon du christianisme militant, dépositaire de la mémoire de souverains, de commandants et de dynasties unis par un fil conducteur : la lutte contre l’expansion ottomane. Dans cette perspective, la présence de Vlad III, chevalier de l’Ordre du Dragon et prince engagé dans la défense de l’Europe chrétienne, prend tout son sens. L’église napolitaine se présente ainsi comme la dernière pièce d’un récit qui relie Otrante et Lépante, 1480 et 1571, dans une longue histoire de foi, de guerre et de mémoire.
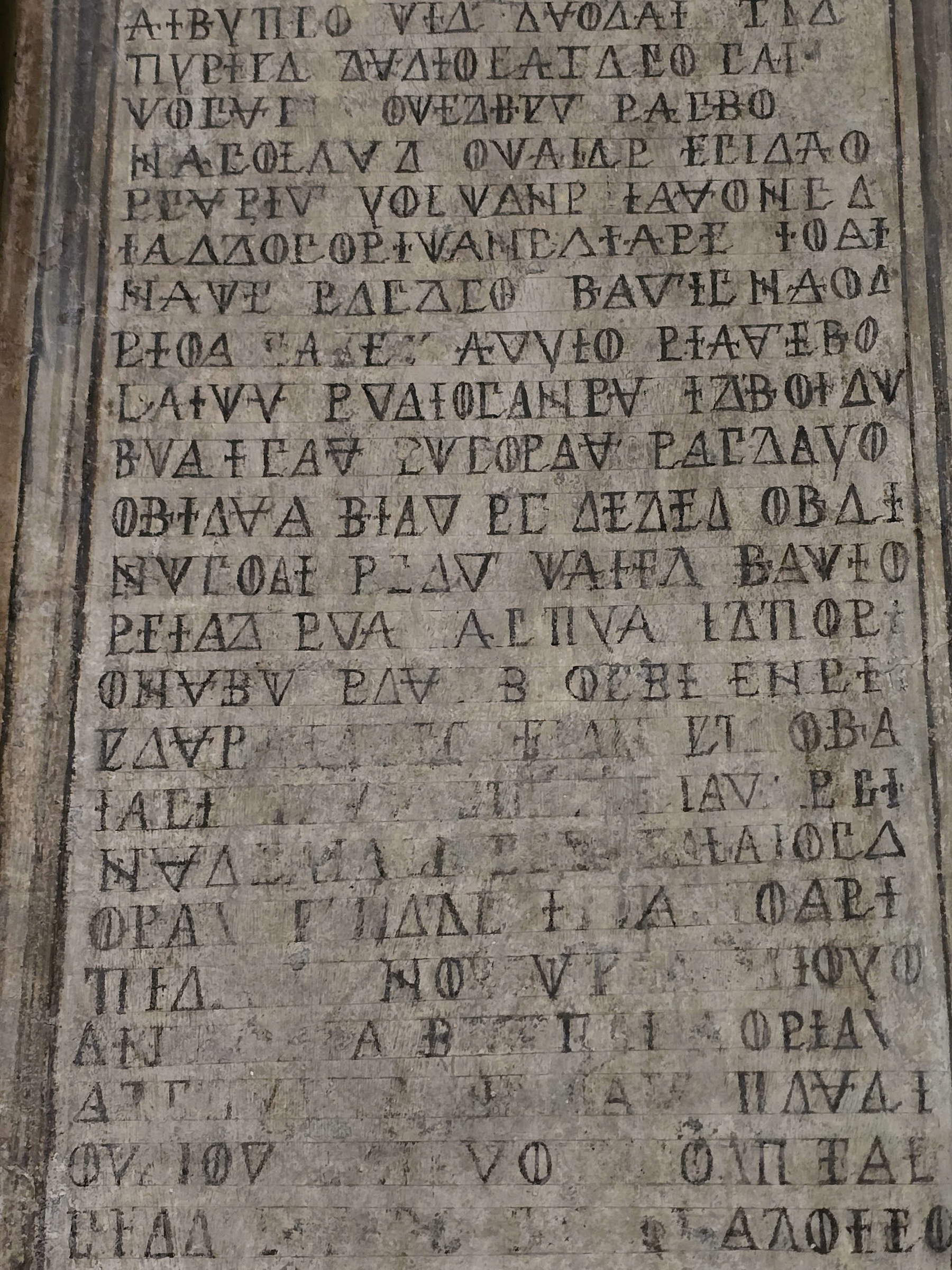

Un élément que je trouve intéressant est la datation entre 1480 et 1490, liée à la figure de Maria Balsa, que l’on pense être la fille ou la nièce de Vlad. Quelle importance la présence féminine à Naples a-t-elle eue dans la reconstruction du tableau historique ?
Maria Balsa est configurée comme une figure évoluant sur deux niveaux temporels. Le premier concerne son lien avec Giacomo Alfonso Ferillo, comme en témoigne la crypte d’Acerenza. Dans cette dimension, l’art prend une fonction cognitive et l’esthétique devient ici un moyen de compréhension. La crypte, avec son symbolisme draculéen, soulève des questions précises : Maria était-elle une noble albanaise selon certaines Balsiques, ou venait-elle d’une principauté que nous identifierions aujourd’hui comme roumaine ? Au total, Maria Balsa a servi de pont entre la péninsule balkanique, marquée par les persécutions, et l’Italie du Sud, en particulier Acerenza et Naples, où elle est arrivée par son mariage avec Giacomo Alfonso Ferillo. Leurs deux filles, Béatrice et Isabella, s’intègrent ensuite dans cette reconstruction historique, ce qui lui donne encore plus d’importance. Par la suite, des recherches ont tenté de clarifier son rôle à travers une chronique du XVIe siècle, bien qu’il existe plusieurs interprétations alternatives. Selon l’une d’entre elles, Maria aurait été amenée à Naples par Constantin Castriota Skanderbeg, le futur évêque d’Isernia, qui est également enterré à Santa Maria la Nova. Le monument funéraire qui lui a été dédié par Andronica Comneno porte une inscription énigmatique : “Maria”, sans aucune référence à Santa Maria. Ces éléments de preuve ont donc suscité des interrogations. Comment une orpheline arrivée à Naples sous la tutelle de Skanderbeg a-t-elle pu être acceptée à la cour des Ferillo et épouser ensuite Jacques Alfonso Ferillo ? L’hypothèse initiale envisageait la possibilité que Maria ait emporté avec elle la dépouille de son père, mais aujourd’hui l’interprétation de l’inscription permet de comprendre ces mouvements de manière autonome, en considérant les migrations indépendamment des lieux de contact. Si le lien avec Santa Maria la Nova, où se trouvent les tombes des Ferillo et de Constantin Castriota Skanderbeg, est évident, des affinités historiques apparaissent, qui brossent un tableau intéressant et complexe. Les recherches actuelles portent sur les origines nobles de Maria Balsa : des collègues historiens roumains acquièrent des documents qui plongent dans la crypte d’Acerenza et dans les territoires de l’actuelle Roumanie, en essayant de clarifier avec précision les origines de Maria Balsa.
Que signifie pour Naples de pouvoir exposer un document épigraphique sur Vlad l’Empaleur aussi explicite que pertinent ?
Naples reste encore aujourd’hui une capitale. C’est une capitale de carrefours, de croisements, un carrefour où se rencontrent et s’entrecroisent des réalités différentes. Le fait même qu’un code ait pu se perpétuer, à une époque où l’on démolissait les grandes basiliques et les cathédrales pour en construire de nouvelles, démontre l’originalité de la ville. À l’époque, il n’existait pas de science de la conservation telle que nous l’avons développée plus récemment. Un exemple pertinent est l’inscription grecque conservée à Naples : bien que codifiée, elle reste un signe nativement grec, ce qui témoigne de la capacité de la ville à maintenir ensemble des mondes et des cultures différents, en les hybridant plutôt qu’en les supprimant. La grammaire même de Naples, aussi stratifiée que son histoire, témoigne de cette aptitude : relier plutôt qu’exclure, connecter plutôt que coloniser. La ville a également fonctionné comme un refuge. La présence de musulmans logés dans le quartier juif et de nobles en fuite confirme cette capacité d’inclusion. Naples montre, dans ses contradictions et ses stratifications, non seulement les traces d’une histoire longue et complexe, comme dans de nombreuses capitales, mais aussi une vocation à la rencontre et à la coexistence. Santa Maria L’Aquila en est un exemple concret : elle conserve des œuvres de la Renaissance napolitaine à côté de chefs-d’œuvre de l’époque baroque, incarnant parfaitement la stratification culturelle et historique de la ville.
Santa Maria La Nova est un lieu qui conserve des œuvres de la Renaissance napolitaine et de l’époque baroque. Quel impact touristique pensez-vous que la nouvelle interprétation de la dalle aura, et a-t-il déjà eu pendant ces mois d’été ?
Lorsque l’on aborde ce genre de questions, il est essentiel de distinguer l’aspect culturel de l’offre touristique. Le débat sur le tourisme a des significations spécifiques, et je ne pense pas que le Louvre doive s’excuser du fait que les visiteurs vont voir la Joconde. Il est vrai que des œuvres très connues peuvent éclipser d’autres créations, mais cela arrive régulièrement. La principale différence réside dans le temps et l’approche. Le tourisme se mesure souvent en quantité, en visites courtes et pressées, alors que la culture demande de l’attention, de la contemplation et de la sédimentation. En parcourant un grand musée, on peut se souvenir de peu de choses : la capacité de s’arrêter et d’approfondir est ce qui distingue l’expérience culturelle de l’expérience touristique. En même temps, les thèmes ont un grand potentiel de communication. Prenons l’exemple de Vlad III de Valachie : de nombreux visiteurs de Santa Maria la Nova arrivent intéressés par le mythe de Dracula. Analyser la fascination immortelle du personnage, c’est s’interroger sur la transposition du mal : en tant que symbole, Dracula allie cruauté et fascination, et sa fortune narrative, des romans gothiques à Twilight, montre comment le mal peut être représenté sous une forme sécularisée, permettant d’explorer les instincts les plus sombres qui sommeillent en chacun de nous. L’intérêt historique pour Vlad III a donc une explication, mais son impact communicatif va au-delà. Si les visiteurs arrivent attirés par le mythe, ils repartent souvent avec une compréhension plus large, entrant dans l’art de la fin du XVIe siècle et dans l’évolution picturale du XVIIe siècle à Naples. Santa Maria la Nova en est un exemple : incorporant la Torre Mastria et les anciens murs occidentaux de la ville, elle abrite des histoires et des œuvres allant de la Renaissance au baroque napolitain. L’histoire de Michelangelo Merisi s’inscrit également dans ce cadre. Pendant son séjour à Naples, il a séjourné à l’auberge de Cerriglio, au pied de la tour de défense, et a subi une attaque qui a failli le tuer. Dans le contexte du plafond de Santa Maria la Nova, achevé en 1609, et de sa relation avec Battistello Caracciolo, Caravage a rencontré une ville où l’innovation réaliste se mariait avec des visions de la fragilité et de la cruauté humaines, esquissant la révolution picturale que Naples a contribué à développer. Il est donc important d’associer, sans les confondre, l’expérience touristique et l’exploration culturelle. Le tourisme voyage, distribue l’intérêt, mais l’attention culturelle s’arrête, observe et comprend.
Suite à la découverte des inscriptions, des échanges culturels et des collaborations avec des organismes, des musées ou des fondations de Roumanie ont-ils déjà commencé ou est-il prévu de renforcer le lien historique entre Naples et la patrie de Vlad III ?
Des échanges de grande amitié et de collaboration culturelle existent avec la Roumanie. Je n’avais pas approfondi ces liens jusqu’à ce que je reçoive une invitation de Mircea Cosma à organiser une conférence en Roumanie. Je suis très serein sur le sujet, car les hypothèses de reconstitution que j’avance s’appuient notamment sur les études de deux historiens roumains, dont Cristian Tufan. Le fait que des universitaires locaux soutiennent ces thèses avec sérieux et rigueur est très important : pour nous, Vlad III est un personnage historique à redécouvrir parmi tous ceux qui caractérisent l’Italie aux mille visages, tandis que pour la Roumanie, il représente une figure nationale de premier plan. Je suis donc profondément reconnaissant et admiratif de leur honnêteté intellectuelle. Le chemin de recherche qu’ils ont entrepris provoque des discussions même sur leur propre territoire et a reçu une large couverture dans les médias et à la télévision roumaine. Pour eux, Vlad III fait partie d’une redécouverte des racines historiques et culturelles que de nombreux pays d’Europe de l’Est, libérés de l’expérience du socialisme réel après la chute du mur de Berlin, poursuivent en tant qu’élément central de leur identité nationale. Le fait que la Roumanie considère et mette à l’ordre du jour des enquêtes historiques de ce type témoigne d’une forte capacité à réécrire et à réinterpréter sa propre histoire avec rigueur et conscience.


Selon vous, comment communiquer au grand public la différence entre la réalité artistique documentée et la légende gothique de Dracula sans banaliser la découverte ?
La question n’est pas simple. Cet été, fin juin, j’étais encore à Snagov et Comana lorsque j’ai demandé à mes collègues de s’engager dans la publication de l’article. L’objectif était de fournir des outils approfondis, de créer une plateforme de référence et d’assumer la responsabilité de nos thèses. Le travail a été associé à d’autres contributions, comme le texte de Susi Bladi et un documentaire diffusé sur La7 (également disponible en mode rewind). Dans ces productions, Bladi nous a accompagnés dans notre recherche du tombeau de Vlad, en intégrant dans les dernières éditions des chapitres qui reprennent et approfondissent nos hypothèses. En résumé, nous avons produit deux instruments imprimés et une vidéo, présentant un approfondissement historico-scientifique, une médiation vulgarisatrice et une perspective documentaire également accessible aux non-spécialistes. Une fois par mois, nous organisons des visites guidées gratuites de Santa Maria la Nova, au cours desquelles je réponds aux questions des visiteurs, des plus courantes aux plus articulées. Je collabore avec des associations de guides touristiques pour des visites approfondies, et je m’arrête souvent pour parler aux experts ou aux simples curieux, en donnant des détails qui vont au-delà de la simple visite. Nous sommes conscients du potentiel de diffusion de notre approche. Étudier et communiquer nous permet de mieux comprendre comment poursuivre la recherche historique et, en même temps, d’offrir des outils de compréhension au public. A titre d’exemple, une vidéo réalisée cette semaine par un célèbre tiktoker napolitain a atteint près de 600 000 vues en quelques heures, démontrant un énorme potentiel de diffusion. Ce type de travail est une tâche éducative délicate mais fondamentale. Il permet de construire une véritable découverte de l’histoire napolitaine, en combinant rigueur historique et attrait communicatif. J’y vois une opportunité de faire école, en alliant recherche et médiation culturelle.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.