Aux portes du Caire, le 21 juillet 1798, l’armée française dirigée par Napoléon Bonaparte (Ajaccio, 1769 - Sainte-Hélène, 1821) entre en conflit avec les troupes mameloukes dans ce qui restera dans l’histoire comme la bataille des Pyramides, un épisode qui, dès le début, a assumé une puissante valeur évocatrice. Il n’est donc pas surprenant que l’histoire de l’art ait donné lieu à de nombreuses représentations du général sur le solégyptien, souvent complexes et chargées de sens, capables de traduire l’ambivalence entre la gloire militaire et la réflexion historique. Les périodes néoclassique et romantique, en particulier, ont fait de Bonaparte une figure populaire, représentée sous différents aspects. Tout d’abord comme un chef triomphant. À partir de 1797, lorsque ses triomphes militaires commencent à résonner, Napoléon est en effet représenté comme un héros, dans des poses similaires aux sculptures et aux bustes de l’Antiquité gréco-romaine, comme ceux de Jules César et d’Antinoüs, l’amant de l’empereur Hadrien.
Parmi ces reproductions, se distinguent les représentations de la campagne d’Égypte, période comprise entre 1798 et 1801, où il met en scène la figure du général à travers des œuvres qui encadrent sa force lors de la bataille des Pyramides et les moments quotidiens du périple oriental de Bonaparte. Son portrait est donc orienté vers le désir de s’immortaliser en tant que chef indomptable. Les œuvres soulignent sa grandeur et son ego. Pour Napoléon, l’effort de guerre en Égypte devient un symbole de gloire personnelle. Les compositions représentant l’expédition ont été réalisées sous l’Empire, comme en témoigne la Bataille des Pyramides de François-Louis-Joseph Watteau (Valenciennes, 1758 - Lille, 1823), peinte entre les murs de l’hôtel de ville et les murs de l’hôtel de ville. Lille, 1823), peinte entre 1798 et 1799, et qui semble refléter l’influence de l’illustration de 1803 de Dirk Langendijk (Rotterdam, 1748 - 1805) et de l’esquisse de François-André Vincent (Paris, 1746 - 1816). Le scénario raconté dans l’œuvre de Watteau décrit la bataille la plus connue de la campagne, livrée le 21 juillet 1798, au cours de laquelle l’armée française, menée par Napoléon, a affronté les forces des Mamelouks dirigées par Murād Bey et Ibrāhīm Bey. À cette occasion, le futur empereur des Français dévoile l’une de ses techniques militaires les plus intéressantes : le grand carré divisionnaire, une stratégie innovante qui lui permet de maintenir une défense impénétrable contre la cavalerie ennemie et qui marque un tournant dans la tactique militaire de l’époque. Dans le tableau de Watteau, la scène de bataille se découpe sur l’imposante pyramide peinte à l’arrière-plan du tableau.

Les portraits de Napoléon le représentant en Égypte sont pour la plupart des dessins et des esquisses réalisés par les artistes qui l’accompagnent dans l’expédition, comme Charles Louis Balzac et André Dutertre. Vers 1867, ce dernier esquisse une série d’œuvres capturant l’armée du général Bonaparte dans les rues du Caire et dans les sables du désert. Dutertre, l’un des protagonistes de la grande entreprise napoléonienne, est admis à l’Institut d’Égypte en août 1798, dans la section consacrée à la littérature et aux arts. Au cours de cette période, il réalise 184 portraits des membres de l’expédition, savants et officiers, dont les images composent aujourd’hui l’Histoire scientifique et militaire de Reybaud et illustrent le Journal de Villiers du Terrage. Outre l’évocation des hommes de science et de guerre, Dutertre se tourne également vers les habitants, impressionné par l’âme et les couleurs de la population.
Il existe en effet plusieurs artistes qui représentent la campagne égyptienne de Napoléon : beaucoup l’imaginent devant les imposantes ruines mameloukes de la Cité des morts, tandis que d’autres l’immortalisent à cheval prêt à balayer la ville du Caire et les ruines antiques de Gizeh. De 1835 date l’ouvrage de Léon Cogniet (Paris, 1794 - 1880) intitulé L’Expédition d’Egypte sous les ordres de Bonaparte. Dans le contexte de la campagne militaire et scientifique, la figure du commandant est élevée au rang de chef militaire et de promoteur d’une entreprise culturelle et intellectuelle. L’expédition est un moment historique clé dans la connexion entre les mondes anciens et modernes. Grâce à cette campagne, Napoléon réussit à valider le lien entre l’Égypte pharaonique et les aspirations des Lumières du nouveau siècle. Dans le tableau de Cogniet, aujourd’hui conservé au musée du Louvre, le général Bonaparte apparaît à la fois comme un commandant et comme un homme de culture entouré de scientifiques, d’archéologues, d’artistes et de militaires.

De son regard déterminé, il dirige les opérations de recherche et d’excavation, tandis qu’à l’intérieur du tableau, on peut apercevoir des archéologues qui s’efforcent de découvrir un sarcophage. Le lien entre la guerre, la recherche et l’étude reflète en fait l’idée de Napoléon de faire de son expédition une mission de connaissance et de pouvoir. Peut-il s’agir d’un défi de vanité et de grandeur ? Absolument. En 1851, le Suisse Karl Girardet (Le Locle, 1813 - Versailles, 1871) réalise la gravure Napoléon en Egypte (Quarante siècles le méprisent). La scène représente le moment où Bonaparte, à cheval, se trouve devant l’énigmatique sphinx et la pyramide, témoins d’une Égypte perdue. Le titre de la gravure Quarante siècles le regardent d’en haut rappelle également une phrase (attribuée à Napoléon) prononcée devant son armée : “Soldats ! Du haut de ces pyramides, quarante siècles d’histoire vous regardent”.
En 1895, Maurice Henri Orange (Grandville 1868 - Paris 1916) l’illustre dans son Napoléon Bonaparte devant les pyramides, contemplant la momie d’un roi en train d’observer la momie d’un pharaon. On peut donc définir l’œuvre comme une conversation silencieuse entre le général français, représentant de la puissance moderne et occidentale, et le saint souverain d’Égypte. La scène est capturée par le réalisateur Ridley Scott dans le film Napoléon de 2023. Dans la transposition cinématographique, Bonaparte, interprété par Joaquin Phoenix, contemple la momie dans le sarcophage, sentant, probablement pour la première fois, la grandeur de la culture égyptienne. Sur le modèle d’Orange, Scott immortalise avec la même intensité l’instant où Napoléon s’approche de la momie pour scruter attentivement son visage. Il pose son chapeau sur le sarcophage en signe de curiosité, puis prend une caisse en bois et s’approche encore plus près, cherchant dans les yeux de la momie un point de comparaison.

Napoléon peut-il réellement soutenir ce regard ? Nous ne le savons pas, mais dans les représentations de la période égyptienne, la figure de Bonaparte est décrite comme un héros qui s’immerge dans un dialogue de conquête avec une Égypte immortelle. Il s’élève dans la contemplation profonde de ces terres. Le Napoléon de Dutertre y réfléchit précisément. Il réfléchit à sa grandeur et à celle d’une civilisation qui vit dans le souvenir de ses ruines et la majesté de son passé. Sur le plan historique, l’expédition française en Égypte répond à des ambitions coloniales précises : Bonaparte entend affaiblir l’influence britannique en Inde en s’attaquant à ses intérêts économiques par le contrôle de la Méditerranée orientale.
C’est pourquoi, en plus d’une armée massive d’environ 50 000 soldats, Bonaparte envoie plus de 160 savants, membres de la Commission des sciences et des arts, issus de diverses disciplines telles que la botanique, la géologie et les sciences humaines, pour se joindre à l’entreprise. Les experts se consacrèrent à l’exploration et à la documentation des paysages culturels et naturels de l’Égypte, produisant en 1809 une publication encyclopédique intitulée Description de l’Égypte ou Recueil des ob- servations et des recherches qui ont été faites en É gypte pendantl’ expéditionde l’Armée française(Description de l’Égypte ouRecueil des ob- servations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française ), qui contient des descriptions détaillées, y compris celles du complexe pyramidal de Gizeh. Les récits laissés par les membres de la commission permettent aujourd’hui aux historiens de confirmer que Napoléon a visité les pyramides, même s’il reste peu probable qu’il leur ait accordé une importance stratégique d’un point de vue militaire.
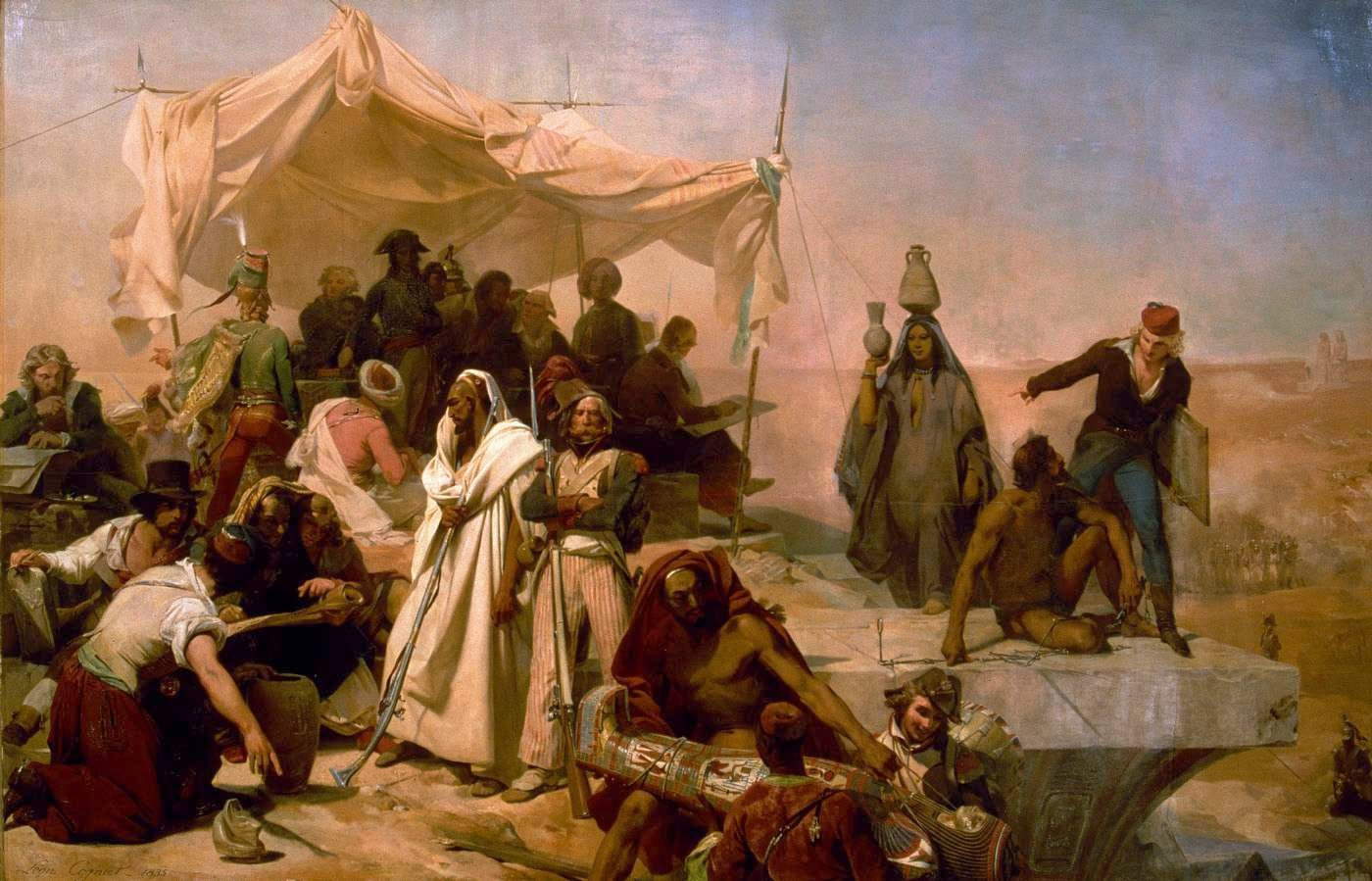
Selon Salima Ikram, professeur d’égyptologie à l’Université américaine du Caire, Napoléon avait une grande admiration pour le Sphinx et les pyramides, les utilisant même comme symboles pour motiver ses troupes vers plus de vanité et de gloire personnelle. C’est pourquoi, contrairement à ce que l’on peut voir dans la transposition de Scott, Ikram souligne que Bonaparte n’aurait jamais pu leur tirer dessus. Dans une interview au Times, Scott lui-même a déclaré “Je ne sais pas s’il l’a fait”, faisant référence au prétendu coup de canon sur le sphinx attribué aux troupes de Napoléon visibles dans le film, ajoutant plus tard que le récit était un moyen rapide de symboliser la conquête de l’Égypte par le dirigeant.
Au cours de l’expédition, dans leur ferveur à répertorier les richesses archéologiques de l’Égypte, les savants français s’approprient les trésors et les artefacts des terres pharaoniques, dont la pierre de Rosette, une dalle de granodiorite gravée en trois langues pesant environ 760 kilos, cruciale pour le déchiffrage des hiéroglyphes égyptiens. Pour Andrew Bednarski, universitaire du XIXe siècle spécialisé en égyptologie et en histoire, il existait un véritable intérêt des savants, également partagé par Napoléon, pour comprendre des aspects auxquels les Européens n’avaient pas eu accès depuis l’époque classique.
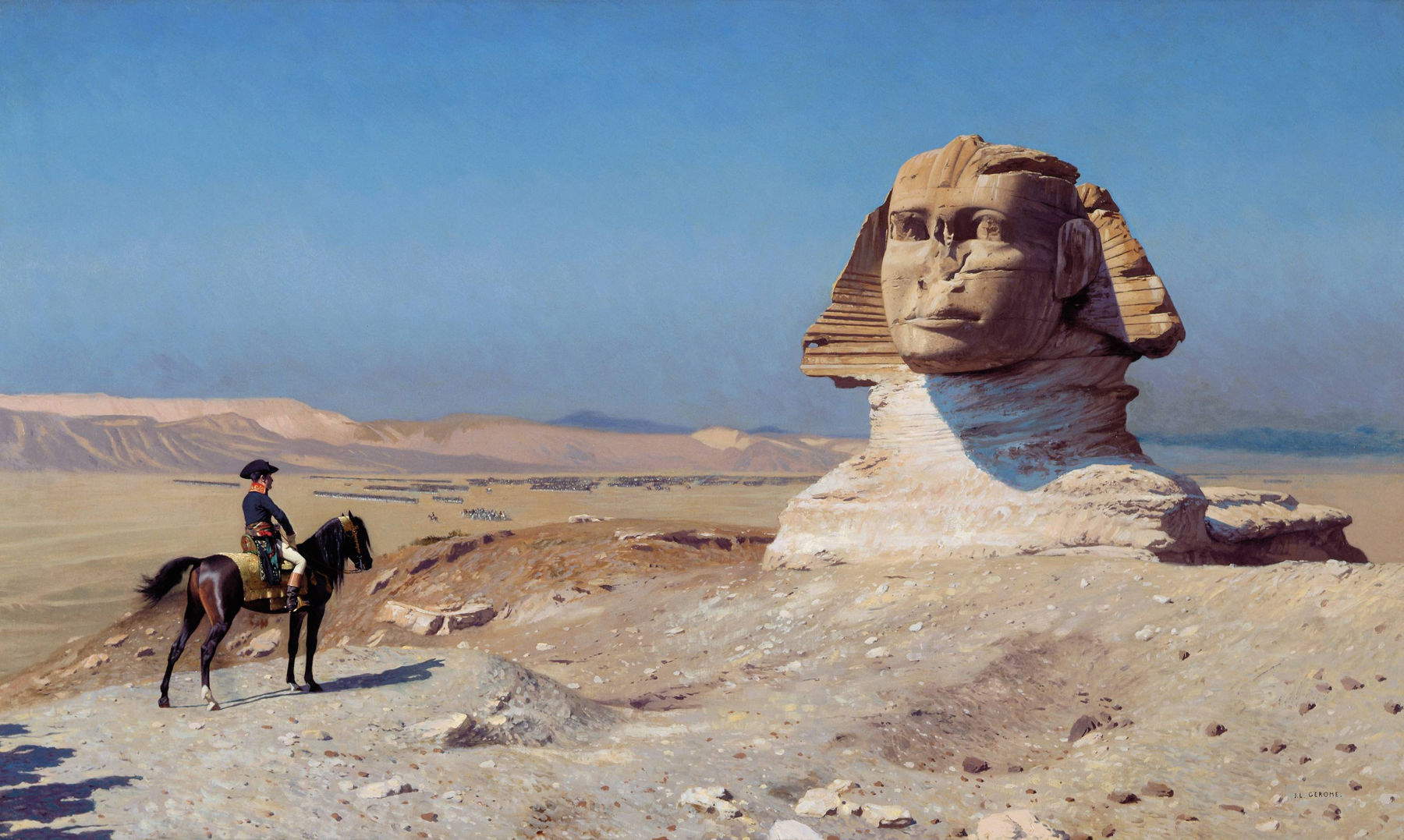
Bien qu’elle se soit soldée par un échec militaire, l’expédition de Bonaparte a contribué à répandre en Europe un profond intérêt pour la civilisation égyptienne, déclenchant une vague d’égyptomanie qui allait conquérir le monde. Et c’est ce qui s’est passé. À la fin de la domination française en Égypte en 1801, de nombreuses reliques, dont la stèle elle-même, se retrouvèrent entre les mains des Britanniques, bien que Napoléon soit alors rentré en France. Le désir de posséder les artefacts de l’ancienne civilisation égyptienne a donc ouvert la porte à des siècles de fouilles, de trafics et de raids, qui ont dépouillé l’Égypte de sa mémoire. Dès l’invasion napoléonienne, un flot d’objets quitte le sol égyptien, souvent par des voies clandestines.
Selon Alexander Mikaberidze, professeur à l’université d’État de Louisiane à Shreveport et spécialiste reconnu de l’histoire napoléonienne, la campagne d’Égypte, bien qu’elle se soit soldée par une défaite militaire, a eu d’importantes retombées scientifiques et culturelles. L’invasion a en effet marqué le début d’une nouvelle saison d’intérêt pour l’Égypte, donnant l’impulsion à la fascination occidentale pour la civilisation pharaonique qui allait guider les études et les explorations au cours des décennies suivantes. Parmi les artistes qui ont représenté Bonaparte, la figure de Jean-Léon Gérôme se détache nettement. L’artiste français connaît bien l’Égypte et, pour avoir exploré ses terres à quatre reprises depuis 1855, il sait ce qu’il fait. Le tableau Bonaparte devant le Sphinx réalisé entre 1867 et 1868 peut être considéré comme le tableau le plus représentatif de la période napoléonienne égyptienne. D’un fort impact visuel et d’une grande puissance scénique, le sphinx domine la moitié de la toile, s’élevant au-dessus de Bonaparte immobile devant lui.

Comme souvent chez Gérôme, c’est le cadrage qui donne de la profondeur à la scène. Les pyramides sont volontairement exclues pour accentuer le choc entre l’homme et la pierre millénaire. Gérôme, maître de l’instant, réussit ainsi à figer le temps même si de petits détails parviennent à annoncer sa reprise imminente : la queue du cheval vibre à peine, les ombres d’un bâton se dessinent dans le coin gauche du tableau et au loin, dans le désert, des troupes se déplacent, prêtes à participer à la bataille des pyramides en 1798. Gérôme présente pour la première fois le tableau Œdipe au Salon de Paris de 1886 et établit, à travers la figure du sphinx, un lien subtil entre le héros mythologique de Thèbes et celui qui sauvera la France. Ridley Scott rend hommage à l’œuvre de Gérôme avec le même cadrage. Les travaux de l’artiste sur l’expédition de Bonaparte en Egypte sont divers. En 1867, il peint Le Général Bonaparte et son état-major en Égypte. La scène se déroule dans le désert, avec au centre un Bonaparte fier, monté sur un chameau et entouré de ses officiers. Dans l’œuvre, l’artiste souligne l’exotisme du décor par la représentation détaillée des costumes colorés des Bédouins, du paysage et de la posture des personnages. L’autre peinture à l’huile, Bonaparte en Égypte, est contemporaine des dates de 1867 et 1868. Une fois de plus, Gérôme représente le chef se tenant fièrement devant les tombes mameloukes à l’extérieur du Caire.
Ainsi, sur son cheval, devant le colosse immortalisé par Gérôme, Napoléon scrute son destin. Après sa défaite en Egypte, son arrogance se plie à l’éternité de l’Egypte, car les pyramides, les obélisques, les temples qui ont traversé les siècles y demeurent, en souvenir de la fragilité et de l’éphémère de son existence et de celle des hommes.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.