Du 25 octobre 2025 au 8 février 2026, les salles décorées de fresques des Chiostri di San Pietro à Reggio Emilia accueilleront Margaret Bourke-White. The Work 1930-1960, une rétrospective consacrée à Margaret Bourke-White (New York, 1904 - Stamford, 1971), l’une des figures les plus importantes de la photographie du XXe siècle. L’initiative est promue par la Fondazione Palazzo Magnani en collaboration avec CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, et organisée par Monica Poggi. L’exposition présente 150 images couvrant trois décennies d’activité de l’auteur, dont des reportages industriels, des scénarios de guerre, des transformations sociales et des conflits géopolitiques. Née à New York en 1904 et décédée en 1971, Bourke-White a construit une carrière internationale qui s’est distinguée par sa capacité à faire face à des contextes extrêmes, tant en termes de difficultés logistiques que d’implications politiques, s’imposant comme un témoin direct des événements qui ont marqué le siècle. L’exposition est divisée en six sections, selon un critère chronologique et thématique.
“Dans les années où j’étais obsédée par la beauté de l’architecture industrielle, les gens n’étaient que des présences occasionnelles dans mes photographies. [Aujourd’hui, je ne m’intéresse plus qu’aux gens”, explique Bourke-White à propos de ses reportages sur la vie américaine dans les années qui ont suivi l’effondrement de l’économie. "J’ai vu et photographié des piles de corps nus sans vie, des morceaux de peau tatouée utilisés comme abat-jour, des squelettes humains dans la fournaise, des squelettes vivants qui allaient bientôt mourir d’avoir attendu trop longtemps la libération. À cette époque, l’appareil photo était presque un soulagement, il insérait une mince barrière entre moi et l’horreur qui se trouvait devant moi.

Le premier noyau, intitulé The Early ’Life’ Shoots, retrace la collaboration de la photographe avec le magazine américain Life, qui a débuté en 1936. Pour le premier numéro, la rédaction a choisi comme couverture l’une de ses images du barrage de Fort Peck, dans le Montana. C’est le début d’une longue collaboration qui l’amènera à faire la chronique des grands travaux publics, des processus industriels et des paysages urbains en transformation. Cette période est explorée dans la section L’enchantement des usines et des gratte-ciel, où apparaissent les intérêts modernistes de l’auteur et son attirance pour les géométries monumentales des grands complexes industriels.
Un autre moment charnière est représenté par Portraying Utopia in Russia, dans lequel sont exposées des photographies prises en Union soviétique : Bourke-White a été la première photographe américaine admise dans le pays. Son travail en URSS coïncide avec une phase historique cruciale, marquée par les ambitions de propagande du régime et l’intérêt de l’Occident pour les modèles économiques alternatifs. Ses images tentent de rendre compte de l’ampleur d’une transformation industrielle et sociale encore en cours, en maintenant un regard suspendu entre documentation et rhétorique visuelle.

La section Ciel et boue, photographies de guerre rassemble des reportages réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les fronts africain, européen et soviétique. Les images rendent la dureté du conflit, mais aussi la dimension quotidienne de la vie au front, en s’attachant aux visages, aux corps et aux espaces de la résistance civile. Dans ces contextes, l’auteur ne renonce pas à une approche technique exigeante, continuant à utiliser du matériel moyen et grand format, malgré les difficultés environnementales. Ce choix lui permet d’obtenir une netteté et une composition qui confèrent une monumentalité à ses sujets.
L’histoire se poursuit avec Le monde sans frontières : reportages en Inde, au Pakistan et en Corée, qui documente les missions entreprises à la fin des années 1940 et au début des années 1950. En Inde, la photographe fait également le portrait du Mahatma Gandhi et assiste au processus de décolonisation et aux premiers conflits liés à la naissance des nouveaux États-nations. Même dans ces reportages, Bourke-White préfère la pose à la prise de vue directe, se distinguant ainsi d’autres photojournalistes contemporains tels que Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson. Son choix stylistique vise à redonner de la dignité à ses sujets, appartenant souvent à des classes sociales marginalisées, transformés en emblèmes universels de la souffrance et des transformations en cours.
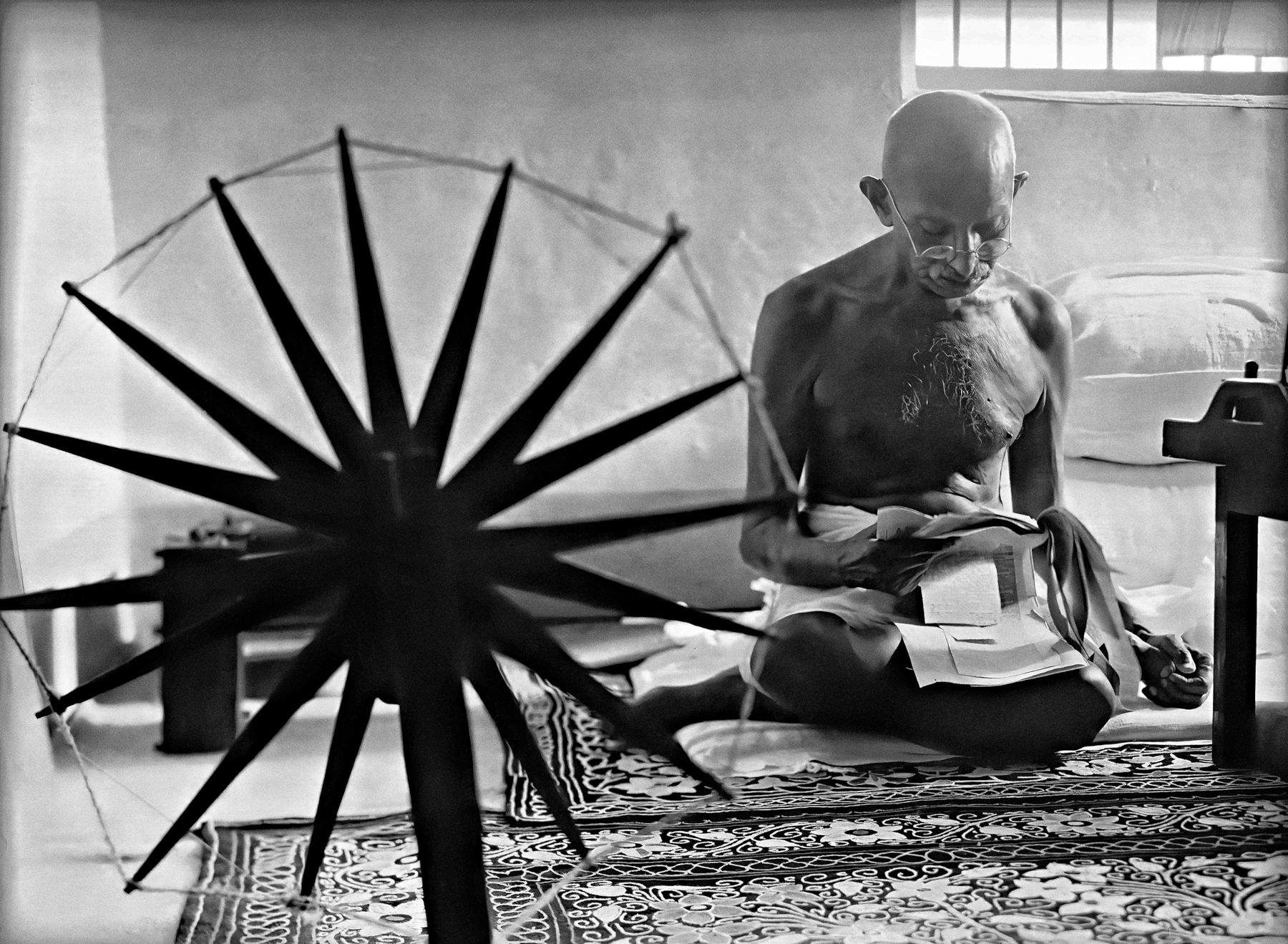
Margaret Bourke-White, un soldat américain discute avec une Allemande qui prend un bain de soleil dans le Berlin d’après-guerre. Allemagne (1945 ; Margaret Bourke-White/The LIFE Picture Collection/Shutterstock)
La dernière section, Gold, Diamonds and Coca-Cola, aborde un thème récurrent dans l’œuvre de la photographe : l’inégalité sociale. Le titre fait allusion à la coexistence de richesses ostentatoires et de conditions de vie précaires que Bourke-White documente au cours de ses voyages en Afrique et aux États-Unis. Les photographies, prises dans des contextes urbains et ruraux, mettent en évidence des contrastes économiques croissants et posent des questions toujours d’actualité sur la dynamique de la mondialisation et la diffusion des modèles consuméristes. Outre l’analyse de sa carrière professionnelle, l’exposition s’intéresse également à la personnalité de la photographe. Bourke-White apparaît comme une figure non conventionnelle et déterminée, capable de surmonter les barrières de genre dans un environnement essentiellement masculin. Dans les années 1930, elle a atteint une telle notoriété qu’elle était considérée comme l’une des femmes les plus influentes des États-Unis. Parmi les anecdotes présentées dans l’exposition figure la présence de deux alligators dans son studio du Chrysler Building, symbole d’une existence non conventionnelle.
Sa carrière s’est développée selon deux axes : d’abord comme interprète des politiques du New Deal, véhiculées par un langage visuel proche de la propagande et de la revendication sociale ; ensuite comme photojournaliste orientée vers un réalisme plus sec, visant à dépeindre des individus et des communautés impliqués dans des crises historiques. Dans les deux cas, sa recherche se distingue par une cohérence stylistique et une attention continue aux dispositifs narratifs de la photographie. Un épisode de 1955 offre une clé singulière de sa vision : frappée par la maladie de Parkinson, maladie qui l’accompagnera jusqu’à sa mort, elle écrit à son éditeur Henry Luce pour lui demander d’être envoyée sur le premier vol spatial vers la lune. “Bien sûr, je devrais résoudre le problème des moyens de transport”, note-t-elle ironiquement dans sa lettre. "Peut-être que dans quelques années, je trouverai la solution. Peut-être que sauter à la corde ne signifie pas que je pourrai aller sur la lune, mais la science va si vite, qui sait ?

Dans le cadre de l’exposition, la Fondazione Palazzo Magnani propose une série de réunions publiques consacrées à ce que l’on appelle le “siècle américain”, une expression qui englobe les structures historiques, culturelles, idéologiques, économiques et sociales qui ont caractérisé le XXe siècle et qui influencent encore aujourd’hui la vie contemporaine. L’initiative se propose d’approfondir le contexte dans lequel la figure de Bourke-White s’est formée et établie, en offrant des outils pour interpréter son œuvre à la lumière des transformations du présent.
 |
| À Reggio Emilia, la rétrospective Margaret Bourke-White avec 150 clichés sur la guerre, l'industrie et la société |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.