Il y a quelques mois, par l’intermédiaire du ministère de la culture, l’Italie s’est engagée dans une voie ambitieuse visant à rendre son vaste patrimoine culturel pleinement accessible à chaque citoyen, en surmontant toutes sortes de barrières. Cet effort s’inscrit dans le contexte plus large du Plan national de relance et de résilience (PNRR), l’instrument par lequel le pays met en œuvre le programme européen NextGenerationEU, un paquet de financement de 750 milliards d’euros visant à soutenir la relance et la résilience des États membres. Le PNR s’articule autour de trois axes stratégiques (numérisation et innovation, transition écologique et inclusion sociale) et est divisé en six missions principales. La culture et le tourisme relèvent de la mission 1, consacrée à la numérisation, à l’innovation et à la compétitivité. Dans ce cadre, le volet 3, intitulé “Tourisme et culture 4.0”, comprend l’investissement 1.2, axé sur “l’élimination des barrières physiques et cognitives dans les musées, les bibliothèques et les archives pour permettre un accès et une participation plus larges à la culture”. Cet investissement reconnaît que l’accessibilité ne se limite pas à surmonter des obstacles physiques, tels que des rampes ou des ascenseurs, mais s’étend à la capacité d’accéder au patrimoine culturel dans toutes ses dimensions: sensorielle, cognitive et culturelle, en tenant compte des différents besoins des visiteurs, y compris ceux qui sont handicapés ou issus de milieux culturels différents.
L’objectif global de l’investissement 1.2 est de réduire les obstacles et les inégalités qui limitent la participation des citoyens à la vie culturelle. Plus précisément, l’intervention vise à accroître et à diversifier l’offre culturelle pour un public plus large, en améliorant la qualité des services ; à soutenir les opérateurs culturels dans l’élaboration de “plans d’accessibilité” ; à concevoir et à mettre en œuvre des interventions concrètes pour l’élimination des obstacles ; à former le personnel administratif et les professionnels du secteur culturel à la culture de l’accueil et à l’accessibilité universelle, y compris aux aspects juridiques et à la médiation culturelle.
Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Culture s’est vu allouer 300 millions d’euros, répartis par le décret ministériel 331 du 6 septembre 2022. Cette somme a été divisée en quatre lignes d’action complémentaires. La première concerne les mesures visant à supprimer les barrières physiques et cognitives: c’est la partie la plus importante du financement, qui s’élève à 254 918 839 euros. Sur ce montant, 127 458 839 euros sont alloués aux sites culturels publics appartenant au ministère, 120 000 000 euros aux sites publics n’appartenant pas au ministère et 7 460 000 euros aux sites culturels privés. Le second concerne l’élaboration des Plans d’élimination des barrières architecturales (P.E.B.A.): un total de 6.429.400 euros a été alloué à l’élaboration de ces plans. La répartition est de 3.214.700 euros pour les sites culturels publics appartenant au ministère et le même montant pour ceux qui n’y appartiennent pas. Le troisième volet est la réalisation de la plateforme AD Arte, une plateforme nationale pour les services d’accessibilité dans les lieux culturels, pour laquelle 32.147.000 euros ont été alloués. Enfin, la dernière partie concerne la formation des travailleurs culturels, avec 6 504 761 euros affectés à des programmes spécifiques pour le personnel. Il est important de souligner que, conformément aux objectifs du PNR, au moins 40 % des ressources territoriales allouées sont destinées aux régions du sud, assurant ainsi un rééquilibrage territorial des investissements.
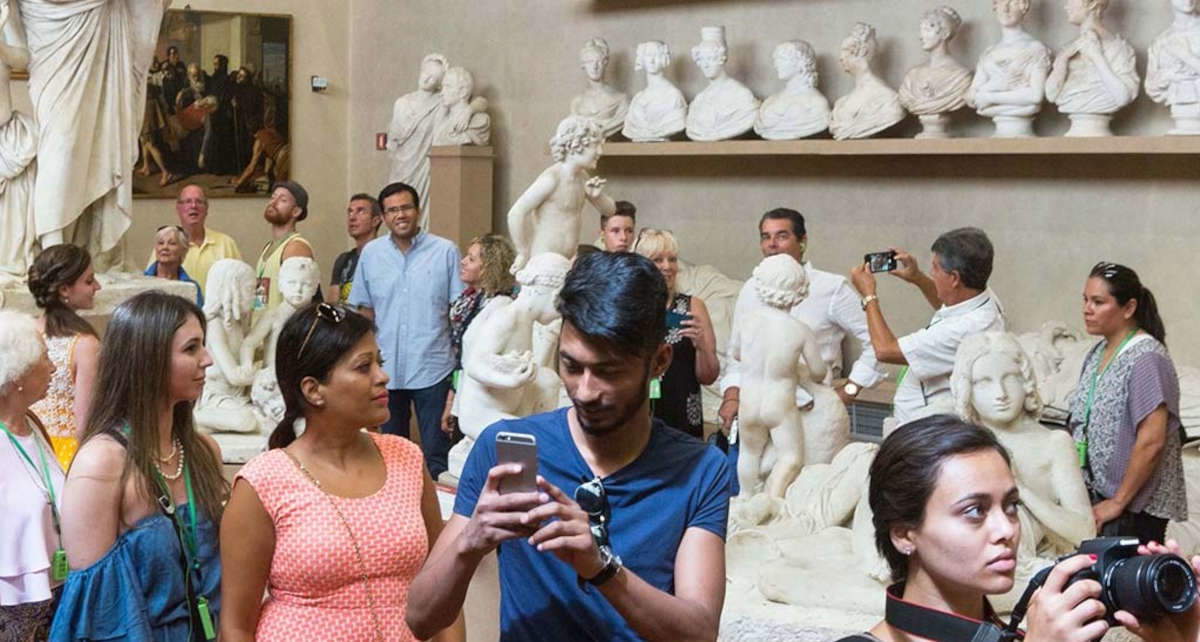
Le Plan stratégique pour l’élimination des barrières architecturales (P.E.B.A.), approuvé par la Direction générale des musées par le décret n° 534 du 19 mai 2022, est au cœur de cet effort impressionnant. Le P.E.B.A. n’est pas un simple accomplissement bureaucratique, mais un outil fondamental pour contrôler, concevoir et planifier des interventions visant à garantir la pleine accessibilité des espaces et bâtiments publics. Son importance réside dans sa capacité à identifier des solutions de conception, à estimer les coûts et à définir les priorités d’intervention. Déjà introduit en 1986 et intégré en 1992, le P.E.B.A. est conçu comme un parcours graduel et coordonné pour surmonter les barrières architecturales et psychosensorielles. Les “Lignes directrices pour l’élaboration du Plan d’élimination des barrières architecturales”, publiées en 2018 par la Direction générale des musées, représentent le cadre méthodologique de référence, issu des travaux d’experts internationaux et basé sur les bonnes pratiques.
Si, par le passé, l’accessibilité se limitait souvent à la suppression des obstacles physiques, la vision est aujourd’hui beaucoup plus large, puisque l’“accessibilité” signifie, comme mentionné, l’accessibilité aux aspects sensoriels, cognitifs et culturels également, afin que personne ne soit coupé du monde. Les données du rapport 2019 de l’Istat sur les musées indiquent que seuls 53 % des lieux culturels ont amélioré leurs installations pour éliminer les obstacles physiques et que seuls 12 % ont abordé les questions critiques des obstacles perceptifs, culturels et cognitifs. L’investissement 1.2 du PNR vise à atteindre un objectif important : surmonter les barrières architecturales dans 80 % des lieux culturels (y compris les archives et les bibliothèques d’État) et surmonter les barrières sensorielles et perceptives dans 50 % d’entre eux, d’ici juin 2026. Le P.E.B.A., par sa nature même, est un document ouvert, qui peut être mis à jour et adapté aux besoins au fur et à mesure qu’ils sont identifiés et suivis dans tout le pays.



Le financement a été réparti entre différents types d’institutions culturelles dans toute l’Italie. Pour les archives, le montant total était de 34 300 000 euros pour les interventions et de 1 890 000 euros pour la rédaction du P.E.B.A. Les fonds les plus importants ont été alloués aux Archives centrales de l’État (7,4 millions), aux Archives de l’État de Rome (6 millions au total), aux Archives de l’État de Palerme (3 millions), aux Archives de l’État de Trapani (1,7 million) et aux Archives de l’État de Milan (1,4 million). Pour les bibliothèques, l’investissement total pour les interventions et le PEBA s’élève à 16 377 877,75 euros pour les interventions et 444 449,59 euros pour la rédaction du PEBA : la bibliothèque qui recevra le plus de fonds est la Bibliothèque nationale de Naples (2.996 000 euros), suivie par la Bibliothèque Marciana de Venise (2 360 000), la Bibliothèque Universitaire de Pavie (1 750 098,38), la Bibliothèque Girolamini de Naples (1 553 216,80) et la Bibliothèque Universitaire de Padoue (1 050 000).
En ce qui concerne les musées et les lieux de culture, les interventions sont réparties entre ceux qui relèvent du ministère de la culture (ministère de la culture - départements régionaux des musées et ministère de la culture - instituts autonomes) et ceux qui ne relèvent pas du MiC (publics et privés). Pour les instituts relevant du ministère de la Culture, les directions régionales des musées ont reçu un total de 48 858 203,99 euros pour les interventions et 378 000 euros pour le P.E.B.A. Le site qui a reçu les ressources les plus importantes est celui de Forte dei Gavi, dans le Piémont (2,420 000 euros), suivi de l’Institut de recherche sur le patrimoine culturel (1,5 million d’euros).420.000), suivi par le Parc archéologique de Venosa (1.500.000), Castel Sant’Angelo (1.420.000), le Musée archéologique national de Cividale del Friuli (1.221.800), le Musée archéologique de Calatia (1.200.000) et le Site archéologique de Luni (1.174.900).
Les instituts autonomes ont reçu 32 691 007,67 euros pour les interventions et 579 000 euros pour le P.E.B.A. Le financement le plus important va à la Galleria Borghese à Rome, qui a reçu deux tranches, l’une de 1 356 291 euros et l’autre de 1 318 925,69 euros, suivie par la Gallerie Nazionali d’Arte Antica avec 1 437 747 euros et le Palazzo Ducale à Mantoue avec 1,3 million d’euros. Parmi les principaux musées, le Parc archéologique de Pompéi a bénéficié d’un financement important pour ses interventions (878 675 euros pour le seul site archéologique de Pompéi), le Musée national étrusque de Villa Giulia à Rome a reçu 1 000 000 d’euros, le même montant pour le Musée et le Real Bosco de Capodimonte et le Musée archéologique national de Naples.
Pour les sites culturels publics n’appartenant pas au Ministère de la Culture, l’investissement s’élève à 123 214 700 euros pour les interventions et la rédaction du P.E.B.A.. Parmi les exemples de la macro-zone Centre-Nord, citons le musée d’art contemporain du château de Rivoli (499 962 euros), le musée égyptien de Turin (499 767 euros) et la bibliothèque municipale Renato Fucini d’Empoli (87 530 euros). Parmi les projets qui ont bénéficié de la réaffectation des fonds, nous trouvons la Biblioteca civica di Chivasso (Turin) avec un financement supplémentaire de 183 957,83 euros et le Parco Archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale (Modène) avec 315 817,27 euros. Dans la macro-zone Sud, le Parc archéologique et paysager de la Vallée des Temples à Agrigente, entre autres, a reçu 500 000 euros, et le Musée Paleolab à Pietraroja, en Campanie, a reçu 500 000 euros. La bibliothèque provinciale Tommaso Stigliani de Matera a également reçu 500 000 euros. Les projets qui ont reçu des fonds provenant de réaffectations comprennent l’ancienne colonie pénitentiaire de Castiadas (Sardaigne du Sud) avec 181 279,61 euros supplémentaires et le musée archéologique MUSA d’Alghero avec 240 426,39 euros.




Le PNR est un “contrat de performance”, dont le succès est mesuré par la réalisation d’objectifs spécifiques, définis comme des “milestones” (littéralement “jalons”, entendus comme des objectifs qualitatifs indiquant les étapes clés de la mise en œuvre) et des “targets” (objectifs quantitatifs mesurés à l’aide d’indicateurs spécifiques). L’étape M1C3-00-ITA-8, concernant l’adoption du plan stratégique pour l’élimination des barrières architecturales dans les musées, les archives et les bibliothèques, a été atteinte avec l’approbation du décret n° 534 du directeur général du 19 mai 2022.
L’objectif européen M1C3-3 prévoit que d’ici le deuxième trimestre 2026, 617 interventions visant à améliorer l’accessibilité physique et cognitive dans les sites culturels auront été achevées et certifiées. Ces interventions concernent 352 musées, monuments, sites archéologiques et parcs, 129 archives, 46 bibliothèques et 90 sites culturels non étatiques. Une exigence de base est qu’au moins 37% de ces interventions doivent être réalisées dans les régions du sud de l’ Italie. Au niveau national, des objectifs intermédiaires supplémentaires ont été fixés pour suivre les progrès réalisés : M1C3-3-ITA-1 (150 interventions commencées d’ici le deuxième trimestre 2023) ; M1C3-3-ITA-2 (370 interventions commencées d’ici le deuxième trimestre 2024) ; M1C3-3-ITA-3 (617 interventions commencées d’ici le deuxième trimestre 2025).


La mise en œuvre de cet investissement est un processus dynamique, constamment contrôlé et mis à jour. Les ressources sont allouées par le biais de décrets spécifiques, et les listes de projets acceptés pour un financement sont régulièrement mises à jour, également en fonction des dérogations ou des nouvelles disponibilités. Cette approche flexible garantit que les fonds sont utilisés de la manière la plus efficace pour maximiser l’impact sur le territoire et respecter le principe de rééquilibrage territorial, en allouant une part significative au Sud.
L’investissement 1.2 du PNRR représente donc une opportunité sans précédent pour l’Italie de transformer son patrimoine culturel en une expérience inclusive et accessible à tous. Il ne s’agit pas seulement d’adapter les structures physiques, mais de promouvoir une culture de l’accueil qui fasse de la beauté et de la connaissance un patrimoine commun, sans barrières d’aucune sorte. C’est comme construire un pont non seulement sur une rivière, mais aussi sur les perceptions et les compréhensions de chacun, pour connecter chaque personne au cœur battant de la culture italienne.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.