La cathédrale Saint-Bavon de Gand, plus connue sous le nom de “Sint-Baafskathedraal”, est non seulement le principal édifice religieux de la ville en Flandre, mais aussi l’un des meilleurs exemples du gothique brabançon. Son histoire a des racines lointaines et commence au Xe siècle : dès 942, en effet, une première chapelle, probablement en bois, s’élevait sur ce site, consacrée par Transmarus, évêque de Tournai et de Noyon, et dédiée à saint Jean-Baptiste : c’était la première paroisse de la ville flamande. Puis, au cours du XIIe siècle, une nouvelle église de style roman a été construite pour remplacer ou agrandir la première structure. Des traces de cette phase romane sont encore visibles, notamment dans la crypte, qui conserve les arcs en plein cintre typiques et des traces de fresques.
Plus tard, l’essor de Gand en tant que ville puissante et riche au Moyen-Âge a rendu possible l’ambition de construire des édifices religieux de plus en plus grands et richement décorés. C’est ainsi qu’à partir de 1228, et plus encore à partir de 1274, commença la construction du grand édifice gothique actuel, qui a conservé la dédicace originale au Baptiste.

La transformation gothique de ce qui était alors la ’Sint-Janskerk’, l’église Saint-Jean, a duré entre le 15e et le 16e siècle. On construisit d’abord un chœur, dont l’achèvement dura cent ans, dans un style influencé par le gothique français. Puis, à partir de la fin du 13e siècle, l’église ne cesse de s’agrandir. Vers 1390, un déambulatoire entouré de quatorze chapelles radiales est ajouté et plus tard, lors de la deuxième phase de construction (1462-1538), les travaux reprennent avec l’édification de l’imposante tour-porche occidentale, qui atteint une hauteur de 89 mètres et est achevée en 1534 : la tour elle-même est un élément distinctif du style gothique brabançon. Entre 1533 et 1559, le transept haut et les piles ont été érigés : l’ossature structurelle a été réalisée en pierre blanche, tandis que les murs ont été construits en brique. Les voûtes, déjà prévues dans le projet initial, ne furent achevées qu’en 1628, couronnant ainsi ce long travail.
Un changement crucial dans l’histoire de l’édifice s’est produit au milieu du XVIe siècle. L’empereur Charles Quint, né et baptisé à Gand, ordonne la démolition partielle de l’ancienne abbaye Saint-Bavon, située au nord-est de la ville, à la suite de la révolte de la ville contre lui en 1539 : le site sur lequel s’élevait l’abbaye devait en effet accueillir une nouvelle citadelle pour contrôler la ville. Les moines de l’abbaye sont sécularisés et reçoivent le titre de chanoines, tandis que leur chapitre déménage à la Sint-Janskerk, qui, à partir de 1539, est redédiée à saint Bavon. Enfin, avec la réorganisation ecclésiastique des Pays-Bas espagnols, 1559 voit la création du diocèse de Gand et l’église Saint-Bavon est élevée au rang de cathédrale et prend son nom définitif.
Bien que les travaux soient considérés comme achevés vers 1569, l’intérieur n’a cessé d’évoluer et a subi d’importantes modifications jusqu’au 19e siècle. Le septième évêque de Gand, Antoon Triest, a notamment laissé une empreinte profonde et puissante sur le somptueux intérieur baroque de la cathédrale, que nous admirons encore aujourd’hui. On sait que Triest a commandé des œuvres de haut niveau, dont le célèbre retable de Pieter Paul Rubens représentant la conversion de saint Bavon.
La cathédrale n’a cependant pas été épargnée par les événements turbulents. En 1566, l’iconoclasme protestant a détruit les précieux vitraux offerts par Charles Quint, Marie de Hongrie et Philippe II d’Espagne. Cependant, le célèbre polyptyque de l’Agneau mystique, le chef-d’œuvre des frères Van Eyck conservé ici, a réussi à survivre et a été sauvé. Le bâtiment a également été endommagé par des incendies ultérieurs, notamment en 1628 et 1640. L’incendie de 1640 a détruit la flèche de la tour-porche, qui n’a jamais été reconstruite, laissant le clocher à sa hauteur actuelle de 90 mètres.
L’extérieur de la cathédrale est une structure massive en pierre blanche. La façade est dominée par la haute tour-porche. Le chœur profond est entouré de chapelles radiales creusées entre les contreforts du déambulatoire. L’intérieur, presque aussi contrasté que l’extérieur, est au contraire lumineux, triomphal. L’effet chromatique interne est remarquable, donné par la combinaison de la pierre blanche pour l’ossature structurelle et de la brique rouge pour les murs et les voûtes, ainsi que par la lumière filtrée à travers les vitraux.
Le presbytère est séparé du déambulatoire par une enceinte en marbre du XVIIe siècle, caractérisée par un jeu de couleurs noir et blanc. Cette zone abrite d’importantes tombes d’évêques et d’illustres citoyens enterrés dans la crypte. Le monument funéraire de l’évêque Antoon Triest, un chef-d’œuvre de marbre noir et blanc datant de 1652-1654 et réalisé par Jérôme Duquesnoy le Jeune, occupe une place prépondérante. D’autres sépultures importantes sont celles de Cornelius Jansen, premier évêque de Gand, de Pieter Damant et de Michelle de Valois, duchesse de Bourgogne. Un autre monument funéraire remarquable est celui de l’évêque Attamont (Eugeen Albert d’Allamont), représenté en conversation avec un squelette, par Jean del Cour (1667-1670).
Les membres du chapitre de Saint-Bavon, établi ici en 1539, disposent de stalles dans le chœur, où se trouve également le trône épiscopal. Le chapitre est encore actif aujourd’hui, avec une vingtaine de membres qui s’occupent principalement des célébrations liturgiques et des tâches administratives diocésaines.






Le chef-d’œuvre absolu et le plus célèbre de la cathédrale Saint-Bavon est sans conteste le polyptyque de l’Agneau mystique, une œuvre fondamentale dans l’histoire de l’art occidental. Commandé par les patriciens gantois Judocus Vijd et Elisabeth Borluut, le polyptyque a été commencé par Hubert van Eyck (Maaseik, vers 1366 - Gand, 1426) et achevé en 1432 par son frère Jan van Eyck (Maaseik, 1390 - Bruges, 1441). Ce polyptyque monumental, composé de douze compartiments (à l’origine vingt panneaux de chêne), a été exposé pour la première fois le 6 mai 1432 dans la chapelle de Joos Vijd et Elisabeth Borluut à l’intérieur de la cathédrale.
L’œuvre est considérée comme un tournant en raison de son utilisation pionnière de la peinture à l’huile, une technique que Jan van Eyck a portée à la perfection. L’application de couches semi-transparentes donne à la peinture un sens sans précédent de la profondeur et de la perspective, ainsi qu’un réalisme incomparable. Au centre de l’œuvre se trouve l’Agneau, qui donne son nom à l’ensemble de l’œuvre, symbolisant le Christ offrant son sang pour la rédemption de l’humanité.
Une vaste restauration récente a révélé la peinture originale de Van Eyck, cachée par des siècles de vernis durci et de repeints. Cette restauration a également permis de déchiffrer une inscription cachée sur les draperies d’honneur derrière Marie et Jean-Baptiste. L’analyse aux rayons X a révélé le nom de Lubrect (Hubert) et la date de sa mort, ce qui suggère que Jan Van Eyck a peint le registre supérieur en hommage fraternel à Hubert.
L’histoire du polyptyque a été extrêmement mouvementée. Il a été volé ou retiré de la cathédrale à sept reprises au cours des siècles, ce qui en fait l’un des tableaux les plus volés de l’histoire. En 1794, par exemple, des soldats français ont emporté les panneaux centraux à Paris, qui n’ont été restitués à Gand qu’en 1815. Un épisode célèbre a eu lieu en 1934, lorsque deux panneaux latéraux ont été volés : un seul a été retrouvé, et le panneau connu sous le nom de “Juges intacts” est toujours manquant, remplacé par une copie. Après la Seconde Guerre mondiale, l’œuvre revint à la chapelle Vijd, pour être transférée à la chapelle Villa en 1986.
Un nouveau centre d’accueil (en savoir plus ici), situé dans la crypte, inauguré en 2021 et construit par le bureau d’architectes Riessauw, est devenu le foyer de l’œuvre et permet aux visiteurs de découvrir l’histoire tumultueuse de la cathédrale et du polyptyque. Le nouveau centre d’accueil de la cathédrale Saint-Bavon allie le patrimoine historique aux techniques de construction modernes. Il s’agit d’une infrastructure fonctionnelle et durable qui met l’accent sur l’intégration dans le contexte historique. Pour sa construction, des techniques avancées ont été utilisées pour renforcer les fondations et les structures de soutien, qui sont essentielles pour la protection de l’édifice séculaire. L’utilisation de techniques de stabilisation innovantes permet à la cathédrale de résister aux charges des visiteurs et à l’impact du temps. À cette fin, des matériaux de haute qualité compatibles avec le bâtiment existant ont été choisis pour éviter tout dommage. En outre, le système de climatisation du centre est conçu pour mieux protéger l’intérieur et les œuvres d’art exposées.
Dans le centre d’accueil, les visiteurs ont la possibilité d’utiliser des lunettes de réalité augmentée, grâce auxquelles ils peuvent voyager dans le temps dans la crypte de la cathédrale et vivre l’histoire du polyptyque et de la cathédrale comme s’ils participaient aux événements (le chef-d’œuvre et l’imposant bâtiment sont reproduits dans les moindres détails). Les familles avec enfants peuvent également participer à une visite guidée du centre d’accueil. L’audioguide, disponible en français, néerlandais et anglais, convient aux enfants à partir de 6 ans et permet de découvrir de manière ludique le polyptyque de l’Agneau mystique et son histoire.





Si l’Agneau mystique est son joyau le plus célèbre, la cathédrale Saint-Bavon est une véritable collection de trésors artistiques de premier ordre. La plupart de ces chefs-d’œuvre ont été commandés après l’établissement de l’évêché en 1559.
Parmi les tableaux les plus importants figure la Conversion de saint Bavon(ou l’Entrée de saint Bavon au monastère de Gand), une œuvre monumentale peinte par Pieter Paul Rubens (Siegen, 1577 - Anvers, 1640) entre 1623 et 1624. L’œuvre a été commandée par l’évêque Antoon Triest pour le maître-autel. Le tableau raconte la légende de saint Bavon qui, après une vie dissolue et la mort de sa femme, s’est repenti et a fait don de ses biens aux pauvres. La scène montre l’intendant distribuant les richesses, tandis que Bavon, en armure, s’agenouille pour être reçu par saint Amandus.
Le Triptyque du Calvaire, attribué à Justus de Gand (Joos van Wassenhove ; Gand, v. 1430 - v. 1480) et daté de 1465, est une autre œuvre importante. La cathédrale abrite également des œuvres d’autres maîtres flamands, comme Frans Pourbus l’Ancien (Bruges, 1545 - Anvers, 1581), qui a réalisé le polyptyque de Jésus parmi les docteurs en 1571, ainsi que quatorze panneaux illustrant l’Histoire de saint André. Parmi les autres artistes présents dans la cathédrale Saint-Bavon, citons Gaspar de Crayer, avec des tableaux tels que La décapitation du Baptiste (1658), Lucas de Heere, auteur deLa rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon (1559), une œuvre allégorique où Salomon représente Philippe II d’Espagne, et Antoon van den Heuvel.
La cathédrale abrite également une remarquable collection de mobilier liturgique et de trésors. La chaire baroque, créée entre 1741 et 1745 par Laurent Delvaux (Gand, 1696 - Nivelles, 1778) en chêne, marbre noir et blanc, est l’un des éléments les plus frappants et est considérée comme l’un des meilleurs exemples du genre. Le majestueux maître-autel est fait de marbre blanc, noir et rouge. En outre, les chandeliers du maître-autel sont de splendides œuvres exécutées en 1525 par Benedetto da Rovezzano (Benedetto Grazzini ; Pistoia, 1474 - Vallombrosa, 1554), créées à l’origine pour Henri VIII d’Angleterre.
Parmi les pièces les plus anciennes et les plus précieuses conservées se trouve l’Evangelarium de Livinus, un manuscrit du IXe siècle contenant les quatre évangiles : il s’agit de l’un des plus anciens livres conservés en Belgique. Cet objet, ainsi que d’autres, a été transféré de Sint-Baafsabdij (l’abbaye de Saint-Bavon) lors de sa suppression en 1536. Le trésor comprend également d’importants reliquaires, tels que la tête de saint Jean-Baptiste et les reliquaires de saint Macaire. La collection de vêtements liturgiques brodés est reconnue comme l’une des plus importantes du pays, avec des pièces allant du XVe au XXe siècle.




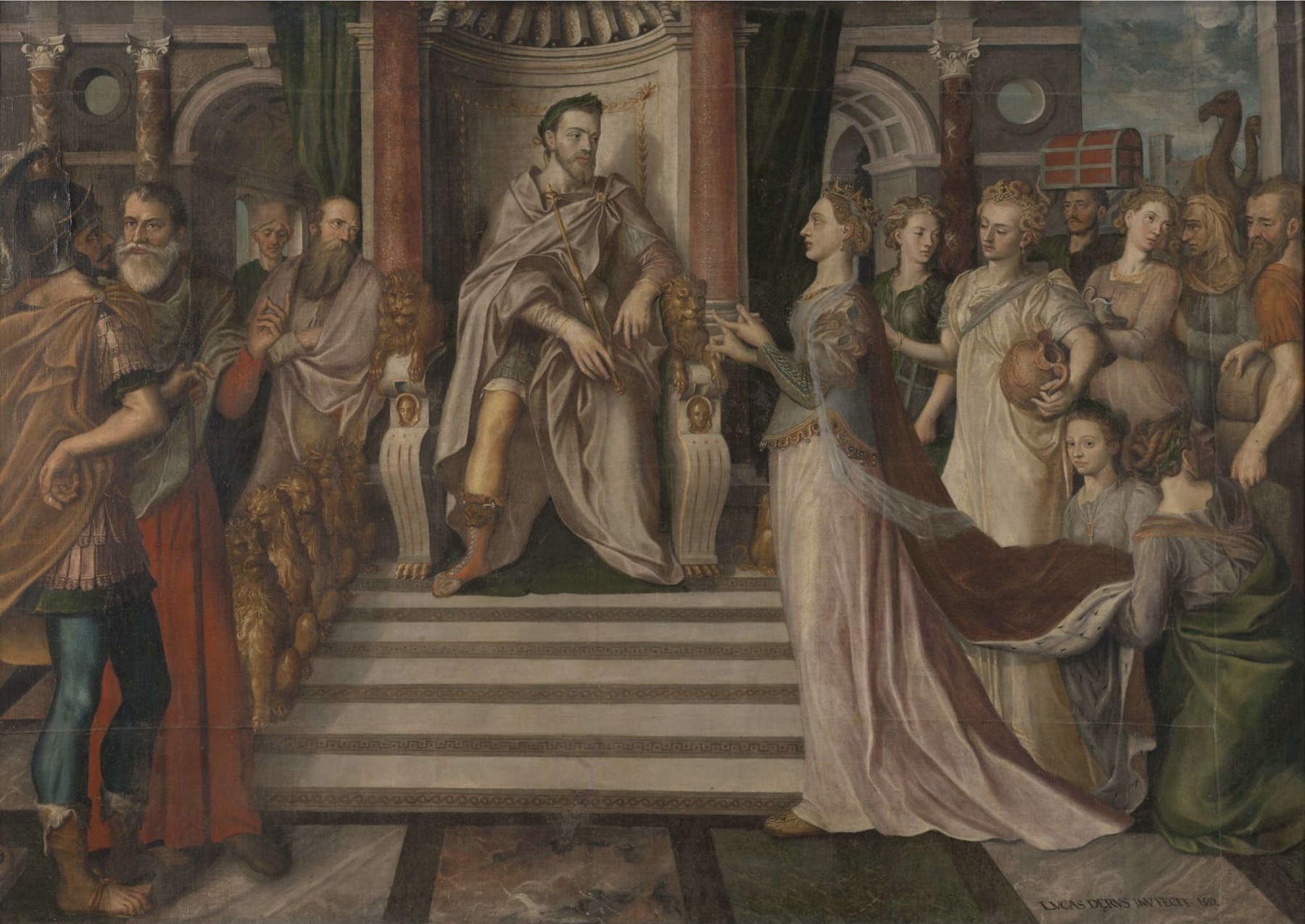


La cathédrale Saint-Bavon est également réputée pour ses orgues. L’orgue principal, situé dans l’église supérieure, est le plus grand de tout le Benelux. L’instrument est divisé en deux parties distinctes et dispose de cinq claviers et d’un pédalier. La partie la plus ancienne, appelée Kruisbeukorgel, est située dans le transept, d’où son nom (Kruisbeukorgel signifie “orgue du transept”). Il a été construit entre 1653 et 1655 par Louis Bys et Pierre Destrée de Lille, à la demande de l’évêque Antonius Triest. Cet instrument, rénové en 1767 par Lambertus Benoit Van Peteghem, répond aux deux premiers claviers et au pédalier et compte 48 registres.
La seconde partie, l’orgue de chœur(Koororgel), est plus moderne et se trouve au-dessus du chœur. Il a été construit par Johannes Klais pour l’exposition universelle de Bruxelles de 1935, où il a remporté un prix international, et a été acheté par la suite par l’évêque Coppieters. Avec ses 90 registres, qui correspondent aux claviers III, IV et V, il s’ajoute aux 48 registres de l’orgue ancien pour un total impressionnant, confirmant la suprématie de Gand en tant que dépositaire du plus grand orgue de la région.
L’édifice monumental a nécessité d’importants efforts de conservation. Une vaste campagne de restauration a débuté au cours de l’été 2005, planifiée en huit phases, d’une durée prévue d’au moins quinze ans et d’un coût estimé à plus de 25 millions d’euros, visant principalement à préserver la structure. Une phase cruciale de ces travaux a porté sur la tour de 90 mètres de haut, dont la restauration a commencé début 2013 et a nécessité l’installation d’échafaudages pendant au moins quatre ans.
Aujourd’hui, la cathédrale est entièrement accessible au public. Toutefois, si l’entrée dans l’édifice est gratuite, la visite du célèbre Agneau mystique dans le centre d’accueil des visiteurs récemment ouvert dans la crypte est payante. Le bâtiment a été rendu entièrement accessible aux personnes handicapées, y compris aux fauteuils roulants. Pour les visiteurs aveugles ou malvoyants, une maquette tactile en bronze de la cathédrale, 150 fois plus petite que l’original, est placée à l’entrée, avec un texte en braille retraçant l’histoire de la cathédrale.
L’actuelle cathédrale Saint-Bavon ne fait plus office de paroisse pour la communauté locale, car la paroisse a été fusionnée avec d’autres (Sint-Michiels et Sint-Niklaas) et l’église Saint-Michel fait désormais office d’église paroissiale principale. Son histoire complexe, liée au pouvoir et aux révoltes de la ville de Gand, et l’incroyable patrimoine artistique qu’elle abrite en font un lieu incontournable lors d’un voyage artistique en Flandre.
 |
| Cathédrale Saint-Bavon de Gand : gothique, baroque et chefs-d'œuvre immortels |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.