Le Museo Galileo de Florence, fondé le 7 mai 1925 sous le nom d’Institut d’histoire des sciences, a 100 ans cette année, et à l’occasion de son centenaire, plusieurs initiatives sont prévues. Nous avons profité de l’occasion pour nous entretenir avec le directeur Roberto Ferrari (Taormina, 1981), qui dirigera l’institut en tant que directeur exécutif à partir de 2021. Qu’est-ce qu’un musée aujourd’hui ? Comment peut-il être un point de référence dans le débat ? Comment peut-il aider les jeunes ? Pourquoi est-il important que les musées investissent dans la recherche ? Nous abordons ces questions avec le directeur dans cet entretien réalisé par Federico Giannini. Avec quelques exemples du fonctionnement du musée Galileo.

FG. Cette année, nous célébrons le centenaire du musée Galileo et, parmi les objectifs que l’institut s’est fixés, il en est un qui est, à mon avis, très intéressant et très ambitieux : renforcer la position de Florence dans l’histoire des sciences. Cela implique également de travailler sur la perception du public. Comment comptez-vous travailler pour atteindre cet objectif, cette relocalisation de Florence dans l’histoire des sciences ?
RF. C’est une entreprise qui a commencé en 1922, quand Andrea Corsini cultivait déjà l’idée de valoriser l’histoire des sciences à travers des instruments qui avaient cessé d’être utiles, mais qui pouvaient continuer, selon lui, à inspirer le travail des historiens et des scientifiques, en formant aussi un pont entre les deux formes de savoir. Aujourd’hui, nous sommes engagés dans cette mission de différentes manières. L’une d’entre elles consiste à faire comprendre combien même la culture artistique florentine, qui est évidemment beaucoup plus connue que la culture scientifique de la ville, doit aux idées, aux personnages et aux inventions de l’histoire des sciences. Il est impensable d’apprécier la coupole de Brunelleschi sans s’interroger sur l’appareil de connaissances technico-scientifiques qui la sous-tend, tout comme il est impensable d’apprécier et de comprendre l’œuvre de Galilée sans reconnaître que chez lui coexistent la figure du scientifique et celle de l’homme de lettres (comme le dira Calvino dans un célèbre article de 1967), ainsi que celle d’un habile dessinateur : comme l’a écrit Primo Levi dans le magnifique poème qui lui est dédié, Galilée était “un homme savant mais aux mains habiles”. Je trouve en effet passionnant le défi qui consiste à essayer de reconnecter les liens qui ont été rompus dans la spécialisation disciplinaire qui, surtout entre le dix-huitième et le dix-neuvième siècle, a constitué la ligne de tendance générale. Notre travail consiste donc, d’une part, à rassembler et à reconnecter ces différentes trajectoires et à montrer comment des œuvres souvent attribuées à l’un ou l’autre camp sont en réalité le fruit d’un travail qui a rassemblé différentes formes de savoir, et d’autre part, à faire connaître la contribution de la ville, puis de la Toscane et du pays tout entier à l’histoire des sciences, en dehors des questions d’identité nationale, bien entendu : il s’agit d’une contribution très importante qui a certainement été universellement reconnue jusqu’à l’ère galiléenne. L’un des aspects les plus fascinants que nous essayons toujours de mettre en évidence, même si cela nécessiterait d’autres compétences, est la façon dont la culture scientifique a également inspiré la bonne gouvernance, c’est-à-dire la proximité entre le monde scientifique et le monde politique. Depuis des années, nous parlons de " evidence-based policy", c’est-à-dire de politiques fondées sur des connaissances et des preuves. Cela n’est pas sans risque lorsque l’on croit que la science apporte toutes les réponses dont on a besoin. Ce n’est pas le cas, et l’histoire des sciences aide aussi à voir sous le bon angle les contributions scientifiques elles-mêmes, qui sont basées sur la faillibilité et sur le fait qu’évidemment tout scientifique doit aussi reconnaître les limites de ses propres hypothèses, comme Galilée nous a appris à le faire d’une certaine manière.
Pour faire face à ce type de travail, qui nécessite, je dirais, une approche pluridisciplinaire, et qui fait donc appel à des compétences diverses, on ne peut pas se contenter de travailler sur le plan physique, mais il faut aussi passer par le numérique. Comment donc, selon vous, un musée doit-il travailler sur le numérique ?
La prise de conscience du potentiel des outils informatiques au service du musée a commencé sous la direction de Paolo Galluzzi, qui a décidé de créer un laboratoire multimédia dès le milieu des années 1980. Ce laboratoire avait l’ambition, avec les moyens de l’époque, de travailler sur les deux grands fronts de la numérisation, qui sont encore aujourd’hui une mission constante pour nous. Le premier est l’étude des sources : le développement des vitrines, dont la première a été la Galilée, va dans ce sens, c’est-à-dire des environnements construits pour la recherche, où il est possible de localiser tous les matériaux utiles, et qui s’adressent aussi, cependant, à un public non expert. Les éditions numériques de textes anciens et de cartes, comme le planisphère de Martin Waldseemüller, se sont également développées dans ce sens. Il s’agit donc de rendre les objets accessibles, compréhensibles et appréciables même dans l’environnement numérique, et surtout d’utiliser le numérique non pas pour des effets spéciaux, mais pour améliorer les voies de la recherche et de la connaissance. Le deuxième front est celui des instruments : toute l’instrumentation scientifique depuis les années 80 fait l’objet d’une analyse continue visant à comprendre comment les nouvelles formes de visualisation pourraient aider ce front d’activité, que l’on peut appeler la philologie des machines et qui a évidemment l’ambition d’étudier continuellement les instruments scientifiques dans le but d’explorer leurs fonctions, leur contexte culturel et leurs relations de manière toujours plus précise cette chaîne idéale qui relie les inventions d’instruments scientifiques, et qui est tout sauf linéaire. Dans ce cas, le numérique signifie, par exemple, la modélisation en 3D et la recréation d’environnements numériques dans lesquels placer des objets numériques : un cas très récent a été la création d’un jumeau numérique (bien que ce terme soit impropre) de la Sala della Guardaroba du Palazzo Vecchio. Dans le cadre d’un projet avec la municipalité de Florence et les Amis de Florence, nous avons également créé, avec notre laboratoire multimédia, une reproduction numérique du globe d’Ignazio Danti, qui peut donc être exploré sans que l’original ne soit manifestement mis à l’épreuve (et il l’a été...). Cette reconstitution a également permis de mettre en évidence les éléments de conception de Vasari qui ne sont plus visibles, tels que les effets scénotechniques des globes qui sortent du plafond ou, comme imaginé, la sortie des armoires de l’horloge des planètes). L’idée est cependant de créer des instruments qui soient aussi faciles à utiliser.
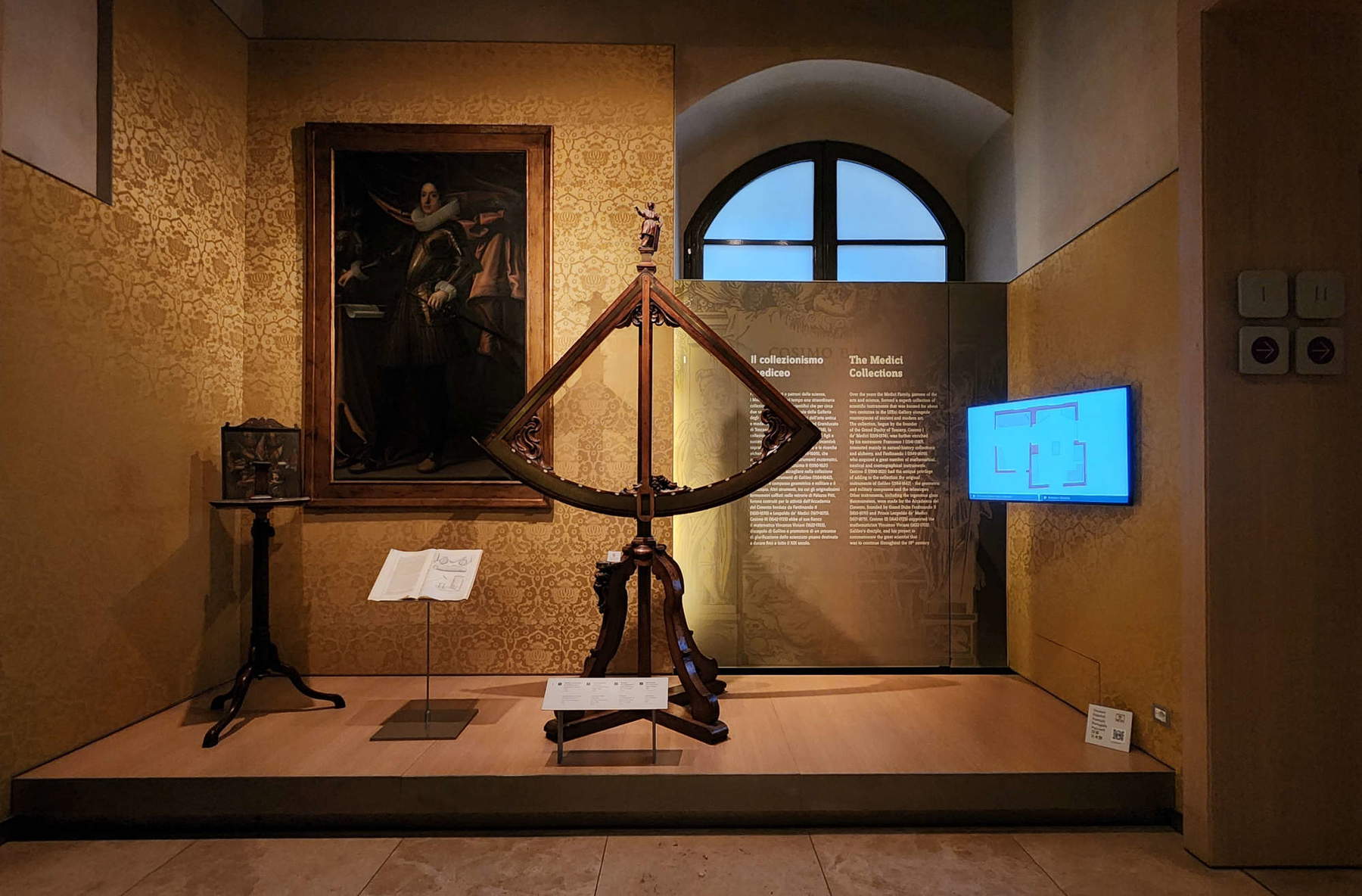



Parlons donc de la recherche, un domaine dans lequel le Museo Galileo est impliqué dans diverses activités, dont la plus récente est un projet de réalité virtuelle, accessible quotidiennement au public dans les salles du musée grâce à des visières que chacun peut porter, réalisé avec une spin-off de la Normale di Pisa. Mais au-delà, je souhaiterais savoir comment le musée aborde la recherche, quelles relations il entretient avec les universités, et ensuite, puisque le musée fait partie d’un système, si les musées en font assez dans ce sens, c’est-à-dire s’ils ont des relations assez solides avec l’ensemble du monde académique et si la recherche est vraiment encore un objectif des musées ou si la recherche est encore un objectif de l’université. encore un objectif des musées ou si, ces derniers temps, elle a été quelque peu mise de côté pour se concentrer sur d’autres objectifs, peut-être plus immédiats, mais aussi plus efficaces...
Je dirais que si aujourd’hui plus de 200 000 personnes par an entrent dans un musée d’instruments scientifiques, parfois très difficiles à lire, c’est parce que ces objets ont trouvé une voix dans ceux qui les ont étudiés, c’est-à-dire dans ceux qui ont consacré une partie de leur vie professionnelle de chercheurs à faire comprendre que dans ces objets apparemment inutiles, souvenirs du passé, se cache au contraire une histoire qui mérite encore d’être racontée, et donc que ces objets fonctionnent en quelque sorte comme des classiques qui continuent à avoir leur valeur en nous guidant dans les questions que nous nous posons aujourd’hui. Si je dois résumer la contribution de la recherche, je la vois aussi dans sa capacité à donner forme à quelque chose qui n’existait pas auparavant, parce que les objets sont muets ou, pour reprendre une célèbre définition d’Argan datant de 1975, ce ne sont pas des biens culturels, mais ce sont des objets de connaissance, des objets de recherche scientifique, et ils le sont dans la mesure où quelqu’un est mis en position de faire de la recherche, ce qui est un vrai problème. Nous faisons de la recherche avec des chercheurs en résidence, des employés du musée, mais nous collaborons également avec des chercheurs externes. Le musée dispose d’un réseau dense de collaborations, plus de 100 accords entre des universités et des instituts culturels qui nous permettent, bien sûr, de couvrir les domaines que nous ne couvrons pas avec des chercheurs internes, et nous permettent également d’aller dans le sens de ces travaux nécessairement interdisciplinaires qui nécessitent souvent l’implication de spécialistes. Parmi les raisons qui, à mon avis, freinent généralement l’engagement des musées italiens dans la recherche, il y a la difficulté pour la plupart des musées d’avoir un horizon de ressources, et donc de programmation, qui leur permette de couvrir les besoins nécessaires, et donc de pouvoir faire appel à des chercheurs qui s’engagent dans l’étude des collections. Il me semble cependant que les organes constitutionnellement engagés dans la préservation et le développement des musées, tels que le ministère ou les régions, accordent de moins en moins d’attention à ce projet, en exploitant également la plate-forme idéale du système muséal national. La loi sur les musées a été abrogée de facto, et la saison de liaison entre les deux ministères qui ont expérimenté ces dernières années des tables de travail communes (je me réfère au ministère de la Culture, comme il s’appelle maintenant, et au ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche, qui est maintenant divisé en deux ministères différents) semble s’être quelque peu éteinte. Il y a donc malheureusement, en plus d’une limitation physiologique qui découle de la faiblesse structurelle des musées, également, à mon avis, le fait que les musées ont été de moins en moins stimulés à faire de la recherche. Il s’agit évidemment d’un problème grave. Et puis, bien sûr, cela dépend aussi des choix de ceux qui dirigent l’institut.
Il s’agit d’une question politique.
Bien sûr. Je pense que le fait que les directeurs de musée soient souvent nommés pour une courte durée peut conduire même les meilleurs directeurs à se concentrer sur des initiatives éphémères parce qu’elles produisent leurs effets en deux ou trois ans. Ce n’est pas le cas de la recherche : bien sûr, malheureusement ou heureusement, cela prend plus de temps.



Vous avez évoqué tout à l’heure le Système muséal national, et j’aimerais connaître votre opinion sur son fonctionnement actuel : si ce système qui englobe les musées italiens pourrait être amélioré, si tout va bien, que pourrait-on faire... ?
Disons que la gestation du Système muséal national, tel qu’envisagé par le décret ministériel 113 de 2018, a été très laborieuse pour diverses raisons, notamment le fait que beaucoup de temps a été consacré à l’identification des exigences minimales clairement exprimées dans le décret et qui devaient être une condition nécessaire pour que les musées soient admis à l’accréditation. À mon avis, cela a entraîné un retard qui n’a été rattrapé qu’en partie, et seulement sur une ligne de travail, à savoir la systématisation par le biais de l’application Musei Italiani. Il s’agit d’une ligne qui a connu son propre développement, que nous pouvons observer, car il s’agit d’une plateforme sur laquelle de plus en plus de musées sont présents et qui a également commencé à fournir des services, permettant même la vente de billets, ce qui ne peut être qu’un fait positif. Il reste cependant un énorme engagement à prendre sur ce qui était peut-être la principale promesse du système des musées nationaux, à savoir être un système capable d’évaluer, et donc d’avoir le courage de dire oui et non. Ce courage doit se développer en tant que culture au sein des bureaux qui donnent forme à cet engagement. Pour que le système soit compétitif et coopératif, il y a un point qui, à mon avis, manque encore, malheureusement : relier les systèmes de programmation des ressources (et donc le financement des musées) au système muséal, c’est-à-dire au système d’accréditation qui est intégré dans le système muséal national. Tant qu’il y aura une déconnexion, voire une contradiction entre les règles de financement des musées et le système muséal national, nous n’irons malheureusement nulle part. Ceux qui donnent de l’argent aux musées, c’est-à-dire l’État et les régions, doivent vraiment croire en la valeur du système muséal national et doivent donc ancrer les critères de financement au respect de ces critères et donc, tout d’abord, des exigences minimales, puis des niveaux de qualité, comme ils sont appelés dans l’intitulé du décret. Mais le fond de tout cela, c’est que les musées doivent être soutenus sur une voie qui les fait grandir. Sans un lien solide entre les systèmes de planification des ressources et le système muséal national, nous manquerons la promesse fondamentale que nous portons depuis la loi d’orientation de 2001.
Insister sur le thème de la gestion des musées : je voudrais m’aventurer sur une question particulière, celle des qualités d’un directeur de musée. Il y a eu ces dernières années, et il refait surface de temps en temps, un débat passionné, l’un des plus animés, sur les caractéristiques que doit avoir un directeur de musée. Étant donné que le musée Galileo, du point de vue de la gouvernance également, a une structure particulière, je voudrais vous demander si ce débat qui oppose les “managers”, appelons-les ainsi, aux figures techniques, est à votre avis un débat futile ou utile : quelle est votre position sur cette question ?
Je pense que c’est un débat qui mérite d’être mené, et mené de manière à tirer parti de toutes les connaissances qui existent dans la pratique et dans la littérature sur ces questions. Il serait donc dommage de le gâcher dans une sorte de débat sur les positions idéologiques. Je pense qu’il y a une distinction fondamentale à faire entre les musées qui sont tenus, de par leur statut et leur configuration, de trouver des fonds, faute de quoi ils ne survivront pas, et les musées publics qui ont ou devraient avoir des fonds, et qui doivent donc certainement prêter attention à l’utilisation des fonds, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds publics, mais il est clair qu’il faut des chiffres qui permettent de trouver des fonds et donc de s’interroger sur la manière dont un musée peut obtenir des fonds externes. Bien dépenser l’argent public est une chose très complexe, mais il est encore plus complexe de bien dépenser l’argent et de le trouver. Les musées vraiment autonomes, ceux qui doivent absolument atteindre le seuil de rentabilité à la fin de l’année, doivent le faire coûte que coûte, car sinon les conditions sont créées pour une crise qui mène, à moyen terme, à leur extinction. Ensuite, il est évident que les besoins peuvent être résolus par différents types d’organisation. Je suis d’avis qu’il devrait y avoir différentes compétences au sein de chaque musée. Je ne suis pas convaincu que la direction confiée à un spécialiste de la collection ou du sujet résolve toujours tous les problèmes, à moins qu’il ne s’agisse de petites collections qui peuvent être dominées par une seule personne. C’est ce que je constate dans notre cas : bien qu’il y ait un directeur scientifique compétent, cette personne est principalement compétente pour une partie de la collection, de sorte que la présence d’une communauté de chercheurs est une condition fondamentale. Je pense toutefois que l’aspect le plus critique de la réponse que j’essaie de donner est que, malheureusement, l’ensemble de la discipline qui a vu le jour au cours des trente dernières années, à savoir l’économie, la gestion et la culture, n’a pas répondu aux attentes. Je crois qu’une grande partie de la controverse et de la pollution du débat provient du fait que la gestion de la culture, à mon avis, vit sur des formules abstraites et vit dans une sorte de bocal abstorique. Dans mon expérience, je me suis rendu compte que les outils qui sont censés être appliqués au secteur culturel (de l’organisation, de la gestion, de l’économie d’entreprise, etc.) sont souvent appliqués sans esprit critique et avec de très mauvais résultats, et je pense donc que l’étude des collections, l’étude des relations culturelles qui lient une collection à l’institution et l’institution à son contexte sont une condition préalable fondamentale pour construire une vision managériale des institutions culturelles, qui, par ailleurs, a généralement fait défaut. Je fais référence au fait d’avoir imaginé que la gestion se résume à la recherche de fonds, qu’il s’agit uniquement d’une question de comptabilité, ou qu’il s’agit uniquement de parler de plans stratégiques, souvent écrits en vain et réalisés par des institutions qui n’étaient même pas capables d’équilibrer leur budget, mais qui regardaient un monde idéal sans méthode, sans recherche minutieuse des sources. Je pense que le débat a malheureusement été pollué par une limitation de la communauté à laquelle je fais également référence : si les musées doivent être des centres de recherche qui ont également l’ambition de transformer les personnes qui entrent dans ce lieu, la logique du marché n’est pas suffisante. Si, au contraire, nous imaginons que le musée n’est qu’un conteneur d’objets à la recherche d’un public, alors il suffit d’y mettre une entreprise. C’est d’ailleurs ce qui se passe, car il suffit de voir comment le terme de musée est souvent mal utilisé, et cela me préoccupe plus que le débat sur la nature des directeurs. Autant de compétences nécessaires, à condition de se parler, de se comprendre, car il n’y a pas de bonne organisation qui ne se soit constituée autour des projets, des projets de recherche, des projets de connaissance que mène le musée, et il n’y a pas de bon projet de recherche et de connaissance qui ne s’accommode des caractéristiques et des contraintes organisationnelles et économiques de chaque musée.
Parlons plutôt du public du musée. Le musée Galileo accueille plus de 200 000 visiteurs par an, et ce sont des chiffres importants pour un musée dédié à l’histoire des sciences. J’aimerais savoir qui est votre public, c’est-à-dire combien il y a de touristes, s’il y a une prédominance de jeunes, de moins jeunes, bref, comment sont constitués les flux qui donnent lieu à ces plus de 200 000 visiteurs qui viennent chaque année.
Nous disposons de deux sources d’information : d’une part, les données que nous obtenons des canaux de vente et, d’autre part, les questionnaires que nous administrons avec, évidemment, la limitation que le questionnaire vous donne une représentation, même très précise, des seuls répondants, qui font donc évidemment partie de la population statistique. De ces deux sources, nous avons déduit qu’environ 60 % de nos visiteurs sont des touristes qui viennent à Florence pour visiter la ville, et que 40 % sont des citoyens. Il s’agit essentiellement de Florentins et de Toscans. Nous avons un public majoritairement américain, ce qui soulève évidemment la question du multilinguisme : le musée est organisé pour offrir l’ensemble de l’appareil de communication (le site web, les applications, tous les produits multimédias) au moins en italien et en anglais. Et il ressort également des questionnaires que le public du musée est composé de personnes de la tranche d’âge 28-45 ans. C’est le groupe le plus présent. On sait aussi par le questionnaire qu’ils viennent par deux : une curiosité qui m’étonne franchement aussi, mais qui est stable chaque année, c’est que le segment le plus important du public est constitué de trentenaires et de quinquagénaires qui viennent par deux, donc le Museo Galileo est une sorte de musée de l’amour.... ! Il est évident que nous avons une grande partie du public scolaire, car nous avons un groupe d’éducation didactique interne, avec lequel nous organisons environ 1 500 ateliers par an, et la part des groupes organisés est légèrement supérieure à 20 % (environ 25 000 visiteurs qui viennent en groupe, avec des visites d’expérience, comme nous les appelons ici, et des visites guidées).
Parlons du public italien, et en particulier du jeune public. En Italie, il y a une certaine réticence à l’égard des sujets scientifiques. Nous sommes bien en dessous de la moyenne européenne de diplômés en STEM (selon les données d’Eurostat), et c’est également un secteur qui souffre d’une forte disparité entre les sexes, car les femmes diplômées dans ce secteur sont environ deux fois moins nombreuses que les hommes, selon les données de l’ISTAT, qui montrent que 16,6 % des femmes (dans la tranche des Italiens âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur) sont titulaires d’un diplôme en STEM, contre 34 % des hommes, une situation qui se reflète également dans la sphère de l’emploi. Et tout cela malgré le fait que les tests INVALSI certifient que nos élèves les plus jeunes (collège, lycée) ont des compétences qui sont en fait plus ou moins en ligne avec celles de leurs pairs européens. Permettez-moi donc de vous poser quelques questions : constatez-vous dans vos activités quotidiennes une sorte de différence d’approche ou d’intérêt entre les adultes, d’une part, et les jeunes et très jeunes, d’autre part ? Et un musée comme le vôtre dispose-t-il des outils nécessaires pour intervenir dans un scénario comme celui que j’ai brièvement décrit ?
C’est une question très importante parce qu’évidemment les disciplines scientifiques sont aussi celles auxquelles on associe le plus la capacité d’un pays à ne pas subir les évolutions technologiques, mais à les conduire. Nous sommes par ailleurs convaincus que, dans le grand monde des disciplines scientifiques, il reste nécessaire de soutenir la recherche fondamentale qui, comme cela a été démontré dans de nombreux cas, est fondamentale précisément pour permettre de réunir la partie de la science qui alimente ensuite tout développement applicatif, et aussi parce que cela permet évidemment de réunir certaines disciplines qui sont typiquement exclues du raisonnement STEM (bien que cet aspect soit heureusement en train de changer au cours des dernières années) : une conscience historique, une conscience culturelle des scientifiques améliore aussi considérablement, globalement au niveau du système, la capacité de nos plus jeunes citoyens à avoir un impact et à obtenir une satisfaction professionnelle). De nombreuses raisons expliquent la situation compliquée que nous connaissons aujourd’hui. L’une d’entre elles est évidemment le faible niveau d’investissement du pays dans la recherche scientifique, en raison d’un préjugé qui remonte probablement à Croce : peut-être n’avons-nous pas encore réussi à surmonter cette barrière culturelle. Ensuite, nous devons nous interroger non seulement sur la quantité de financement, mais aussi sur la qualité de l’infrastructure de recherche, qui a manifestement beaucoup d’excellence en Italie. Nous la mesurons sur les questions que nous connaissons le mieux : nous pourrions dire, en simplifiant, que le musée Galileo, par exemple, a créé une bibliothèque comme la sienne parce qu’il était difficile de la créer dans les universités. Il a créé une série de formats et de projets de recherche que les universités ont non seulement du mal à créer, mais aussi à maintenir. Cela est dû à une culture de projet qui, malheureusement, peut avoir eu des résultats positifs, mais qui, si elle n’est pas accompagnée d’une culture institutionnelle, risque de produire continuellement des projets qui meurent et ne produisent pas tous les effets qu’ils devraient avoir. C’est dire que même l’histoire des sciences comme pont entre les humanités et les disciplines scientifiques, de notre point de vue (et il y a beaucoup de cas intéressants qui l’illustrent), peut améliorer les choses. C’est une petite contribution, j’en conviens, mais elle peut aussi aider à faire comprendre, à rapprocher, et nous le voyons dans nos ateliers pédagogiques. Beaucoup d’enfants qui se disaient éloignés des sujets scientifiques découvrent alors que derrière l’histoire de ces sujets scientifiques, derrière les instruments, derrière les personnages, il y a des histoires beaucoup plus riches qu’on ne le croit. C’est l’exemple de Galilée, qui était certes un scientifique visionnaire, capable de créer des objets et d’en imaginer d’autres qui suscitent l’intérêt, mais qui était plusieurs choses à la fois : lorsqu’il est rentré à Florence, il a prétendu être appelé philosophe avant d’être appelé mathématicien, et montre ainsi que les savoirs peuvent effectivement être rassemblés. Et c’est sans doute aussi l’un des moyens de rapprocher les jeunes des matières scientifiques.



D’ailleurs, on parle tout le temps de science aujourd’hui. Il suffit de penser au débat politique. Des sujets tels que la durabilité, l’intelligence artificielle ou le changement climatique sont également abordés. Que doit faire un institut comme le musée Galileo, consacré à l’histoire des sciences, pour rester à la pointe de ce débat ? En clair : doit-il prendre position, doit-il informer, doit-il vulgariser, ou sa mission est-elle davantage liée à l’histoire des sciences ?
Le rôle du musée, je crois, continuera à être celui d’un médiateur culturel qualifié : le musée Galileo, comme tous les musées, continuera à avoir un sens tant qu’il y aura quelqu’un qui aura confiance dans son travail de médiation culturelle, c’est-à-dire dans sa capacité à sélectionner, parmi les sources, celle qui est la plus pertinente, en prenant les risques du métier. Je ne suis pas de ceux qui croient que l’opinion des experts équivaut à l’opinion du visiteur, ou qu’il faut inventer des systèmes de participation qui fassent que même ceux qui sont passés ici par hasard, peut-être parce qu’ils voulaient voir le doigt de Galilée, se sentent des conservateurs. Je pense que nous devons faire confiance aux chercheurs, et il est évident que les chercheurs, comme tout le monde, peuvent faire des erreurs, mais la recherche a son propre système de comparaison interne et de sélection qui peut être amélioré, comme toutes les choses humaines. Et nous devons évidemment veiller à créer des organisations qui incitent les chercheurs à dialoguer avec d’autres personnalités afin que la portée et la parabole des projets de connaissance soient très longues et atteignent même les simples curieux et les non-spécialistes. Je crois que les outils nous aideront, si nous savons bien les utiliser, à étendre la portée, mais l’essentiel restera : l’institut culturel existe dans la mesure où il est capable d’avoir un moteur qui produit de nouvelles connaissances par le biais de la recherche et qui est également capable de passer au crible ce que les systèmes automatiques sont capables de produire, mais qui doit avoir un filtre et un retour d’information.
Et comment voyez-vous le musée Galilée ? En d’autres termes, qu’est-ce que le musée Galileo est ou devrait être pour vous ?
Ce que j’attends et ce que j’espère contribuer à faire, c’est tout d’abord de ne pas dissiper l’héritage intellectuel de cet institut, parce qu’il y a une partie visible de cet héritage qui est constituée de livres, d’objets et de documents qui incorporent une mémoire, mais il y en a une autre qui n’a pas de support, qui n’est pas en train de se développer, qui n’est pas en train de se développer. Il s’agit d’une certaine façon de travailler, d’un certain ton de communication qui n’est jamais présomptueux, qui ne cherche jamais le succès facile, les phrases chocs, et que nous essayons d’utiliser comme critère d’orientation pour beaucoup de choses. J’espère sauvegarder une certaine façon de travailler qui vient, je le dis ouvertement, de la direction de Galluzzi, qui était attentive à l’étude des sources, sans laquelle aucun projet de recherche ne peut avoir une base solide, mais qui était en même temps capable d’expérimenter de nouvelles formes de communication. Il est nécessaire de prendre au sérieux les jugements de ceux qui fréquentent l’institut, ne serait-ce qu’occasionnellement, mais avec l’ambition de pouvoir s’engager dans une confrontation sérieuse. Et une confrontation sérieuse présuppose que ceux qui s’assoient pour parler s’intéressent vraiment aux choses dont ils parlent et qu’ils ont donc été prêts à passer du temps à les étudier et à les comprendre, parce que sinon, chaque décennie, il y a une nouvelle tendance muséale. Il s’agit bien sûr d’une limite du débat professionnel sur les musées, qui est fasciné par les questions à la mode, comme la convention de Faro, et néglige les questions fondamentales, par exemple le fait que la majorité des musées italiens ne disposent pas des conditions minimales pour fonctionner et s’ouvrir en toute sécurité.
Pour terminer, une question que l’on pose généralement au début : je la pose à la fin, car je pense qu’elle résume tout ce que nous avons dit. Vous dirigez le musée Galileo depuis quatre ans : pouvez-vous en tirer un bref bilan ?
Je suis content des choses que nous avons pu faire : je me suis toujours efforcé de travailler pour renforcer le travail d’équipe avant tout, parce qu’évidemment, avoir un musée avec des secteurs très spécialisés, c’est toujours le risque qu’ils s’enferment dans leur spécialisation, mais heureusement les projets permettent toujours de travailler entre les différents secteurs du Museo Galileo. Je pense que le réaménagement du rez-de-chaussée a été un bon pas en avant pour notre institut et a permis aux visiteurs de comprendre que, derrière ce qu’ils voient dans les vitrines, il y a un institut qui fait de la recherche, qui en fait dans le monde entier, et qui essaie de garder la dimension de l’étude unie à celle de la communication. En effet : les deux se nourrissent l’un l’autre de manière très étroite, et mon travail est aussi d’essayer de relier de plus en plus les différents fronts qui ont parfois inévitablement tendance à diverger, et de maintenir évidemment un rythme qui s’est beaucoup accéléré, parce que les projets ont grandi, les événements économiques ont grandi (la comptabilité a triplé), les gens ont grandi (quand je suis arrivé, je crois qu’il y avait 40-42 employés, maintenant nous sommes à 65 employés), le nombre de visiteurs a grandi, le budget a grandi aussi grâce à une série d’appels d’offres du PNRR que nous avons remportés. Je suis donc heureux que le musée ait conservé son caractère d’institut de recherche et qu’il ait maintenu son engagement en faveur de formes de communication novatrices, pour lesquelles nous avons également réalisé des innovations intéressantes, notamment grâce à la contribution de sociétés créatives externes et, bien entendu, à des collaborations. Je me réjouis donc que le musée ait pu célébrer son centenaire dans des conditions sereines du point de vue d’un budget qui dépasse aujourd’hui les 4 millions d’euros, ce qui, pour un institut qui s’occupe d’histoire des sciences, représente évidemment un effort important. Et tout cela alors que la bibliothèque continue de s’agrandir et que la collection s’enrichit, car la collaboration avec le ministère nous a permis ces dernières années d’avoir avec nous des objets importants, qui dérivent de l’activité, que le musée exerce, de donner des avis aux surintendances sur le patrimoine historico-scientifique. Nous avions intercepté des objets très beaux et très importants, qui sont maintenant ici avec nous, y compris un nouveau portrait de Galilée. Le personnel s’accroît, y compris les jeunes, ce dont je suis absolument ravi car il est inévitable que nous devions aussi préparer le musée à la retraite de certaines personnes qui y travaillent depuis longtemps, ce qui n’est jamais facile. En bref, je continue à croire que malgré le fait que l’histoire des sciences soit considérée comme une discipline spécialisée, une niche, elle continue à être une niche qui se réunit ici au musée Galileo et produit, évidemment avec une dialectique interne qui est la partie fascinante pour moi d’une façon de comprendre la discipline qui ne voit pas toujours tout le monde d’accord (et c’est quelque chose, à mon avis, de très sain). Le musée est le lieu privilégié où les chercheurs peuvent discuter de leurs projets, de leurs activités et donc, d’une certaine manière, de l’avenir de la discipline. Je pense que le musée doit continuer à être la maison de tous : les historiens des sciences, les philosophes des sciences, les historiens de l’architecture, les historiens de l’art s’y rencontrent, précisément en raison de son caractère absolument multidisciplinaire. De même, les nouvelles lignes de travail qui se sont renforcées ces dernières années, comme l’étude du rapport entre la science et la musique, par exemple avec le colloque sur la figure de Vincenzo Galilei, dont nous allons publier les actes, ou, par exemple, le travail sur le rapport entre les femmes et la science avec l’exposition organisée à la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze(Donne del cielo. Da muse a scienziate), ne sont pas seulement des traces d’un travail qui est l’héritier d’un engagement de plusieurs années, mais aussi une trace importante, à mon avis, de l’avenir. Et sur ce point, je veux être optimiste.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.