Quiconque souhaiterait réaliser un biopic consacré à Elisabetta Sirani disposerait de tous les éléments nécessaires à un film réussi : la figure d’une femme indépendante et cultivée, déterminée à poursuivre un succès extraordinaire, qui s’est effectivement concrétisé ; une histoire d’amour troublante ; un véritable crime se terminant par une enquête judiciaire. Située dans la Bologne du milieu du XVIIe siècle, l’histoire est tout à fait réelle et met en scène une peintre de talent qui dirigeait sa propre “académie”, qui recevait dans son atelier des aristocrates et des têtes couronnées désireux d’admirer son talent et d’acheter ses tableaux, et qui osait même aller au-delà des modèles imposés aux peintres. Elle a même osé dépasser les modèles imposés aux peintres bolonais par le grand maître Guido Reni, en élaborant un langage original qui fait un clin d’œil aux nouveautés du baroque romain. Le nouveau volume de Massimo Pulini, infatigable spécialiste du XVIIe siècle émilien, artiste et professeur de peinture à l’Accademia di Belle Arti de Bologne, retrace la biographie d’Elisabetta Sirani en l’accompagnant de nombreuses œuvres inédites(Il diario di Elisabetta Sirani, NFC edizioni, Rimini, 2025, 288 pages). Celles-ci, ainsi que le corpus déjà connu, sont également liées à ce que l’on appelle le Diario, un registre dans lequel la peintre notait ses commandes les plus prestigieuses et qui est reproduit pour la première fois dans sa version manuscrite.

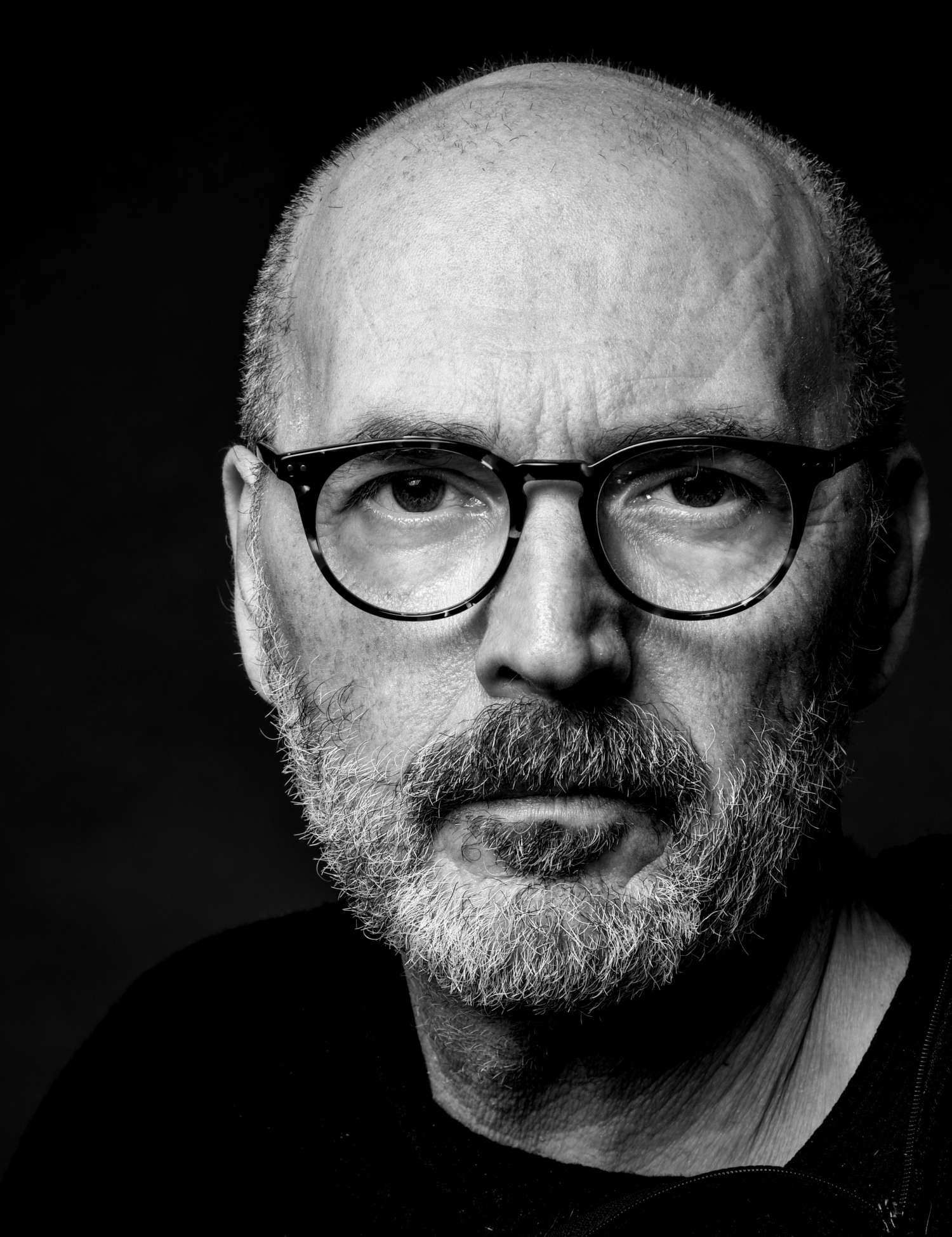
MS. Qui était Elisabetta Sirani, une artiste dont on entend parfois parler et dont on admire quelques rares œuvres dans des expositions de recherche, mais qui n’est pas encore aussi connue qu’elle le mériterait ?
MP. Elisabetta était la fille d’un peintre, Giovanni Andrea Sirani, déjà établi et actif puisqu’il jouait un rôle pédagogique et presque de maître d’œuvre dans l’atelier de Guido Reni. En effet, comme le raconte Carlo Cesare Malvasia, que l’on peut considérer comme le pendant bolonais de Vasari grâce à son recueil de biographies d’artistes de la ville intitulé Felsina pittrice, il formait les élèves de Reni selon une méthode rigoureuse qui consistait à reproduire les inventions du maître. La même approche a probablement été adoptée pour l’éducation de la très jeune fille aînée qui a manifesté très tôt son talent, et Malvasia, qui fréquente l’atelier de Sirani, nous en dit plus à ce sujet. On dit même que la jeune fille fut “découverte” par l’intellectuel lui-même, qui persuada Giovanni Andrea de lui donner une formation professionnelle, ce qui arriva également à deux autres filles.
Elisabetta Sirani n’a-t-elle reçu qu’une formation de peintre ?
Non, nous savons qu’elle atteignit un haut degré de culture, à tel point que le premier versement de chaque année était destiné au professeur de musique : Elisabetta était une excellente joueuse de harpe. Nous pouvons l’imaginer comme une figure semblable à Sofonisba Anguissola, qui était cependant de naissance noble et qui fut appelée à la cour d’Espagne en partie grâce à son éducation de parfaite courtisane. Jean-André aspirait probablement à quelque chose de semblable pour ses filles, mais cela signifiait aussi un certain niveau d’autonomie intellectuelle qui fit qu’Élisabeth devint bientôt meilleure que son père.
Malgré la vénération de son père et des artistes bolonais pour Guido Reni, Elisabetta s’est rapidement écartée de la tradition et a développé une nouvelle langue, n’est-ce pas ?
Lorsque Guido Reni meurt en 1642, Elisabetta n’a que quatre ans et n’a donc pas pu le rencontrer en personne, mais il y a dans la maison paternelle plusieurs œuvres du maître, dont certaines sont inachevées et destinées à être complétées par Giovanni Andrea, seul habilité à le faire. Dès ses premières œuvres, cependant, la peintre montre qu’elle veut être autonome et on ne connaît aucune copie de Reni ; cela ne signifie pas qu’elle n’en a pas fait, elle y était probablement obligée par son père, mais l’adolescente (elle avait en fait une quinzaine d’années lorsqu’elle a commencé à peindre) a développé une créativité indépendante, spontanée et très rapide qui l’a rendue vraiment célèbre. On sait que lorsqu’elle recevait des commandes, Elisabeth faisait des dessins d’impression de l’idée qui deviendrait plus tard le tableau. L’indépendance et la qualité de la pensée se retrouvent également dans ses tableaux, dans la façon dont elle prépare les sujets mythologiques ou allégoriques.
Le désir d’autonomie est également confirmé par sa signature pour distinguer ses œuvres de celles de son père...
En effet, ses premiers succès furent suivis d’une série de calomnies selon lesquelles c’était son père qui avait peint certaines toiles, raffinées au point de rivaliser avec celles du grand Reni. Cela incita Elisabeth à signer les tableaux, un peu comme l’avait fait avant elle Lavinia Fontana, également à Bologne. Cependant, les rumeurs continuent de circuler et se multiplient lorsque, vers l’âge de 20 ans, elle reçoit la commande de la toute jeune église de San Girolamo alla Certosa pour le gigantesque tableau du Baptême de Jésus. Cette commande était l’une des plus convoitées par les peintres bolonais et l’artiste ne s’est pas contentée de répondre à la prestigieuse commande, elle a également réussi à gérer une foule de personnages, créant ainsi une scène sacrée d’une grande complexité. Il y appose ensuite sa signature en grosses lettres.
Peut-on dire que Bologne était une ville très compétitive dans le domaine artistique, et que cette atmosphère a profondément marqué la vie et la mort d’Elisabetta Sirani ?
Bologne était à l’époque la ville avec la plus grande concentration de peintres par rapport à ses habitants. Plus que Rome, Naples, Gênes : c’est parce que non seulement les artistes autochtones y séjournaient, mais aussi beaucoup d’autres venus de l’extérieur, et ce depuis plusieurs décennies déjà. L’Académie des Carrache d’abord, puis les ateliers de Reni et de Guercino, étaient de véritables industries. Ces “foules” rendent le milieu extrêmement compétitif et sous les arcades de Bologne, les rumeurs malveillantes vont bon train. De plus, la ville était très attachée à sa tradition artistique, qui en faisait à juste titre l’une des capitales européennes de la peinture, mais cela entraînait en même temps une certaine fermeture, une autosuffisance que Giovanni Andrea Sirani lui-même manifestait. L’aération, la fraîcheur et l’ouverture, la joie et l’allégresse des œuvres d’Elisabetta (tout en restant dans la tradition bolonaise) se présentent donc comme des nouveautés. En particulier dans les derniers tableaux, on peut percevoir dans les draperies et les expressions des personnages un coup de pinceau ondulé qui évoque Rome, Carlo Maratta, Giovan Battista Gaulli, bien que nous ne sachions pas comment elle a connu le baroque romain. Peut-être à travers les peintures, les dessins et les gravures qui parviennent à Bologne, il visite également la cour de Modène où il admire Vélasquez ; et il n’est pas exclu qu’il ait voyagé en Italie centrale avec son père.








Malgré son désir d’étudier à Florence ou à Rome, son père la retient dans son atelier et l’empêche de partir. Pourquoi ?
Après avoir reçu le titre d’académicienne de l’Accademia di San Luca, Élisabeth espère partir étudier à Florence ou à Rome, mais son père refuse de la laisser voyager seule, notamment parce qu’il a alors des problèmes de santé et que l’aide d’Élisabeth dans son atelier est devenue cruciale pour l’entreprise. C’est en effet la fille qui fait avancer la famille sur le plan financier, notamment parce que ses toiles coûtent beaucoup plus cher que celles de Giovanni Andrea. C’est à ce moment-là qu’elle répondit à son père par une phrase historique : “Si je ne peux pas quitter Bologne, je préfère ne même pas quitter la maison. Mais je veux mon école ici”. Une école exclusivement féminine.
Cette école de femmes peintres est-elle unique dans le paysage italien du XVIIe siècle ?
Oui, Elisabetta appelait son école une “académie” et parvenait à faire participer jusqu’à 15 élèves féminines en même temps, y compris des nobles et des femmes mariées de Bologne qui profitaient de l’occasion pour assister aux cours de Sirani et de Ginevra Cantofoli ; cette dernière avait 20 ans de plus qu’Elisabetta et avait elle-même été l’élève de Giovanni Andrea. L’académie des femmes fut longtemps la première et la seule académie, mais après la mort d’Elisabeth, elle fut malheureusement démantelée. Certaines femmes peintres ont cherché du travail dans d’autres ateliers, mais bien que les femmes artistes aient été publiquement et officiellement considérées à Bologne, il y a toujours eu des gens qui les ont rejetées.
Dans votre toute récente monographie, vous reconstituez le corpus d’Elisabetta Sirani, en publiant également de nombreuses œuvres inédites. Combien cette peintre a-t-elle dessiné et peint ?
En 30 ans de recherche, j’ai réussi à retrouver 55 dessins, gravures et peintures inédits et l’élément déclencheur de la publication de ce livre a été la découverte à Montefiascone des 15 tablettes avec les Mystères du Rosaire. Au total, le corpus d’ Elisabetta compte actuellement près de 400 pièces : une quantité considérable si l’on considère qu’elle a travaillé pendant un peu plus de dix ans.
Dans le livre, les œuvres sont également contextualisées dans la “grille” du journal de l’artiste. Outre le fait qu’il constitue une source inestimable pour reconstituer la carrière de l’artiste, pourquoi ce manuscrit est-il si important ?
Elisabeth a commencé à rédiger ce journal en 1655 et l’a mis à jour jusqu’en 1665, peu avant sa mort, et la première œuvre mentionnée est un retable qu’elle a réalisé pour la marquise Spada. Il ne s’agit certainement pas de sa première œuvre, ce qui en dit long sur le fait qu’il avait déjà démontré son talent. En particulier, Sirani note dans le manuscrit les commandes, c’est-à-dire uniquement les œuvres qu’on lui a demandées, et indique aussi bien le thème que le nom et le prénom de la personne à qui l’œuvre est destinée. En outre, elle note les visites de personnes de haut rang qui lui rendent visite : par exemple, la duchesse Enrichetta de Savoie est venue dans son atelier et le peintre a peint un cupidon devant elle. De nombreux souverains et nobles de passage à Bologne ne manquaient pas d’aller observer en personne le travail de cette femme peintre, devenant ainsi les témoins de ses compétences. Dans le Journal, en revanche, de nombreuses autres œuvres - également signées et datées - que Sirani a réalisées de sa propre initiative ne sont pas mentionnées, mais sont tout aussi autographiées.
Quelles sont les autres curiosités qui ressortent de l’analyse du journal ?
Un aspect curieux est qu’Elisabetta Sirani a été recherchée pour sa capacité à créer des portraits post mortem. Tout a commencé avec un premier portrait de son père inquisiteur Guglielmo Fochi, qui a été très apprécié comme quelque chose de vivifiant, capable de ramener le personnage à la vie. Le mot s’est ensuite répandu et lorsqu’un gentilhomme ou un aristocrate décédait et qu’aucun portrait récent n’était disponible, Elisabeth était convoquée et, pendant la veillée funèbre, elle réalisait des esquisses comme celles conservées au Royal Collection Trust à Londres. L’effigie d’une enfant tenant un bouquet de fleurs a probablement été réalisée post mortem, la fleur coupée étant un symbole de la mort. Il est frappant d’imaginer cette petite fille peintre qui, pendant la récitation du rosaire, montait sur une chaise pour observer le visage du cadavre dans la bonne perspective, en notant ses traits dans le carnet : c’est une scène très cinématographique.








Passons du thème de la mort à celui de l’amour... Quels ragots supposez-vous à partir des sources écrites ?
Nous avons déjà évoqué l’intérêt de Malvasia, qui était chanoine, pour le talent d’Elisabeth, mais il est surprenant de lire attentivement la biographie qu’il a écrite pour le peintre Felsina. Outre un long proème très rhétorique, l’auteur adopte un phrasé totalement différent de celui des autres vies, à tel point que Luigi Crespi, en réécrivant Felsina cent ans plus tard, affirme que le canon semblait obscurci par le chagrin. Je pense donc que Malvasia était sincèrement amoureux de la jeune Elisabetta, à tel point qu’à un moment donné, le canon passe de la troisième à la deuxième personne, en appelant le sujet “tu”. Il fait même allusion à de futures retrouvailles et, quelques années après la mort de la jeune fille et malgré les preuves d’une mort naturelle, il lance des anathèmes à ceux qu’il considère comme coupables de l’empoisonnement de Sirani. Enfin, nous savons qu’il a commandé à Elisabeth des allégories de vertus et de concepts moraux qui apparaissent comme des autoportraits presque allégoriques. Ce n’est qu’une hypothèse, mais tout indique une pensée amoureuse de Malvasia, peut-être simplement chaste... et nous ne savons pas si elle a été réciproque.
Nous terminons cette interview par le grand final tragique, la mort d’Elisabeth. Comment sa vie s’est-elle achevée à seulement 27 ans ?
Après quelques semaines passées à supporter des douleurs très aiguës, elle est morte d’un ulcère chronique perforé, ce qui a été certifié par une seconde autopsie, après celle pratiquée par le médecin traitant, qui avait retenu l’hypothèse d’un empoisonnement. Cette mort subite avait plongé le père dans le désespoir et, inconsolable, il accusa un domestique d’avoir empoisonné sa fille. Il ne faut pas oublier que les sentiments d’envie mentionnés plus haut de la part de nombreux artistes qui n’avaient pas réussi à obtenir autant de succès qu’Elisabeth étaient toujours présents. Malvasia continue néanmoins à croire à l’hypothèse de l’empoisonnement, comme nous l’avons déjà dit, “même si ce n’est pas vraiment chrétien”, écrit-il. Une question se pose donc inévitablement : si Elisabetta Sirani avait vécu plus longtemps, elle aurait peut-être aujourd’hui dépassé en notoriété la célèbre Artemisia Gentileschi et aurait certainement contribué à répandre un souffle de modernité dans la Bologne de la seconde moitié du XVIIe siècle.

L'auteur de cet article: Marta Santacatterina
Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.