Le Studio d’Arte Raffaelli, galerie historique d’art contemporain de Trente, a récemment fêté ses quarante ans : fondé en 1984 par Giordano Raffaelli, qui le dirige encore aujourd’hui, il est devenu au fil du temps un point de référence important pour les amateurs d’art, en particulier pour l’art africain, l’art américain des années 1980 et l’art figuratif italien à partir de la Transavantgarde. Axé sur la peinture, avec des incursions également dans la photographie et la sculpture, le Studio Raffaelli s’est distingué au fil des ans pour avoir été la première galerie italienne à organiser une exposition d’un artiste africain, pour avoir lancé en Italie les artistes du New York des années 1980 tels que Donald Baechler, Ross Bleckner, Philip Taaffe, Peter Schuyff et d’autres, et pour ses longues collaborations avec des artistes africains, à commencer par Zanele Muholi, qui a été lancé en Italie par la galerie basée à Trente. À l’occasion de cette étape importante, nous avons rencontré Giordano Raffaelli pour connaître l’histoire de la galerie, ses recherches et pour parler brièvement de la situation actuelle du jeune art contemporain italien. L’interview est réalisée par Federico Giannini.

FG. Votre galerie a été ouverte en 1984, elle vient donc d’avoir 40 ans. Mais nous savons que vous avez travaillé dans le secteur de l’art contemporain bien avant cela... Pourriez-vous nous parler de vos débuts en tant que marchand d’art et galeriste ?
GR. Mon père connaissait un artiste istrien qui avait été déplacé dans le Trentin après la guerre (Romano Conversano, un artiste du groupe de Migneco, Guttuso et les artistes figuratifs de leur cercle). Ils s’étaient rencontrés ici même, dans le Trentin, après la guerre. Ensuite, dans les années 50, Conversano avait acheté le château de Peschici, au sommet de la forteresse, avec vue sur la mer : il nous invitait plusieurs fois en été, et là, je voyais arriver des voitures de Milan avec certains personnages qui prenaient ses tableaux, marchandaient, puis les enveloppaient dans des couvertures et repartaient pour Milan. J’étais fasciné par les histoires de ces gens qui faisaient deux jours de voyage pour prendre deux ou trois tableaux et qui revenaient ensuite les vendre à Milan. C’est là que j’ai eu mes premiers contacts avec les marchands d’art. Au début de ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer deux personnes importantes dans le monde de l’art. Le premier était un collectionneur, Carlo Cattelani, un fermier de Modène qui vivait dans une maison à la campagne et qui recevait de nombreux artistes importants dans sa maison et achetait leurs œuvres. Il a été le premier à s’occuper de Salvo, Montesano, De Dominicis, Nitsch, de tout le groupe Fluxus et de beaucoup d’autres. Avec la chance d’avoir ces connaissances et d’entrer dans ses sympathies, j’ai réussi à entrer dans le cercle qui comptait un peu, parce qu’à l’époque, à partir de Trente, ce n’était pas du tout facile. Le deuxième est Luciano Pistoi, que j’ai connu par l’intermédiaire de Cattelani et avec qui j’ai collaboré plusieurs fois au fil des ans pour son événement au château de Volpaia. C’est à partir de là qu’a commencé l’histoire de ma galerie.
Quelles sont les principales lignes de recherche qui ont guidé la galerie au cours de ces années et qui la guident encore aujourd’hui ?
Une seule : celle de la peinture. Une peinture avec, peut-être, parfois quelques ouvertures d’origine conceptuelle, mais nous nous occupons de peinture, même lorsque nous cherchons des jeunes. Il peut y avoir aussi la photographie, mais toujours là où il y a une image picturale. En photographie, par exemple, nous avons d’abord travaillé avec des artistes africains des années 60 et 70, comme Malick Sidibé, Seydou Keïta, Jane Alexander, et bien d’autres, qui pratiquaient ce type de photographie où il n’y a pas de références à la peinture occidentale, mais une recherche de leurs propres traditions, de leurs propres origines.


D’ailleurs, quand on reconstruit l’histoire du Studio Raffaelli, tout le monde rappelle que vous avez été le premier galeriste italien à organiser une exposition d’un artiste africain : c’était, si je me souviens bien, en 1991 et vous aviez fait venir Chéri Samba en Italie pour la première fois. Aujourd’hui, l’art africain est devenu une sorte de mode, mais dans ces années-là, que signifiait travailler avec l’Afrique et les artistes africains ?
Tout le monde ne se souvient pas qu’avant 1989, et en particulier avant l’exposition des Magiciens de la Terre au Centre Pompidou à Paris, l’art contemporain n’était pratiquement qu’occidental : il n’y avait pas d’art chinois, pas d’art oriental, et pas d’art africain de quelque sorte que ce soit. Avec l’explosion de cette exposition, l’attention s’est également déplacée vers d’autres continents. J’ai saisi la balle au bond, j’ai rencontré le marchand de Chéri Samba à Paris et c’est avec lui que j’ai organisé la première exposition, en partie grâce à la poussée de ma femme, qui était enthousiasmée par cet artiste. Ce fut une exposition difficile, car les peintures étaient déjà chères à l’époque, et pendant les six premiers mois, nous n’avons rien vendu, si bien que j’ai dû acheter toutes les peintures de l’exposition. Mais ensuite, j’ai eu une grande satisfaction, car un musée canadien et un musée japonais m’ont acheté deux tableaux chacun, et à partir de cet épisode, ma chance a commencé à tourner.
Vous avez travaillé et continuez à travailler avec d’importants artistes new-yorkais des années 1980, tels que Baechler, Taaffe, Schuyff et bien d’autres. Quel type d’art votre galerie recherchait-elle et recherche-t-elle toujours en Amérique ?
L’art qui me tient le plus à cœur. Il s’agissait de l’art perturbateur de ces années-là, les années 1980. Et puis un peu de tous les étudiants de ce mouvement... qui n’existait pas en tant que tel, comme, par exemple, la Transavantgarde. Il y avait cependant un sentiment commun qui traversait le monde de l’art, de la littérature, de la musique à New York dans ces années-là. Malheureusement, je n’ai pas pu contacter les deux artistes qui sont devenus plus tard peut-être les plus importants, à savoir Keith Haring et Basquiat : j’ai eu quelques années de retard, parce que je suis devenu plus tard un très bon ami d’Annina Nosei, et nous avons ensuite collaboré avec elle à plusieurs reprises. J’achetais ses artistes et organisais des expositions de ses artistes, et elle suivait mon exemple en organisant des expositions de Montesano, Galliano et d’autres artistes italiens avec lesquels je travaillais à l’époque. J’ai également travaillé avec des artistes qui avaient étudié avec Donald Baechler, comme Brian Belott, Taylor McKimens et d’autres, qui connaissaient bien l’art de cette période et qui ont suivi ce genre de sentiment en le renouvelant.
Dans le catalogue d’une exposition que votre galerie a organisée il y a quelques années (9 New York of 2018), dans une conversation avec Alan Jones, vous dites que votre approche de ces artistes est celle de l’éditeur qui suit l’auteur livre par livre. En gros, vous avez pris ces jeunes artistes et les avez suivis jusqu’à ce qu’ils s’établissent, jusqu’à ce qu’ils deviennent des maîtres.
Oui, et j’aimerais dire que je les ai suivis contre vents et marées, car même dans les périodes difficiles, j’ai toujours essayé de les soutenir, même financièrement lorsqu’ils étaient en difficulté. Si je tombe amoureux d’un artiste, j’aime le suivre pour toujours.
Et aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de galeristes qui raisonnent ainsi.
Non, en fait, je voudrais aussi dire que le plus beau compliment que j’ai jamais reçu d’un artiste a été de me dire que j’étais un “galeriste à l’ancienne”. Cela m’a fait plaisir. Parce que je pense que c’est juste. Nous ne sommes pas des vendeurs de viande en conserve : nous vendons de l’art, et nous devons donc essayer de nous comporter d’une certaine manière.




Continuez-vous à rechercher de jeunes artistes aujourd’hui ou préférez-vous suivre des artistes qui se sont établis avec la galerie au fil du temps ?
Nous essayons de suivre les deux lignes : en ce moment même, nous partons pour New York et nous organisons une exposition en octobre d’un jeune artiste américain de 35 ans qui n’est pas connu en Italie. Ce sera une exposition très intéressante : c’est un artiste d’origine hongroise qui réalise de petites peintures représentant la réalité des rues de New York, des théâtres et des cinémas new-yorkais. En même temps, il y aura une exposition de son frère, qui est photographe et qui prend des photos des mêmes situations. Il est intéressant de savoir que son grand-père était un peintre hongrois important, très célèbre, qui, à un certain moment de sa carrière, s’est transformé en photographe. En fait, il existe des photographies de lui, par exemple, photographiant Franz Liszt jouant du piano et d’autres situations de ce genre. Il est intéressant de voir comment les deux petits-fils se sont consacrés l’un à la peinture et l’autre à la photographie, et comment cette famille impliquée dans la culture de l’Empire austro-hongrois s’est perpétuée au fil des ans et avec de bons résultats. Ce sera une très belle exposition, à mon avis.
Puisque le Studio Raffaelli continue également à essayer de découvrir de nouveaux jeunes, j’aimerais vous demander comment vous reconnaissez un artiste, un jeune talent, selon vous. Puisque, dites-vous, vous tombez amoureux des artistes, quelle est l’étincelle qui déclenche ce coup de foudre ?
Pour moi, c’est l’instinct. Pour d’autres, ce peut être l’étude, la recherche... pour moi, je le répète, c’est l’instinct : il ne me faut que quelques secondes lorsque je vois un artiste pour la première fois. Et si, dans ces cinq secondes, il y a un déclic, tant mieux, sinon il m’est difficile de tomber amoureuse dans deux mois, en revoyant les mêmes choses.
Une approche émotionnelle donc.
Oui, c’est vrai. Uniquement émotionnelle. Absolument.
Nous avons parlé tout à l’heure d’Annina Nosei et de votre collaboration : lorsque Annina Nosei a amené la Transavanguardia en Amérique, vous avez amené des artistes américains en Italie. Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Lorsque je me rendais à New York, j’allais voir les dernières expositions qu’elle avait réalisées, elle me montrait aussi les restes des expositions précédentes, et si un artiste me plaisait, nous organisions l’exposition chez moi. Par exemple, nous avons organisé une exposition de Jenny Watson, qui avait réalisé l’ensemble du pavillon australien à la Biennale de Venise en 1993 : Annina Nosei avait fait plusieurs expositions avec elle. Ensuite, je lui suggérais des artistes italiens susceptibles de l’intéresser. Je me souviens toujours du voyage que j’ai fait avec Montesano en été à Ansedonia, dans la maison d’Annina Nosei, et lorsque je l’ai présenté à elle, elle était enthousiaste. C’était une collaboration de connaissances que nous échangions pour faire de nouvelles choses, pour inventer de nouvelles choses et pour promouvoir de nouveaux artistes.
Nous parlons bien sûr d’il y a trente ou quarante ans. Mais aujourd’hui, existe-t-il encore, selon vous, cette relation d’échange entre galeristes italiens et américains ou s’est-elle perdue avec le temps ?
Elle s’est perdue, sans aucun doute, parce qu’avec les grandes galeries aujourd’hui, il est impossible de parler, d’avoir une relation personnelle. Je connaissais bien Barbara Gladstone, mais elle est décédée il y a un an. Il est difficile de parler aux galeristes de la nouvelle génération parce qu’aujourd’hui, aux États-Unis, le système de travail est différent. Le mode de vie est différent. C’est donc plus compliqué. Mais récemment, je me suis promis, avec ma fille Virginia qui travaille maintenant avec moi dans la galerie, de rétablir les relations avec certaines galeries, d’essayer de promouvoir nos artistes aux États-Unis et de promouvoir leurs artistes ici. Pendant un certain temps, j’ai peut-être un peu abandonné, mais, comme je l’ai dit, je me suis promis d’essayer à nouveau, même si ce n’est pas facile, parce que la dynamique est différente de ce qu’elle était auparavant.
Qu’est-ce qui a changé en pire depuis les années 1980 ?
Nous avons affaire à des multinationales : je veux parler des grandes galeries qui font un peu le gros du travail dans le monde de l’art. Il est pratiquement impossible de travailler avec elles. Il est même difficile d’entrer en contact avec elles.
Cette situation a donc naturellement porté préjudice à l’art italien, en ce sens que l’art italien n’est plus en mesure aujourd’hui de s’établir en Amérique comme il l’a fait par le passé.
Oui, aussi parce que pour s’affirmer en Amérique, il faut y vivre. Il n’y a rien à faire. Et ici, en Italie, il n’y a pas beaucoup de jeunes artistes prêts à travailler dur. Il faut du courage pour se frayer un chemin dans une ville où il y a peut-être dix mille artistes et deux mille galeries, et ce n’est pas facile. Il faut vraiment une force énorme et il n’y a pas beaucoup d’artistes qui réussissent à l’avoir en ce moment, à mon avis.
Toutefois, en ce qui concerne les artistes italiens, plusieurs d’entre eux travaillent avec le Studio Raffaelli. L’exposition de Willy Verginer s’est achevée il y a quelques heures, par exemple, mais votre galerie travaille également avec des artistes plus jeunes. Sur quelle base choisissez-vous les artistes italiens ? Et comment voyez-vous l’art italien aujourd’hui ?
Mon fils Davide travaille principalement avec des artistes italiens et collabore avec de nombreux jeunes artistes italiens. Il y en a beaucoup de bons, mais à mon avis, il manque ceux qui ont l’inspiration, ceux qui peuvent aller jusqu’au bout. En Italie, il y a aujourd’hui beaucoup de bons artistes, mais il manque le champion. Cela vaut pour beaucoup d’autres domaines, dans le sport par exemple, où il y a une moyenne très élevée de très bons athlètes, mais où l’on ressent l’absence d’un grand champion. La seule exception est peut-être notre Jannik Sinner, le seul qui puisse être comparé aux champions d’antan. Même dans le domaine de la peinture en Italie, il y a beaucoup de bons auteurs, beaucoup de bons peintres, mais il manque celui qui a le coup de pouce. Mais c’est peut-être ainsi que va le monde aujourd’hui. Même en musique, j’ai du mal à penser aux Beatles d’aujourd’hui ou aux Rolling Stones d’aujourd’hui.
Vous avez parlé de votre fils, Davide, qui, en collaboration avec Camilla Nacci Zanetti, a ouvert la galerie Cellar Contemporary, qui promeut le travail de jeunes artistes italiens et internationaux. Et bien sûr, il collabore avec vous. Comment se passe le travail avec votre fils ?
Je m’entends bien. J’ai une très bonne relation avec mes deux fils. Il y a bien sûr des luttes et des discussions, mais Davide dirige sa galerie depuis près de huit ans et nous travaillons toujours bien ensemble, la relation entre les deux galeries est très ouverte et très collaborative. Récemment, par exemple, il a participé à une foire en Afrique du Sud avec sa galerie, mais il a également apporté certaines de nos œuvres.
Quels sont les sujets sur lesquels vous avez les discussions les plus animées ?
Pas sur le choix des artistes : nous sommes presque toujours d’accord sur ce point. Nous sommes également d’accord sur le choix des œuvres. Nous nous disputons plutôt à propos de... petites choses de tous les jours.


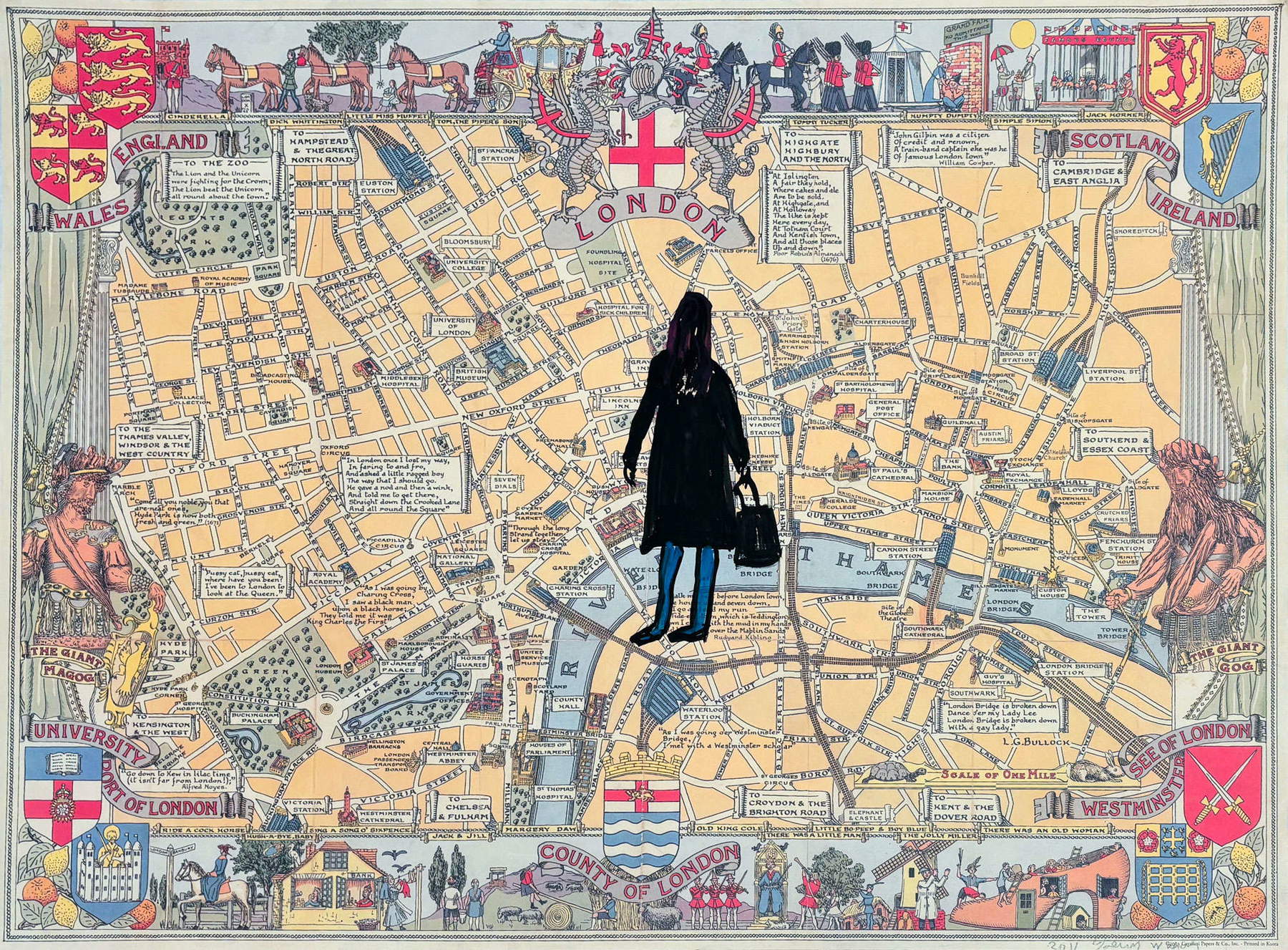
Pour en revenir à ce que vous avez dit au début, à savoir que le Studio Raffaelli a toujours travaillé avec la peinture, il s’ensuit que vous ne vous intéressez pas à des formes d’art telles que les installations à grande échelle, l’art vidéo, etc. Pourquoi ce choix de se concentrer uniquement sur la peinture et la sculpture ?
Parce que ce qui me procure de l’émotion, c’est avant tout la peinture. Et puis la peinture est la forme d’art que je pense comprendre le mieux. C’est tout. Et puis je crois aussi qu’un galeriste ne peut pas devenir un touche-à-tout et tout faire. J’ai essayé de me spécialiser dans ce domaine du mieux que j’ai pu et j’ai continué ainsi. Avec quelques incursions dans la photographie aussi, mais seulement dans la photographie d’un certain type.
Et puis, je veux dire : c’est un domaine qui vous a donné tant de satisfaction...
Oui, bien sûr. Même sur la peinture africaine, il y aurait vraiment un chapitre à ouvrir. Et puis ne parlons pas de la photographie africaine, c’est la même chose, parce qu’il y avait tellement de photographes de studio dans les années 1960-1980, il n’y avait pas que Malick Sidibé, Bob Bobson ou Seydou Keïta, il y en avait tellement d’autres, mais il faudrait une galerie qui ne fasse que ce genre de travail. Et elle trouverait de belles choses : je pense par exemple à Sanlé Sory, à beaucoup de photographes que personne ici ne connaît, et qui sont vraiment très bons.
A-t-il été facile de proposer ce type d’art au public italien, aux collectionneurs italiens, aux acheteurs italiens, ou cela n’a-t-il pas été immédiat ?
Je peux dire que la réponse a été frappante dans certains cas : lorsque nous avons fait la première exposition de Bob Bobson, un photographe de studio, le seul à l’époque à prendre des photos en couleur (nous l’avons présenté lors d’une édition de Miart), nous avons reçu une réponse extraordinaire de la part de la presse, sans que nous ayons fait quoi que ce soit d’autre. Je dirais que c’est la plus grande réponse de la presse que nous ayons jamais eue dans notre carrière. Nous avons également reçu un retour d’un public de haut niveau très important. Même lorsque nous avons organisé l’exposition de Zanele Muholi au début des années 2000 (la première exposition en Italie), c’était une artiste totalement inconnue, mais même à ce moment-là, nous avons eu une bonne réponse. Même ici, dans la province, de la part de collectionneurs de Trente. Des collectionneurs de Trente qui, par la suite, ont également été satisfaits d’un point de vue économique, car les prix de Zanele Muholi ont été multipliés par dix depuis la première exposition que nous avons organisée à l’occasion de la Manifesta qui s’est tenue cette année-là à Trente.
Mais aujourd’hui, tout le monde connaît Zanele Muholi. C’est vous qui l’avez fait venir en Italie et qui l’avez fait connaître.
Oui, j’ai été le premier à organiser une exposition du travail de Zanele Muholi en Italie : il s’agissait d’une petite exposition avec vingt photographies de Zanele Muholi, dont personne ne connaissait l’existence à l’époque. J’ai pu le faire parce que j’avais beaucoup voyagé en Afrique du Sud : j’avais vu son travail dans la galerie qui s’occupait d’elle à Campo City, et j’ai acheté la vingtaine de photos avec lesquelles nous avons ensuite réalisé l’exposition. C’était aussi un risque.
À ce propos, puisque vous m’ouvrez le sujet : votre goût du risque a-t-il augmenté au fil des ans, est-il resté stable, a-t-il diminué ? Et puis, pensez-vous que les galeristes d’aujourd’hui sont toujours aussi frileux que vous l’étiez peut-être à l’époque ?
Je dois dire que je n’ai pas pris beaucoup de risques : il y a des galeristes de mon âge et de ma génération qui ont vraiment sauté le pas et pris des risques énormes. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup, ils essaient tous de jouer la carte de la sécurité, de vivre. Je vois beaucoup de très bons galeristes, mais ils travaillent de manière homogène, chacun s’occupant de ses cinq ou six artistes. Je ne sais pas comment le dire : disons qu’aujourd’hui je ne vois pas de galeriste comme Sperone. C’est un peu ce qu’on a dit tout à l’heure pour les artistes. Pour les artistes comme pour les galeristes, nous sommes arrivés à un nivellement de la qualité, qui est quantitativement beaucoup plus élevé, en ce sens qu’il y a beaucoup plus de bons artistes et galeristes qu’auparavant, mais qualitativement, il y a un manque de figures de proue. C’est aussi ce que j’ai constaté dans les différentes foires, où il est difficile de voir de jeunes artistes vraiment intéressants.
Pour conclure : l’une des particularités de votre galerie réside dans le fait que vous invitez souvent des artistes à séjourner dans le Trentin. Presque tous les artistes qui collaborent avec vous sont physiquement passés par Trento. Pourquoi considérez-vous que ce contact des artistes avec le territoire dans lequel vous travaillez est important ?
Tout d’abord parce qu’ils peuvent parfois être inspirés par un thème qu’ils ne peuvent développer qu’en séjournant ici pendant un certain temps, ou ils peuvent assimiler des aspects de la ville et du territoire qu’ils peuvent ensuite intégrer dans leur travail. Je me souviens d’une des premières expositions d’Ontani, intitulée Trentazioni: il avait réalisé une série de peintures inspirées par la situation géographique, les montagnes, tout ce qu’il pouvait trouver ici. La dernière en date est Melissa Brown, qui est venue ici il y a un an, a visité le Castello del Buonconsiglio, s’est concentrée sur certains objets et les a ensuite sérigraphiés sur le fond de ses peintures. Je pense donc qu’il est intéressant que des artistes travaillent à Trente, car c’est aussi une ville intéressante d’un point de vue historique et artistique. Il est intéressant de les faire vivre un certain temps ici et d’établir ensuite une relation qui peut également s’exprimer dans une relation qui est quotidienne pendant au moins une certaine période, et qui le reste ensuite pour toujours. Je parle de relation humaine et de relation artistique.
Et j’imagine que les artistes seront ravis de travailler à Trente lorsqu’ils arriveront !
Oui, surtout les Américains, mais les artistes italiens ont toujours été heureux aussi. Et ils se sentent un peu en famille. Ils nous l’ont dit. Plusieurs fois, ils ont même dit : “Nous nous sentons comme une famille”. Bref, nous travaillons très bien. On essaie donc d’établir une amitié qui peut ensuite durer. Bien sûr, elle peut aussi être interrompue pendant des années, mais elle reste toujours une connaissance assez profonde qui ne peut pas être oubliée.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.