En mémoire du grand écrivain Raffaele La Capria, décédé le 26 juin dernier à Rome à l’âge de 99 ans, nous publions cette interview de La Capria, accordée en 2008 à Bruno Zanardi, au sujet de la longue amitié qui unissait La Capria et Giovanni Urbani. Il en ressort un portrait important de deux grands hommes et intellectuels, modernes et visionnaires, avec en toile de fond les événements qui ont affecté le patrimoine culturel italien entre les années 1950 et 1970.
Je rencontre Raffaele La Capria dans son appartement labyrinthique du Palazzo Doria, dont les fenêtres laissent entrevoir une Rome encore plus douce et paresseuse en cette chaude journée d’octobre. Nous commençons à évoquer Giovanni Urbani avec affection et mélancolie. Rapidement, cependant, la conversation prend la forme d’une confrontation d’opinions. Une confrontation serrée mais douce, à l’image des défis intellectuels affectueux auxquels Raffaele se livrait souvent avec Urbani. “Tu te souviens, Giovanni, comment nous nous sommes amusés ensemble ?” est la phrase qu’il a prononcée à plusieurs reprises lors de l’émouvante oraison funèbre d’Urbani, à l’église de San Giacomo degli Incurabili, dans la matinée du 10 juin 1994. C’est Raffaele qui a accompagné le corps jusqu’à l’incinération et qui “a vu, en sortant (...), une épaisse fumée huileuse s’échapper de la grande cheminée et se disperser dans le ciel bleu clair”. Cette fumée, c’est John qui s’en va, pensai-je". C’est ce qu’il raconte dans L’estro quotidiano, un roman écrit en grande partie “pour se souvenir de Giovanni”.

BZ. Quand avez-vous rencontré Urbani pour la première fois ?
RLC. À Rome, au printemps 1957. Nous étions tous deux Italiens et avions été invités à l’un des séminaires internationaux de Harvard sur la politique, l’économie et l’art. Il voulait me rencontrer parce que ces séminaires duraient plusieurs mois et que nous devions donc être ensemble depuis longtemps. Nous avons pris rendez-vous à la RAI, où je travaillais à l’époque. Je suis allée l’attendre sur le palier de l’escalier menant à mon bureau. Il a franchi les dernières marches qui nous séparaient en me tendant la main en signe d’amitié. Avec ces deux gestes d’une aisance et d’une énergie immédiates, c’est une sorte de modèle esthétique d’homme qui est apparu devant moi. Un jeune homme grand, svelte, voûté, au visage aimable et discrètement joyeux, très élégant dans un costume de gabardine légère manifestement taillé par un grand tailleur: en bon Napolitain de l’époque, j’ai beaucoup regardé les costumes et les tailleurs. Et tout de suite, cet étranger m’a semblé être quelqu’un avec qui il était naturel de se lier d’amitié. Comme le Lord Jim de Conrad, “l’un des nôtres”.
Sans pouvoir imaginer alors que la “perception aiguë de l’intolérable” de Jim était la même que celle d’Urbani. Et sans savoir encore que Lord Jim était l’un de ses livres de chevet: celui qu’il emporte avec lui lorsqu’il s’en va mourir dans une maison de retraite romaine à cause d’un chirurgien honni. L’exemplaire dans l’édition historique Bompiani à la couverture bleu clair des œuvres de Conrad, que vous avez vous-même gardé en mémoire, et qu’il avait laissé ouvert sur la table de nuit avec un très bref portrait de Jim souligné dans lequel il se reconnaissait évidemment: “Un de ces hommes aux qualités brillantes, pas stupides au point d’éclore le succès et qui finissent souvent leur carrière dans la disgrâce”. Mais qui vous a choisi pour participer au séminaire de Harvard ?
Je ne le sais pas. Ce sont les Américains qui ont décidé sur la base de leurs propres considérations, dont la principale, je crois, était que Giovanni et moi appartenions au courant pro-occidental de l’intellectualité italienne. La société libérale très précise qui gravitait autour de “Il Mondo” de Mario Panunzio ou de “Il Punto” de Vittorio Calef, deux revues sur lesquelles Giovanni a beaucoup écrit entre la seconde moitié des années 50 et le début de la décennie suivante, beaucoup plus sur la seconde que sur la première. La société intellectuelle sur laquelle planait encore l’ombre de Benedetto Croce et l’engagement civil de Gaetano Salvemini était composée de personnalités telles que Ennio Flaiano, Alberto Moravia, Elsa Morante, Giorgio Bassani, Sandro De Feo, Vincenzo Talarico, Mino Maccari, Giovanni Russo, Paolo Milano et bien d’autres. Je sais qui nous a proposé de participer à ce séminaire. Giovanni a été indiqué par Cesare Brandi, moi par Ernesto Rossi, pilier de “Il Mondo” et auteur de livres-enquêtes célèbres comme Settimo non rubare ou I padroni del vapore, qui dénonçaient déjà cette coupure entre la politique et la société civile qui est aujourd’hui sous les yeux de tout le monde.
Brandi a recommandé Urbani pour Harvard. Ce n’était pas encore le moment où cette méfiance jamais ouvertement avouée pour les positions théoriques de l’un et de l’autre est apparue entre eux. Pour ne parler que de la restauration, Brandi, qui concentre sa réflexion sur la restitution esthétique d’œuvres individuelles. Urbani, qui historicise la position de Brandi pour s’ouvrir à la question essentielle du destin de l’art du passé et de son rapport à l’environnement, indissoluble en Italie.
La seule rupture que je connaisse entre Giovanni et Brandi n’est pas due à une différence de positions intellectuelles, mais à un petit désaccord de nature banale, vite dépassé par son insignifiance. L’affection et l’estime qui les liaient ont duré toute leur vie. Il est vrai, cependant, que Brandi, facile à vivre et charmant dans la conversation et les livres de voyage, est devenu, du moins de mon point de vue, abstrait et théorique dans sa critique d’art.
Un jugement, le vôtre, qui n’est pas isolé si Giorgio Manganelli - m’a dit Urbani lui-même en souriant - avait transformé deux néologismes philosophiques de Brandi, “l’attante” et “l’astanza”, en... “l’attante qui pleure dans la nuit”: l’attante qui pleure dans l’abstance". À la fin du printemps 1957, tu es partie pour l’Amérique.
Nous sommes partis en bateau, l’Independence, parce que c’était le voyage pour lequel Harvard nous payait. Pendant les sept jours qu’a duré le voyage, nous avons cimenté l’amitié qui, plus tard, nous a rendus inséparables, John et moi. C’était un beau voyage. Très amusant. Nous avions rencontré deux Américaines que nous avons courtisées avec des blagues, des croix, des rires. C’était la plénitude de l’existence d’une jeunesse tardive, mais aussi l’oubli des situations personnelles difficiles que nous avions tous deux laissées derrière nous en Italie.
Le crépuscule de la “belle journée” de votre " blessé à mort" ?
Peut-être l’espoir qu’un autre “beau jour” pourrait commencer en Amérique. Le pays de la liberté. Le pays alors lointain du mélange de glamour, de jazz, de gangsters et de tout ce que nous avions imaginé exister là-bas à partir de leurs films et de leurs romans. Ceux que le fascisme nous avait empêchés de lire, les écrivains promus par Ford Madox Ford, Hemingway par exemple, et les autres dont nous avions eu un aperçu dansAmericana de Vittorini: Scott Fitzgerald, Saroyan, Steinbeck ou John Fante, jusqu’aux plus jeunes, comme Truman Capote, qui était venu à Rome entre 1952 et 1953 pour tourner des films et avait vécu quelques mois près de chez moi, via Margutta. La même via Margutta que la dernière maison de Giovanni.
Les films et les romans d’Urbani me parlent encore quarante ans après les avoir vus et lus. Les Gangsters, qui développe et invente une fin à la très courte, mystérieuse et belle nouvelle d’Hemingway, Les Tueurs. Ou encore Le Grand Sommeil, la traduction cinématographique du roman de Chandler avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, qu’il a vu à Capri, m’a-t-il dit, un soir d’été dans un cinéma en plein air pour soldats américains convalescents. Mais qu’avez-vous fait une fois que vous avez terminé le séminaire international de Harvard, où vous avez été en contact direct avec les personnages les plus divers. De Henry Kissinger, qui l’a dirigé et que, comme vous l’écrivez, Urbani “avait charmé par ses manières”, à Lee Strasberg, Allen Tate et même Joseph McCarthy ?
Nous nous sommes arrêtés à New York. Un ami de mon ami Bill Weaver nous avait donné son appartement. C’était au cœur d’un été particulièrement caniculaire. Il faisait une chaleur insupportable. Avec John, nous avons parcouru les rues nichées entre les gratte-ciel qui scintillaient avec leurs façades de verre miroir. Jour après jour, nous découvrions les musées, l’architecture, les parcs d’une ville merveilleuse, alors dominée, dans sa partie intellectuelle, par la frénésie et l’énergie de la recherche de nouveaux horizons pour les arts figuratifs: l’Action Painting, mais c’était déjà l’époque de ce New Dada proche du Pop Art.


De retour en Italie, en 1961, vous avez reçu la Strega pour Ferito a morte (Blessé à mort ) et, comme vous le racontez dans L’estro quotidiano, lorsque le vote de la victoire est arrivé, “c’est Giovanni qui m’a soulevé comme on le fait avec les champions”. Trois ans plus tôt, en 1958, Urbani était au contraire directeur des beaux-arts du tout nouveau festival de Spoleto, où il organisa une exposition pionnière - Prima Selezione di Giovani Artisti Italiani e Americani (Première sélection de jeunes artistes italiens et américains ) - confirmant toutefois les perplexités à l’égard de l’art contemporain qu’il exprimait dans “Il Punto”. Ne voulant pas se soumettre docilement à un nouveau à tout prix qui tend de plus en plus à s’idéologiser comme valeur esthétique, il a exclu de l’exposition une œuvre de Rauschenberg, Bed, la jugeant non pas comme une œuvre d’art, mais comme ce qu’elle est: le gadget inutile de placer un lit à la verticale, en l’éclaboussant de surcroît de couleur, au toucher, à la manière des drippings de Pollock. Il faut dire que cette décision n’a pas non plus suscité de scandale. Ce n’est que des années plus tard que les critiques, c’est-à-dire le marché, ont transformé ce lit vertical inutile en un chef-d’œuvre de l’art contemporain, aujourd’hui exposé avec grand honneur au MoMA. Cet incident met également en lumière le questionnement incompris - à l’époque et aujourd’hui - d’Urbani sur la question de savoir si la même valeur de vérité liait l’art du passé et l’art d’aujourd’hui. Une réflexion qu’il a surtout menée à partir de la pensée de Heidegger, dont il a commencé à méditer les essais dès les années 1950. Dans des traductions françaises, étant donné qu’il ne connaissait pas l’allemand et qu’à l’époque, il n’y avait qu’Être et Temps et guère plus en italien.
Je n’ai cependant jamais lu Heidegger. Le problème de John était son attrait invincible pour les idées abstraites, les théories, la haute pensée. Hegel était aussi son cheval de bataille. Il citait souvent de mémoire des passages de l’Esthétique pour tenter de me faire taire dans nos amusantes querelles sur l’art et la littérature. Le fait est que Giovanni avait un respect disproportionné pour l’intelligence. Et cela le bloquait. C’est devenu pour lui une sorte de prison intellectuelle. Cela lui faisait écrire des choses brillantes, sophistiquées, brillantes, mais en deçà de ce qu’il était. Je suis sûr que Giovanni avait en lui un autre Giovanni qui pensait avec le même bon sens que moi, mais qu’il considérait comme inférieur aux études qu’il faisait. Et à mon avis, il avait tort, car son insécurité par rapport aux modèles intellectuels qu’il avait choisis l’a empêché d’écrire comme il aurait pu le faire. Mais c’est mon point de vue. Peut-être que pour vous les choses ne se passent pas ainsi.
Je pense plutôt que vous avez raison. Il n’en reste pas moins que sa conférence de 1960, intitulée de manière significative La part du hasard dans l’art d’aujourd’hui, est l’une des méditations les plus profondes, les plus convaincantes et les plus raffinées sur le problème de l’art contemporain que l’on ait connues à ce jour. “Un petit chef-d’œuvre”, comme l’a dit Giorgio Agamben.
Je m’en souviens. Il a donné cette conférence à la Galerie nationale d’art moderne, à Rome. Qu’est-ce que je peux vous dire ? Sur le fait qu’il y a de l’aléatoire dans l’art contemporain, Giovanni a peut-être mis dans le mille. Mais il s’agit tout de même d’un pari. Et il est intéressant qu’il ait ensuite construit une théorie sur ce pari. Dans mon livre The Fly in the Bottle, je dis moi aussi des choses risquées sur l’art d’aujourd’hui. Je n’en fais cependant pas un jugement absolu. Il s’agit de ma relation avec l’art contemporain, d’un fait personnel.
C’est peut-être un fait personnel, mais dans votre petit pamphlet rationaliste, vous avez soutenu un argument sur lequel Urbani a également beaucoup insisté, à savoir que l’art d’aujourd’hui n’est pas de l’art, mais une “réflexion critique sur l’art”, c’est-à-dire une critique d’art. Parlant de la Merda d’artista (Merde d’artiste ) moqueuse de Piero Manzoni, vous écrivez: “ces déviations du sens commun ont toutes plus à voir avec des concepts fragiles et périssables qu’avec des œuvres, et quand les concepts meurent, les œuvres restent”. J’en conclus donc qu’il ne vous reste qu’une boîte de conserve.
L’art contemporain est une imitation de l’art. Il repose sur des concepts qui se maintiennent tant qu’ils sont vivants: comme s’il y avait une foi qui naissait à ce moment-là autour d’une œuvre. Plus ou moins rapidement, cependant, ces concepts périssent et, en fin de compte, toutes ces œuvres redeviennent des objets qui ne représentent banalement qu’eux-mêmes. Je crois que ce sont également les considérations qui ont motivé la décision de Giovanni de ne pas exposer le lit de Rauschenberg à Spoleto.
Comment les interventions toujours à contre-courant d’Urbani sur l’art contemporain ont-elles été accueillies ? Par exemple, il a critiqué seul l’exposition de sculptures contemporaines dans une ville que son ami Giovanni Carandente avait organisée à Spolète pour le Festival de 1962. Première du genre, elle fut immédiatement approuvée à l’unanimité. Urbani, en revanche, y voit un signe avant-coureur du danger que, au nom d’un “nouveau” idéologique et éphémère, les valeurs historiques et environnementales forgées au fil des millénaires soient effacées des villes. Un signe avant-coureur du danger que cela se produise sans qu’une réflexion réfléchie sur la signification de la présence du passé dans notre monde n’ait été menée au préalable. C’est ainsi qu’il a prévu, il y a près d’un demi-siècle, ce qui se passe aujourd’hui, non seulement chez nous, mais dans le monde entier: l’“effet domino” d’un nouveau de plus en plus banal et laid qui chasse les formes vénérables de l’ancien.
De Spoleto, je ne me souviens de rien de particulier, même si ce que vous dites semble malheureusement très vrai. En ce qui concerne les articles de Giovanni sur l’art contemporain, il faut tenir compte du fait qu’il s’agissait d’années où l’on n’était pas à la mode si l’on ne parlait pas de la “mort de l’art”. C’étaient les années de l’avant-garde permanente, où tout le monde fondait des “groupes”, indépendamment de son inclination ou de son aversion pour les nouveaux mouvements artistiques. Dans ce contexte, les essais et articles de Giovanni donnaient l’impression d’être en phase avec ces idées. Mais d’en parler de manière plus sophistiquée. Une sophistication destinée à un petit nombre. Je crois cependant que dans les doutes de Giovanni sur le sens de l’art d’aujourd’hui, comme il le disait, “l’art que tout le monde peut faire”, il y avait quelque chose de mystique. Celui qui croit en Dieu ne l’a pas trouvé. Celui qui sent son absence croit en lui. Tel était, à mon avis, le concept au cœur de la réflexion de John sur l’art.
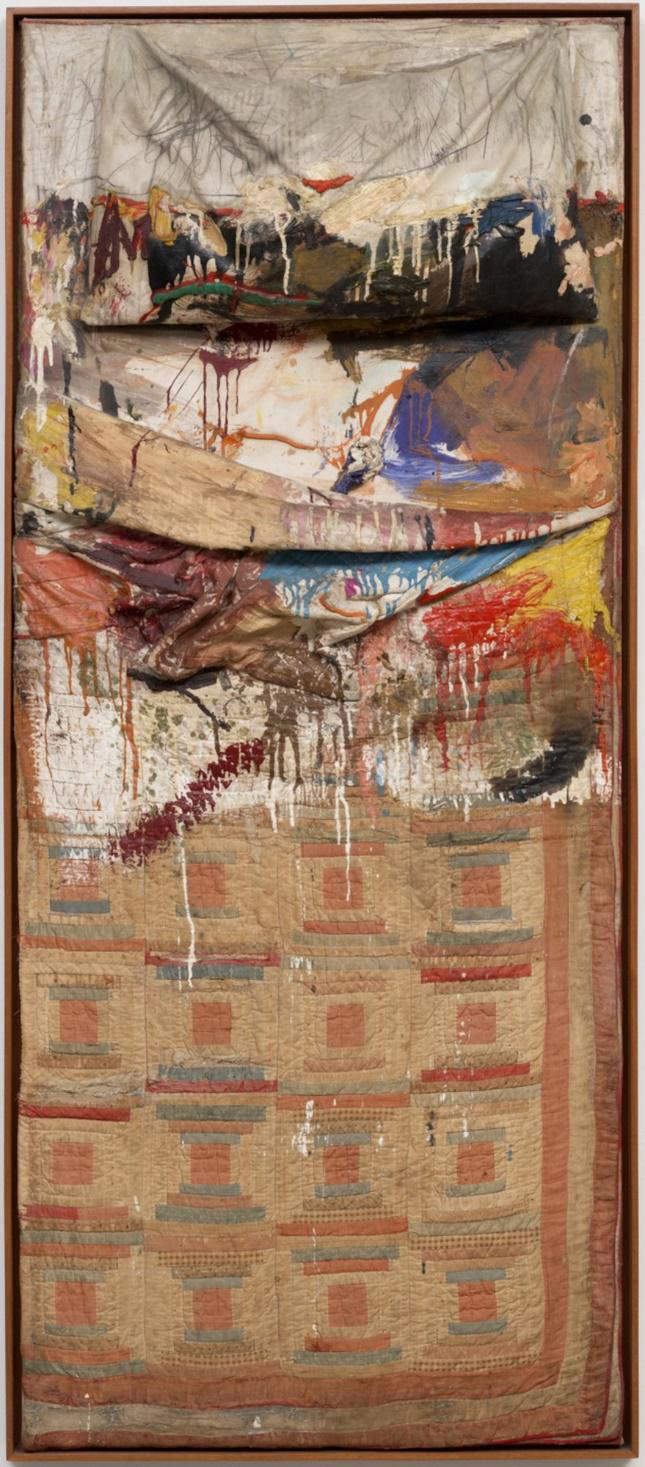


Mais Urbani n’a jamais parlé de la mort de l’art, qui était pour lui, avec Heidegger, “la mise en acte de la vérité”. Il s’est plutôt demandé, toujours avec Heidegger, si ce type particulier d’“expérience vécue” au sens esthétique qu’est l’art contemporain n’est pas “l’élément dans lequel l’art est en train de mourir”. Comme en témoigne son insistance de plus en plus hystérique - aidée et encouragée par le marché et les critiques - à devenir un critique de lui-même, se livrant à des “provocations” répétitives et excessives. Art inutile. De la pure décoration.
Bien sûr, la vérité de l’art contemporain n’est pas la vérité éternelle des Bronzes de Riace ou de la Chapelle Sixtine. C’est une vérité périssable. La vérité du moment. Mais l’impulsion est là, sinon il n’y aurait pas d’art. Et nous revenons à l’attrait invincible de Jean pour la pensée abstraite. Ce qui rendait ses textes toujours très complexes. Mais je dis que son écriture était aussi involuée. Et elle était involuée parce que parfois il s’emmêlait dans les périodes et les pensées comme un chat dans une pelote de laine. Quand il écrivait, il avait ce défaut, à mon avis. Mais elle ne voulait pas en entendre parler, rejetant sur les autres la responsabilité des difficultés à suivre ses pensées. Il était comme ça avec moi aussi. Quand nous parlions philosophie, il le faisait avec une supériorité souriante. De moi, il pensait que je pouvais être placé dans le secteur des personnes intéressantes du point de vue de l’authenticité, aussi intéressantes que quelqu’un qui vous dit que “le roi est nu”. C’était un défi entre nous, un défi affectueux et souriant dans lequel il jouait Don Quichotte et moi Sancho Panza.
Peut-être plus qu’involontaires, les textes d’Urbani étaient exigeants. Ils exigeaient de ceux qui les lisaient une forte prise de responsabilité face à leurs devoirs civiques, face au devoir de se préparer très sérieusement aux problèmes que le destin nous impose d’affronter. Cependant, nous nous sommes trop concentrés sur Urbani en tant que critique de l’art d’aujourd’hui, c’est-à-dire sur ce qui n’était qu’une étape de son parcours vers la conservation de l’art du passé. Un parcours qui, en simplifiant, peut être divisé en trois étapes.
Il est tout à fait vrai que Giovanni était un homme très exigeant. Qu’il faisait tout avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Et qu’il exigeait des autres la même rigueur, ou du moins qu’il l’attendait. Mais je vous ai interrompu. Vous me parliez des trois étapes du cheminement intellectuel de Giovanni vers la préservation de l’art du passé. Quelles sont ces étapes, selon vous ?
La première va de son entrée à l’Icr en 1945 jusqu’à l’époque de votre voyage en Amérique. Au cours de cette dizaine d’années, il a constaté la grande labilité - critique et conservatrice - des interventions de restauration, à commencer par celles menées par l’Icr, alors au plus haut niveau possible. À tel point que dans un essai de 1967 que je considère comme un autre de ses “petits chefs-d’œuvre”, Il restauro e la storia dell’arte, il demande: “Alors, pourrions-nous encore prétendre que nous ne restaurons pas comme nous avons toujours restauré: c’est-à-dire en altérant ou en trafiquant ? Le second passage s’étend approximativement du milieu des années 1950 à la décennie suivante et coïncide avec sa réflexion sur le sens de l’art d’aujourd’hui par rapport à celui du passé. Il conclut que le premier n’a pas de véritable continuité avec le second. D’où la préservation de l’art du passé comme destin de l’homme d’aujourd’hui. La troisième et dernière étape est franchie avec l’inondation de Florence en 1966. À la suite de cette grave catastrophe, il élabore un grand projet d’organisation pour la conservation du patrimoine historique, artistique et culturel en relation avec l’environnement. D’une part, l’invention d’une technique inédite - évidemment technique au sens heideggérien - à laquelle il donne le nom de ”conservation programmée“. D’autre part, la fondation d’une ”écologie culturelle“ qui reconnaît le patrimoine artistique comme ”une composante environnementale anthropique tout aussi nécessaire au bien-être de l’espèce que l’équilibre écologique entre les composantes environnementales naturelles".
Giovanni était vraiment un homme singulier. Très raffiné et compliqué dans ses théories, infiniment pragmatique et ponctuel dans la résolution des problèmes techniques et organisationnels. D’ailleurs, “ce sont les contradictions, parfois insoutenables et souvent incompatibles, mais toujours irrésistibles, qui ont constitué la véritable originalité de Giovanni, qui ne s’est jamais enfermé dans une figure bien définie par une sorte d’impatience existentielle”, comme je l’ai écrit dans L’estro quotidiano.
Je ne dirais pas qu’il y avait une contradiction entre ces deux visages d’Urbani. Le trait d’union était la conviction que les élaborations de la pensée devaient toujours être suivies d’indications concrètes d’application, essentielles pour permettre, comme il l’écrivait, “l’intégration matérielle du passé dans le devenir de l’homme”. Il est vrai, cependant, que la figure d’Urbani ressemble à bien des égards à celle de l’“Anarque” de Jünger, l’homme “qui mène ses propres guerres même lorsqu’il marche dans les rangs d’une armée”. Seulement, sa guerre était trop supérieure aux forces de l’armée à laquelle il avait affaire. Les surintendants, qui conçoivent encore la protection comme un exercice de pouvoir du dix-neuvième siècle, en vertu d’une compétence bureaucratique, donc d’une affaire d’interdictions et de permis, et jamais en vertu d’un but, donc d’actions rationnelles et cohérentes.
C’est un véritable crime d’avoir laissé tomber le travail de Giovanni pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique. Ce qu’il avait préparé avec tant d’ardeur. De l’avoir laissé livré à lui-même, au point de lui faire prendre la décision de partir en claquant la porte. Sa démission anticipée du poste de directeur de l’Icr en 1983. Giovanni croyait fermement en l’État qu’il servait avec un zèle absolu. Mais l’État lui a rendu la pareille en le trahissant. Pour lui, la patrie était l’ensemble des œuvres d’art que nos ancêtres nous ont laissées. Il se sentait donc l’obligation et l’honneur de les défendre. C’est ainsi qu’il a conçu sa présence à l’Institut de restauration. Mais les institutions chargées de gouverner ce pays qui est le nôtre n’ont jamais reconnu l’importance et l’utilité de son travail. Son dévouement. L’histoire de Giovanni est celle de la diversité intellectuelle et morale. Ce que ses collègues percevaient comme un danger.
Mais je crois qu’il y avait aussi des raisons très concrètes d’intérêt économique. L’idée d’Urbani de faire coïncider la protection du patrimoine artistique avec la protection de l’environnement s’est inévitablement heurtée à la libre agression territoriale qui a eu lieu dans notre pays, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale. Je crois que cela a été la cause décisive de l’opposition à Urbani de la politique, en fait, toujours en faveur de la spéculation immobilière, quels que soient les partis.
J’ai écrit le scénario de La main sur la ville de Francesco Rosi en 1963, et je connais donc la logique du désastre urbain de notre pays. Le fait est qu’à l’époque, il semblait possible que, grâce à nos efforts, les choses changent. Nous étions en effet “la risée de l’histoire”, comme je l’ai écrit, mais dans un autre contexte. Et John aussi, qui pensait que notre pays comptait des personnes réellement intéressées par la conservation et le soin du patrimoine artistique et du paysage.
En fait, le retard culturel du secteur était palindromique à la défense des intérêts spéculatifs. C’est ce qui a donné lieu, en 1976, à une âpre polémique contre le “Plan pilote pour la conservation programmée du patrimoine culturel en Ombrie”, le projet d’organisation pour la protection du patrimoine artistique par rapport à l’environnement auquel Urbani avait le plus cru. Un plan qu’il avait élaboré en demandant l’aide de la recherche scientifique et technologique de l’industrie, celle de l’Eni. Une modernisation du secteur contre laquelle tous ses collègues surintendants et de nombreux professeurs d’université se sont dressés comme un seul homme. En faisant appel à l’expertise d’une structure industrielle, précisément l’Eni, dotée d’une grande capacité technique et entrepreneuriale et de réels moyens d’action, Urbani a fait peser une sérieuse menace sur l’immobilisme bureaucratique étatiste, toujours vainqueur en Italie. En fait, ce sont les surintendants et les professeurs qui ont gagné. Et le secteur est resté parfaitement immobile.
Une agression stupide et violente dont Giovanni a beaucoup souffert. Il faut dire que dans ces années-là, les figures de grands historiens de l’art, certainement capables de comprendre et d’apprécier ce qu’il faisait, étaient encore bien vivantes. Brandi était certainement capable de comprendre le projet de Giovanni. Il en allait de même pour Argan ou Zeri. Tous pouvaient comprendre la valeur et l’utilité du travail de Giovanni pour la préservation de l’art du passé. Pourquoi ne l’ont-ils pas défendu ?
Précisément parce qu’ils étaient incapables de comprendre ces projets. Peut-être que seul Brandi connaissait vraiment le travail d’Urbani. Tandis qu’Argan s’est déclaré contre le “Plan” ombrien presque certainement sans l’avoir regardé, mais en comprenant, en homme de pouvoir qu’il était, que la corporation des historiens de l’art (la sienne) serait grandement diminuée par son application. Par ailleurs, il existait entre Argan et Urbani une antipathie lointaine et invincible, d’abord liée au caractère, mais aussi probablement aux positions différentes qu’ils ont prises sur l’art contemporain entre les années 1950 et 1960. Argan, communiste, sombrement idéologique et pro-marchand. Urbani, libéral, indépendant et sûr qu’une frise dessinée au hasard sur une toile, un éléphant en papier mâché avec un drap sur la tête ou une feuille de plastique brûlée ne peuvent avoir de valeur réelle et durable: avant tout véridique, mais aussi économique. Au contraire, Zeri, à la fin de sa vie, a reconnu avec moi son erreur d’avoir sous-estimé la profondeur de la pensée d’Urbani.
Faut-il dire que Giovanni n’a été défendu par personne ? Pas même ses maîtres ? Pas même Brandi, qui l’a promu dans beaucoup de choses, mais pas dans cet aspect si important de sa créativité et de sa passion civile ? Est-ce que cela sert la mémoire de Giovanni de dire toutes ces choses ?
Je voudrais conclure ce dialogue en revenant à votre ouvrage Blessés à mort. Même d’Urbani, de la fin à jamais de sa “belle journée”, peut-on dire: “faites-en un mystère, si vous voulez, mais pas un drame” ?
Malheureusement, je crois qu’il est impossible de faire de la “belle journée” de Giovanni “un mystère et non un drame”. Comme Lord Jim, John a porté toute sa vie la tache d’une culpabilité à racheter. Une tache qui était une condition de l’esprit d’un homme d’honneur, ce qu’il était avant tout, et qui prenait de temps en temps la forme du chagrin pour son fils unique mort enfant, de son snobisme, de l’échec de son travail assidu et passionné et de je ne sais quoi d’autre encore. Une tache indélébile, une ombre irréductible de son inconscient. Mais savez-vous combien il est difficile d’expliquer la vie ? Comme il est difficile d’expliquer le gâchis insensé de l’homme merveilleux qu’était Jean ? “Dón Gió/vanni/ Búrlador/, maître à pensèr/ e grànd charmèur... comme je le lui chantais dans une comptine que j’avais inventée pour lui et que je lui fredonnais parfois en plaisantant sur l’air d’Escamillo, le ”Toreador" de Carmen...
(octobre 2008)
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.