Simple, impersonnel, silencieux, voire évident. Pourtant, derrière le titre sans titre de nombreuses œuvres d’art - la plupart, car le titrage est une invention assez récente - flotte l’étendard d’une quête qui s’est fièrement affranchie de la domination des mots, du joug de la littérature. Avec des légions de peintres qui ont renoncé au titre de leurs œuvres individuelles au nom de l’art pour l’art. Et au nom du désir d’offrir au public une œuvre ouverte aux interprétations possibles des autres. En ces années de planification programmée du produit artistique, de domination du contenu (mieux s’il est engagé) sur la forme, de flanquage (quand il ne se chevauche pas) d’experts en marketing et en communication à la figure de l’artiste, poussés et/ou contraints de marquer leur travail dans le but de l’identifier comme un produit, la pratique aseptique et ascétique de ceux - et ils furent nombreux - qui, au XXe siècle, intitulaient ce qui sortait de leur atelier d’un non-titre peut sembler une note dérangeante. Le livre de Chiara Ianeselli intitulé Sulla necessità del Senza titolo (Sur la nécessité du sans titre ) est consacré à cette bataille de l’image contre le mot qui la synthétise et la met en cage, une bataille qui a impliqué des peintres comme Mirò et Picasso, mais surtout les protagonistes de la soi-disant École de New York, et donc les auteurs de l’épopée de l’Arte Povera (1967-1971). Le silence comme langage de l’art (Postmedia, 2025, 133 pages, 16 euros).
La jeune historienne de l’art et conservatrice de Trente, actuellement en poste au Maxxi de Rome, a imprimé l’essentiel, et le meilleur, de sa thèse de doctorat (dont elle conserve également l’approche didactique et le plan) consacrée aux titres des œuvres d’art. Disons-le tout de suite, son livre se distingue par une vaste bibliographie, riche surtout en citations de non-fiction américaine, auxquelles elle a ajouté des témoignages inédits recueillis en dialogue avec les survivants de cette saison, à bien des égards, délibérément “aphone” (entretiens avec les artistes pauvres Anselmo, Paolini, Piacentino, Penone), supplantée dans les années 1980 par le retour à la peinture (Transavanguardia, Pittura colta, anacronisti) par la reprise des citations savantes et littéraires dans les titres.
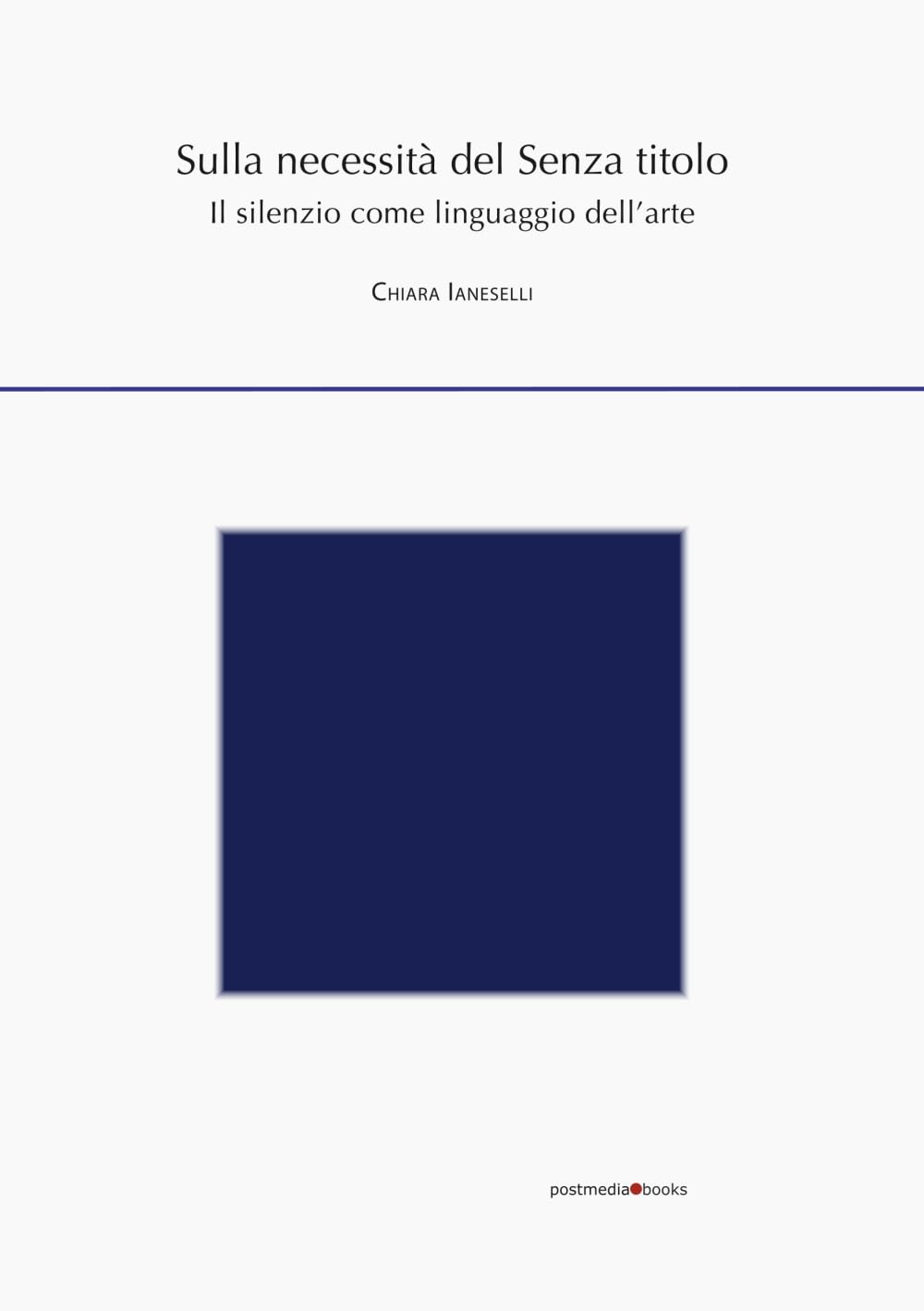
Pourtant, pendant des siècles, l’œuvre d’art s’est passée de titre. C’est le sujet, qu’il s’agisse d’une peinture réalisée pour une commande religieuse ou profane, qui définissait l’œuvre individuelle. Et le caractère générique ou universel du thème (la Vierge à l’enfant et les saints) était compensé, à des fins d’identification, par une description méticuleuse. Il suffit de se référer au livre de comptes de Lorenzo Lotto qui, le 10 février 1545, note la réception de 16 ducats comme paiement reçu pour l’intense Vesperbild, aujourd’hui à la galerie d’art de Brera, que le peintre vénitien définit exactement (mais pas succinctement) “pictura de una paleta [...] fatta per una pietà, la Vergine tramortita in brazo de San Joanne et Jesu Cristo morto nel gremio de la matre, et due anzeleti da capo e piedi sustentar el nostro signore...”. Mais le tableau populaire et mythique du Pérugin, aujourd’hui conservé au Louvre, a certainement son propre titre, Combat entre l’amour et la chasteté, grâce au fait qu’Isabelle d’Este, dans son contrat de 1503 avec le peintre pour que l’œuvre soit placée dans son Studiolo de Mantoue, a demandé, ou plutôt fait demander par Vannucci, “una batagla (sic.) de Chasteté contre Lascivia, c’est-à-dire Pallas et Diane luttant virilement contre Vénus et Cupidon”. Mais quelques années plus tard, avant sa mort en 1510, Giorgione met la main à ce qui est probablement son tableau le plus célèbre, sans laisser de signature ni de titre : La Tempête, comme l’appellera Marcantonio Michiel bien des années plus tard, en 1530, le “petit village” des “Zorzi de Castelfranco” vu dans la maison de Gabriele Vendramin, et tel que nous l’admirons aujourd’hui dans la Gallerie dell’Accademia à Venise.
L’émergence de la collection et la nécessité de dresser des inventaires des collections ont, surtout aux XIXe et XXe siècles, sous l’impulsion des marchands soucieux de disposer de produits facilement identifiables et commercialisables, fait fleurir titres et littérature autour du discours sur les (seules) images de peintres. Le titre est ainsi devenu, sous l’impulsion du symbolisme puis du surréalisme, mais aussi du futurisme, c’est-à-dire des mouvements les plus impliqués sur le plan littéraire, “un véritable nom que l’œuvre porte en elle”, note Ianeselli dans son introduction, “et qui détermine souvent l’identité et la compréhension de ce qui est représenté”. Souvent même inscrits, parfois gravés par l’artiste lui-même ou insérés dans les légendes, les titres accompagnent l’œuvre comme de véritables actes de baptême". Comment appeler le tableau de De Chirico de la collection Mattioli (Museo del Novecento) à Milan L’enigme de l’heure sinon L’enigme de l’heure, puisque le pictor optimus l’a intitulé en le laissant imprimé sur le cadre de son chef-d’œuvre métaphysique ?




Pourtant, dès le XIXe siècle, certains se sont rebellés contre la domination du mot, contre l’épitomé univoque. Ianeselli, dans une longue note à la page 36, rapporte la contrariété exprimée par James Wistler du fait qu’à son arrangement musical en gris et noir, envoyé à l’Accademia en 1872, les rédacteurs du catalogue avaient ajouté le titre original de l’artiste en ajoutant : Portrait de la mère du peintre. “Mais que peut ou doit faire le public de l’identité du portrait ?” s’interrogeait le grand peintre anglais, qui ajoutait : “Comme la musique est la poésie du son, la peinture est la poésie de la vue, et le sujet n’a rien à voir avec l’harmonie du son et de la couleur”. Les galeristes et les marchands étaient et sont toujours à la recherche d’un nom qui rendrait l’œuvre unique, facilement identifiable et commercialisable. Par exemple, dans le cas de Picasso, les légendaires Kahnweiler et Vollard, avec la rébellion conséquente, mais tardive, du Malagueño, qui déclara en 1946 qu’il ne donnait pas de nom à ses œuvres, s’en prenant “à la manie des marchands d’art” et des “critiques”, mais aussi “aux collectionneurs, pour baptiser les tableaux”.
Riche en citations des protagonistes et agréable même pour un public non expert, le livre de Ianeselli se concentre, dans l’articulation et l’argumentation du discours Sur la nécessité du sans titre, sur l’Expressionnisme abstrait et le Minimalisme made in USA, puis sur l’Arte Povera italien. Parmi les expressionnistes abstraits américains, Clyfford Still semble être le plus radical et le plus furieux dans la défense de ses peintures qui “restent sans nom, comme il se doit”, parce qu’elles “ne parlent pas de la vie” mais “mènent leur propre vie”. Après avoir reçu de Peggy Guggenheim des titres tels que Buried Sun et The Comedy of Tragic Deformation pour les tableaux exposés et mis en vente en 1946 à la galerie Art of This Century, Still, à partir de 1959, supprime tous les titres qui ne sont pas les siens pour les œuvres anciennes et cesse de nommer les nouvelles, sauf par un système de lettres et de chiffres pour les rendre reconnaissables. Le numéro est d’ailleurs le système utilisé, entre autres, par William Baziotes, Jackson Polloick et Mark Rothko qui, à partir de 1948, commence à intituler ses tableaux Untitled (près de 150 de ses œuvres portent cette définition, note avec désolation son fils Christopher en fouillant dans les archives de son père) pour ajouter les couleurs du tableau dans la décennie suivante, à partir de 1955.
L’Art pour l’Art d’Ad Reinhardt contre l’art en tant que marchandise a entraîné le choix fondamentaliste du Minimalisme américain. Avec Donald Judd, critique avant d’être sculpteur (qualification qu’il refusera obstinément), qui, en faveur d’une production déconnectée de toute référence au monde réel, déclare dans Lamentations : Part I: “I prefer art that is not associated with anything”, allant jusqu’à renommer ironiquement ses Untitled avec des définitions simples comme The Bleaches: plus que des titres, des surnoms. Dans la même veine, Robert Ryman a déclaré : "Je ne fais pas d’abstraction [...] Je ne travaille pas sur une base représentative [...] Pas de symbolisme. Pas d’illusionnisme“, allant même jusqu’à s’amuser à nommer ses tableaux d’après les marques de couleurs utilisées. ”Lorsque l’exposition de Ryman, note Ianeselli, s’intitule No Title Required, le mépris des titres atteint un point critique.



La section sans titre avec laquelle Francesco Stocchi n’a (pas) intitulé la section dont il était le commissaire, mais que les artistes ont interprétée, à la 18e Quadriennale d’arte nazionale di Roma qui se déroule actuellement au Palazzo delle Esposizioni, a une longue histoire derrière elle. Celle-ci passe aussi par l’expérience de l’Arte Povera de Germano Celant et d’artistes comme Giovanni Anselmo et Jannis Kounellis qui ont systématiquement utilisé le Sans titre - en italique, car donné par l’auteur et à distinguer du même titre.l’auteur et à distinguer de la même définition employée par les conservateurs et les éditeurs devant des œuvres non nommées - tandis qu’Alighero Boetti recourait à la tautologie en énumérant des matériaux(Pietre e plate di metallo, 1968). Alors qu’un doc poverista comme Giuseppe Penone titrait plutôt ses sculptures : J’ai continué à utiliser le titre pour orienter la lecture de l’œuvre“, explique l’artiste à Chiara Ianeselli en 2020, ”et pour faire comprendre que l’œuvre n’est pas seulement une recherche formelle, mais qu’il y a une pensée, une idée qui est identifiée par le titre, comme Respirare l’ombra (Respirer l’ombre)". En 1969, dans Arte povera, Germano Celant, le théoricien et l’âme de ce courant de l’art italien, avait au contraire été clair sur la poétique de l’artiste de l’Arte povera, le poverista idéal : “Ses œuvres sont souvent sans titre, presque comme s’il voulait établir un certificat physico-mnémonique de l’expérience, et non une analyse ou un développement ultérieur d’une expérience”. En effet, les paladins de la néo-avant-garde de Celant ne partageaient pas toujours la marque de fabrique de Pistoletto. C’est ainsi que les choses nues et brutes de la terre et de l’industrie ont trouvé un nom évocateur qui les a rendues mystérieuses, mythiques, mémorables.
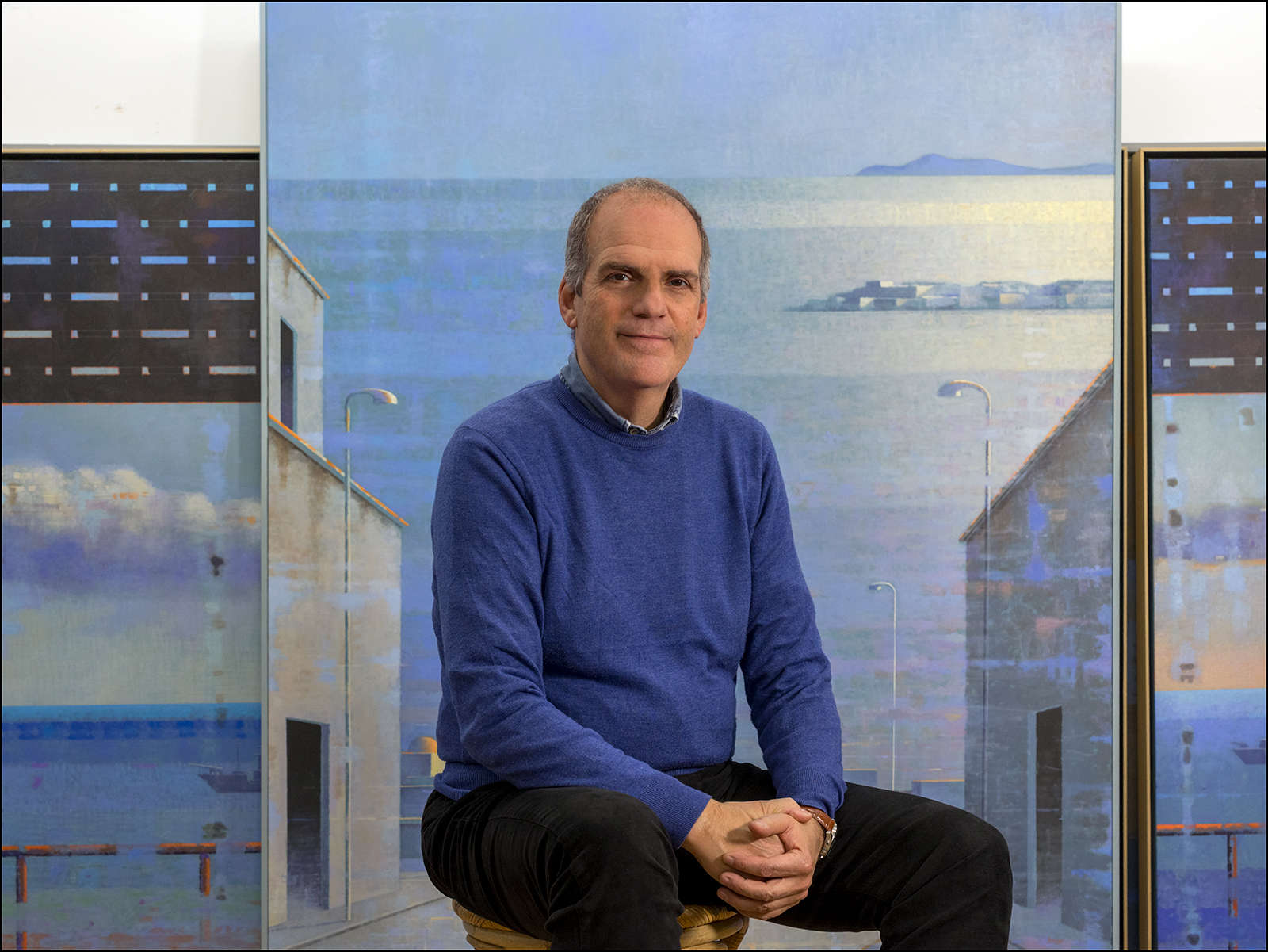
L'auteur de cet article: Carlo Alberto Bucci
Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.