Cela peut paraître étrange, mais trente ans se sont écoulés depuis que Nicolas Bourriaud, c’était en 1996, a commencé à établir les contours de sa formule à succès “art relationnel”, et jusqu’à aujourd’hui personne, avant l’exposition qui envahit le premier étage du MAXXI à Rome jusqu’au 1er mars(1+1. L’arte relazionale), personne n’avait jamais consacré à l’art relationnel une revue qui prenne en compte l’ensemble du parcours des pratiques identifiées par Bourriaud et ramenées par lui sous la définition, certes assez large, d’un art “qui assume comme horizon théorique le domaine des interactions humaines et son contexte social, plutôt que l’affirmation d’un espace symbolique indépendant et privé” (ainsi dans son livre Relational Aesthetics de 1998). Bien sûr, on pourrait contester à Bourriaud (comme cela a d’ailleurs été fait) que l’art a toujours été relationnel, dans le sens où une œuvre d’art, sauf dans des cas très rares et en tout cas non pertinents, présuppose toujours au moins une relation entre le producteur et l’observateur (mais même en imaginant un artiste produisant pour lui-même, l’œuvre d’art ne peut pas se passer d’une relation avec un contexte) : mais là n’est pas la question, puisque Bourriaud lui-même en est conscient et que son cri de guerre est en fait plus circonscrit qu’on pourrait le croire, et concerne les œuvres qui élèvent la relation et la rencontre entre l’observateur et l’image au rang de plénitude.rencontre entre l’observateur et l’image comme point d’appui de leur signification, celles qui entendent délibérément faire émerger, et parfois même orienter et conditionner, un espace de rencontre entre ses destinataires, ou celles qui, au contraire, naissent ou se développent à partir d’une relation entre des êtres humains, ou entre des êtres humains et l’objet. Voulant suivre le filtrage des appareils qui accompagnent le public dans les salles du MAXXI, les artistes relationnels ont commencé à considérer l’objet comme l’élément unique de quelque chose de plus grand, et la création comme un moment qui dépasse le processus de l’atelier et se poursuit lorsque l’objet est placé devant un public.
L’exposition présente tous les exemples des trois cas rudimentaires mentionnés ci-dessus. Dans le premier cas, nous sommes encore au niveau de la relation spectateur-objet, mais cette relation suppose la présence d’un participant actif qui devient la matière même de l’œuvre, car sans cette relation, l’objet ne resterait qu’une matière inerte : C’est le cas de Love Drug de Carsten Höller, un petit flacon que l’on tient entre deux doigts mais qui déclenche l’une des expériences physiques les plus intenses que l’on puisse vivre à l’intérieur d’un musée et probablement même à l’extérieur, et qui accompagnera le visiteur tout au long de l’exposition et au-delà. Le flacon contient un composé chimique à base de phényléthylamine, souvent associé à des états d’euphorie et de bonheur (on l’appelle “la molécule de l’amour”), et Höller invite à le sentir (l’odeur est extrêmement piquante, et elle persiste) afin de faire passer la relation avec l’objet du niveau esthétique au niveau physiologique. Et peut-être aussi pour s’amuser à voir l’effet qu’il produit sur les autres visiteurs. Dans le second cas, on peut évoquer Gillian Wearing et son projet Signs that say what you want them to say and not signs that say what someone else wants you to say, un titre long mais qui s’explique de lui-même : l’artiste britannique a photographié, entre 1992 et 1993, des centaines de personnes à qui elle a demandé de tenir une pancarte sur laquelle était inscrite l’une de leurs pensées. Le résultat est une galerie d’images parfois légères et joyeuses, tout aussi souvent touchantes, inquiétantes, dérangeantes : l’œuvre, pourrait-on dire, naît d’une rencontre entre l’artiste et ses sujets et se développe dans la rencontre ultérieure entre les sujets et le destinataire. Enfin, pour trouver un exemple d’œuvre qui naît d’une relation entre l’homme et l’objet, on ne peut s’empêcher de penser aux célèbres œuvres Candy de Felix Gonzalez-Torres (Un coin de Baci est exposé) sans l’action du public qui, en prenant un bonbon ou un chocolat, charge l’œuvre de son sens.






L’intuition la plus heureuse de Bourriaud est peut-être celle d’avoir attribué, d’ailleurs de manière empirique, un poids sans précédent à la relation, qui pourrait même être considérée comme une dimension de l’œuvre d’art : Si les futuristes ont conquis une quatrième dimension (le mouvement) et les spatialistes une cinquième (le temps), il n’est peut-être pas absurde de penser que les artistes relationnels sont parvenus à la sixième (la relation, justement). Bourriaud a compris que, arrivé à un certain moment de l’histoire de l’art, l’objet ne jouissait plus d’une condition d’autosuffisance : si un tableau existe sans le spectateur, les œuvres des artistes relationnels n’ont lieu que si une interaction est donnée. Les œuvres de Cattelan (exposées, par exemple, une photographie de l’action Untitled de 1999, dans laquelle l’artiste a attaché son galeriste Massimo De Carlo à un mur) n’auraient aucun sens si elles étaient privées de la réaction du public, qui fait partie intégrante du processus créatif. Sans l’aliénation qu’il provoque dans le public, l’arbre de Noël de Philippe Parreno ne serait qu’une décoration. Sans son espace intérieur surprenant, le bosquet d’Opavivará, l’une des œuvres créées pour cette exposition, ne serait qu’un amas de plantes hors contexte. Il est naturel, à ce stade, de constater qu’il existe depuis les dadaïstes des pratiques artistiques fondées sur la relation comme élément de l’œuvre : les happenings, l’Internationale Situationniste, tout ce qui relève de la performance. Bourriaud a voulu placer son art relationnel au bout de la ligne qui unit toutes ces expériences, en identifiant les artistes actifs au tournant du siècle comme un “groupe de personnes qui, pour la première fois depuis l’apparition de l’art conceptuel au milieu des années 60, ne s’est nourri d’aucune réinterprétation de tel ou tel mouvement esthétique du passé”.L’art conceptuel est un art de la relation et de la compréhension de l’intersubjectivité et de l’interaction, non pas comme un “gadget théorique à la mode” ni comme un “additif (alibi) à une pratique artistique traditionnelle”, mais comme “les principaux informateurs” de l’activité des artistes que l’on peut identifier comme relationnels. C’est-à-dire des artistes qui se déplacent dans “l’espace d’interaction” et qui produisent “des éléments spatio-temporels relationnels, des expériences interhumaines qui tentent de se libérer (dans un certain sens) du carcan de l’idéologie de la communication de masse, des lieux où s’élaborent des formes alternatives de socialité, des modèles critiques et des moments de convivialité construite” (ainsi dans Esthétique Relationnelle). En bref : l’idée est que, alors que dans les pratiques artistiques précédentes, il y avait encore une frontière claire entre l’artiste et le public, dans l’Esthétique Relationnelle, l’artiste devient une sorte de facilitateur (sur les modes de production, Bourriaud reviendra plus tard avec un autre de ses titres à succès, Postproduction: il suffit ici de rappeler que pour le critique français, l’art, de ce point de vue, est un “banc d’assemblage de la réalité”). Bourriaud, en substance, a conçu un art qui se pose en producteur de nouveaux liens sociaux, en créateur d’espaces de convivialité, de micro-utopies (bien que l’objectif ne soit pas d’imaginer des mondes alternatifs, mais plutôt de proposer des modèles d’action pour ce que Bourriaud appelle le réel existant afin d’apprendre à mieux l’habiter). En ce sens, l’œuvre d’art est donc pour lui à comprendre comme un “interstice social”, le terme “interstice” étant emprunté à Marx qui l’utilisait pour désigner des communautés marchandes capables d’échapper au contexte économique capitaliste (troc, formes de production autarciques, etc.) : De même, pour Bourriaud, le travail relationnel est un espace de relations humaines qui s’insère “plus ou moins harmonieusement et ouvertement dans le système global, mais suggère des possibilités d’échanges autres que celles qui s’y déroulent effectivement”.Il s’agit de “créer des espaces de liberté et des intervalles de temps dont le rythme contraste avec ceux qui structurent la vie quotidienne, et favorise un échange interhumain différent des ”zones de communication“ qui nous sont imposées”. Quelques autres exemples de l’exposition : la célèbre action Untitled 1990 de Rirkrit Tiravanija, qui, dans une galerie d’art new-yorkaise, a préparé et servi aux visiteurs un plat typique de Thaïlande, son pays d’origine. Une autre action, My Audience, de Christian Jankowski, qui, depuis 2003, n’a cessé de photographier le public qui assiste à ses conférences avec l’intention de sonder, et d’une certaine manière de renverser, la dynamique qui se crée entre l’orateur et le public lors de ces occasions. Ou encore le Confessionarium transparent d’Alicia Framis : un confessionnal où l’aveu des péchés a lieu devant tous ceux qui traversent l’exposition et devient, comme nous l’indique le panneau dans la salle, une métaphore du besoin de vérité et de dépassement des hypocrisies du pouvoir religieux.
Il ne s’agit pas ici de mesurer la portée, la cohérence, la finesse et l’originalité des idées de Bourriaud, qui, bien que largement populaires aujourd’hui, ont également suscité des débats et ont inévitablement reçu d’importantes réponses critiques. Il convient toutefois d’en mentionner quelques-unes : Claire Bishop, par exemple, s’est demandé dans quelle mesure la “structure” d’une œuvre relationnelle peut être détachée de l’objet apparent de l’œuvre ou dans quelle mesure elle peut être perméable à son contexte, et dans quelle mesure la relation produite par une œuvre d’art peut être mesurable (“la qualité des relations dans l’esthétique relationnelle”n’est jamais examinée ou questionnée“, car le dialogue et l’échange sont supposés être intrinsèquement bons alors que, selon Bishop, l’antagonisme devrait être la clé pour repenser notre relation au monde et aux autres, car sans conflit et dissension, l’œuvre risque d’être superficielle ou complaisante). Grant Kester, quant à lui, a accusé Bourriaud de confondre la dimension esthétique de l’art avec la dimension politique, car, selon lui, l’aspect le plus problématique du discours de l’art relationnel est sa résignation substantielle, évidente lorsque les expériences des artistes relationnels restent déconnectées de la réalité.L’aspect le plus problématique du discours de l’art relationnel est, selon lui, sa grande résignation, qui se manifeste lorsque les expériences des artistes relationnels restent déconnectées de tout changement concret ou de toute praxis politique réelle (”le résultat“, écrit Kester, ”est un quiétisme paralysant qui sépare de manière décisive cette connaissance préfigurative-générative de tout lien avec la praxis ici et maintenant“). L’œuvre continuerait donc à agir sur un plan esthétique, ou tout au plus symbolique, sans se traduire par une action concrète, par une remise en cause structurelle. On pourrait alors contester l’idée d’un art relationnel qui ne réinterprète pas les mouvements du passé, alors qu’il est difficile de ne pas le percevoir comme l’enfant de tout ce qui l’a précédé. On pourrait contester l’interchangeabilité du terme ”relationnel“ (certains ont parlé d’art ”interactif“ ou ”participatif" pour décrire sensiblement les mêmes expériences, critique d’ailleurs contestée par Bourriaud lui-même dans le catalogue : pour lui, la participation est un des instruments de la relation, mais elle n’est pas le sujet de l’art relationnel). Ce n’est cependant pas le lieu de vérifier la validité des hypothèses de Bourriaud : on pourrait cependant se limiter à au moins un aspect qui est également utile pour évaluer l’exposition. En d’autres termes, on pourrait contester, d’une part, l’autoréférence d’une grande partie de l’art relationnel et, d’autre part, surtout, le fait qu’une grande partie de l’art relationnel naît et se développe au sein d’un système officiel qui est lui-même autoréférentiel, fermé et clos. Le fait que l’art relationnel soit lui-même autoréférentiel, fermé, détaché du monde, permet de conclure que l’art relationnel n’a pas tout ce potentiel de changement qui pourrait lui être attribué dans l’abstrait (ou, si c’est le cas, peut-être s’agit-il d’un potentiel médiatisé). L’universalité du contenu se heurte à l’élitisme du contenant.
Bien sûr, personne n’interdit d’imaginer le musée comme un laboratoire, et il n’est pas non plus intelligent de penser que l’humanité entière devrait passer par un musée ou une galerie où se déroule une performance relationnelle : le potentiel d’une œuvre participative est avant tout indirect, il réside dans sa capacité à filtrer vers l’extérieur à travers des formes de médiation plus ou moins larges (architecture, activisme, cinéma, urbanisme, politique elle-même). Matteo Innocenti en donne un exemple très pertinent dans sa critique de l’exposition publiée sur le blog Antinomie: l’œuvre A Needle Woman de Kimsooja, que le public découvre à l’ouverture du MAXXI (l’artiste coréenne, entre 1999 et 2001, a voyagé à Tokyo, Delhi, Le Caire et Lagos et a commencé à se faire filmer en restant immobile au milieu des foules qui passaient à côté d’elle) est mise en parallèle avec l’action d’un jeune homme qui se fait passer pour un homme et qui se fait passer pour un homme. mise en parallèle avec l’action d’un jeune chorégraphe turc, Erdem Gündüz, dont la manifestation de l’homme debout , entre 2013 et 2014, est devenue un symbole de dissidence contre le gouvernement d’Erdoğan. Il n’est pas non plus contesté qu’une œuvre ou une exposition peut changer le monde à petite échelle, peut-être par deux personnes seulement : l’objectif n’est pas d’assurer des conversions de masse pour le public, mais de fournir des outils. Cependant, on ne peut même pas sous-estimer le risque d’avoir entre les mains des objets qui ne parlent qu’à ceux qui sont déjà bien informés, et l’exposition du MAXXI, à certains égards, ne semble pas ignorer cette orientation, du moins dans sa construction de base, sa structure. Par ailleurs, 1+1. Relational Art est présentée comme une “rétrospective”, un autre terme problématique qui est souvent utilisé pour tout classer. Dans l’introduction du catalogue, Francesco Stocchi la présente comme une exposition qui “propose une investigation complète sur l’origine, le développement et l’évolution de l’art relationnel, entremêlant des œuvres des années 1990 avec des recherches d’une génération ultérieure, étendant le champ d’investigation au-delà de l’horizon eurocentrique qui a caractérisé ses premières formulations théoriques”. Cependant, il manque une perspective historique appropriée : se per chi ha una certa conoscenza dell’argomento è facile individuare una ancorché minima struttura all’interno del percorso immaginato da Bourriaud, sebbene la linearità della costruzione venga spesso sacrificata, anche in ragione d’uno spazio che non lascia grossi margini di manovra (ecco allora che prima vengono tutti i “pères fondateurs”, appelons-les, puis les projets en cours de réalisation et leurs précurseurs, puis tous les artistes qui ont anticipé l’art relationnel, dont Maria Lai avec son Legarsi alla montagna, ici et là les œuvres les plus récentes et celles créées pour l’occasion : Le Groupe Piombino manque à l’appel, mais trouve sa place dans le catalogue), le public qui n’est pas familier avec ce qui s’est passé au cours des trente dernières années d’art contemporain risque d’être laissé à lui-même. Le visiteur est guidé par les questions des légendes (par exemple, sous Hollywood de Cattelan : “Si vous pouviez choisir un lieu pour installer une inscription célèbre et iconique avec le même esprit provocateur que l’artiste, quelle inscription et quel lieu choisiriez-vous ?”ou encore, sous VB74 de Vanessa Beecroft : “Dans le monde d’aujourd’hui, chargé d’images en haute définition, souvent montées, notre rapport aux corps en chair et en os a-t-il changé ?”). Un outil qui suscite la sympathie, mais qui, d’un autre côté, ressemble beaucoup à un manuel scolaire de collège, avec toutes les conséquences de l’affaire (une surtout : L’intention de rendre les légendes des œuvres relationnelles est tout à fait compréhensible, mais nous n’excluons pas qu’une approche plus adulte aurait permis une lecture tout aussi et peut-être même plus approfondie. D’une part, l’exposition est un outil de communication qui permet de comprendre et d’approfondir un concept, et d’autre part, elle semble presque reproduire les modalités d’interaction des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT et Gemini, qui, après avoir fini de vous expliquer un concept, vous posent des questions : la différence est qu’à l’exposition, personne n’est disposé à vous répliquer avec la même loquacité que la machine (serait-ce là le signe d’une œuvre d’art relationnelle ?). Aujourd’hui, nous nous posons beaucoup trop de questions, mais nous restons sans réponses, sans références, sans points fixes dans un monde de plus en plus fluide et difficile à comprendre : eh bien, peut-être qu’un artiste d’aujourd’hui devrait précisément combler ce vide.




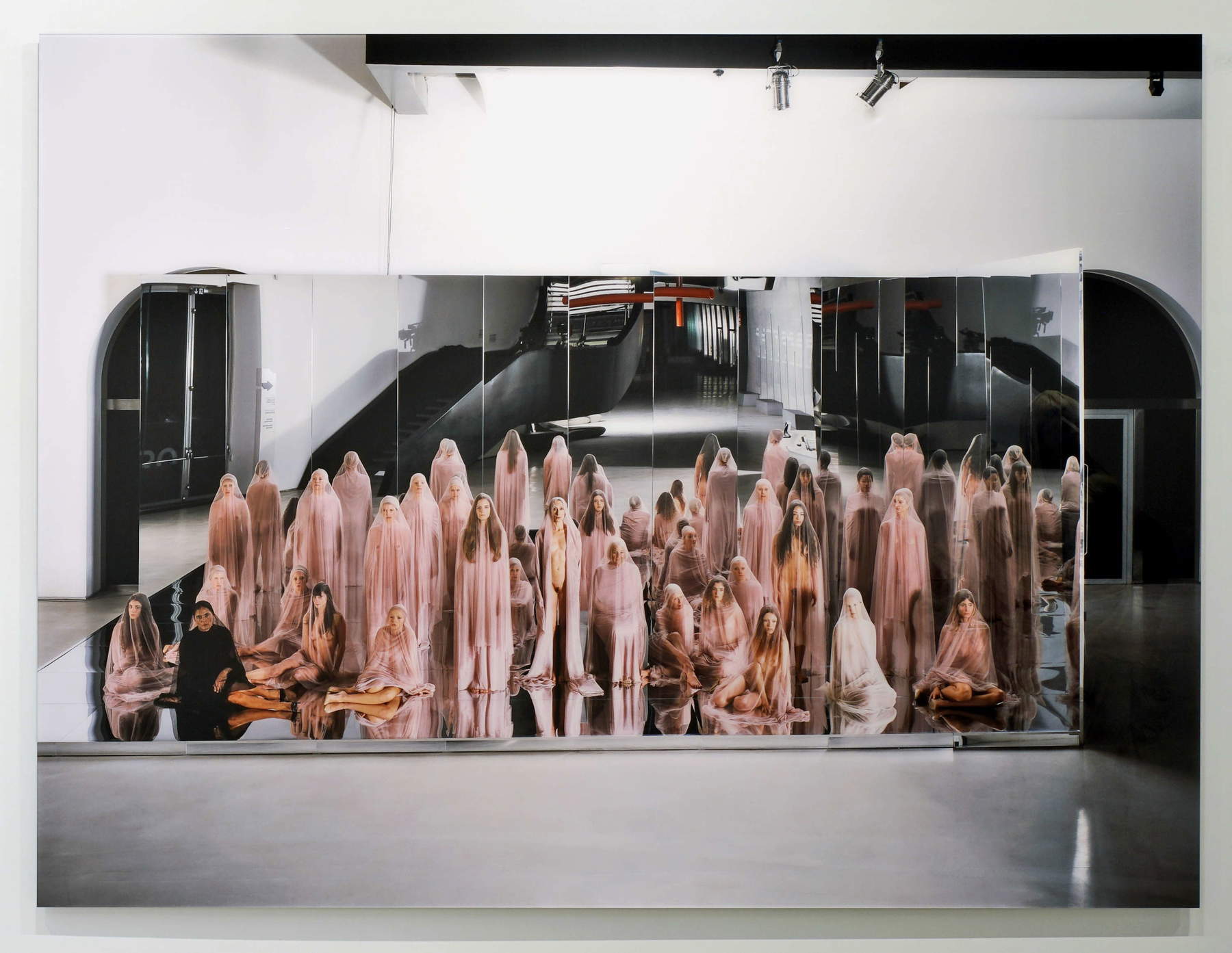

Quoi qu’il en soit, on a l’impression de visiter une exposition conçue et réalisée avant tout pour les initiés, une sorte de best of, une anthologie de ce qui s’est passé en trente ans d’art relationnel, bien qu’il y ait suffisamment de matériel dans les salles ouvertes du MAXXI pour reconstruire une chronologie structurée (une tâche qui, cependant, est encore confiée au catalogue). On pourrait diviser l’histoire de l’esthétique relationnelle de Bourriaud en au moins trois moments : un premier moment d’élaboration théorique, qui correspond grosso modo à la seconde moitié des années 1990 et dure au moins jusqu’au milieu des années 2000, voire un peu plus. Ensuite, un deuxième moment de diffusion globale, et enfin un moment de “crise de la mesure humaine”, pour reprendre l’expression du commissaire, c’est-à-dire un moment où l’être humain commence à perdre sa centralité dans le réseau de relations dans lequel les artistes se pensent et pensent les destinataires de leurs œuvres. Une période qui a commencé assez tôt (notamment avec Pierre Huyghe) et qui dure jusqu’à aujourd’hui, une période où les artistes se sont retrouvés à penser un “environnement composé de subjectivités (humaines, animales, végétales...), un écosystème dans lequel il y a un nombre important de personnes et d’objets qui sont en relation les uns avec les autres”. ), un écosystème dans lequel il n’y a que des sujets [...], fait de relations infinies" (le tournant, dans la chronologie très détaillée de Linda Motto dans le catalogue, est attribué à Soma de Carsten Höller, une œuvre de 2010 avec laquelle l’artiste allemand a construit un scénario de connexions entre les êtres humains, les animaux, les substances chimiques et biologiques). Si les premier et deuxième moments sont bien documentés dans l’exposition, puisqu’ils représentent l’essentiel du matériel rassemblé par Bourriaud, la documentation des développements plus récents est plus lacunaire : Il faut dire que, compte tenu de l’espace disponible, mais aussi de la difficulté des locaux du MAXXI, qui se prêtent mal à une exposition construite avec des outils, des méthodes et des parcours traditionnels, il est aussi très difficile d’imaginer une exposition organisée différemment. Notamment parce que le monde a changé à une vitesse peut-être plus grande que celle de l’art relationnel. Néanmoins, l’exposition reste une anthologie utile, qui résume plusieurs des moments les plus intéressants du “mouvement” défini par Bourriaud et offre au public une perspective historique d’un intérêt certain.
Les occasions de réfléchir sur le présent de l’art relationnel (de nombreux artistes continuent à produire dans le sillon tracé par Bourriaud : lui-même, dans une interview accordée à Finestre sull’Arte, a déclaré que ses idées sont toujours vivantes et plusieurs jeunes artistes se reconnaissent dans ces idées) et, surtout, sur l’impact que l’art relationnel a pu exercer, ne manqueraient pas non plus. Il serait intéressant de s’attarder sur au moins deux effets incontestables du mouvement relationnel, en réfléchissant à quelques indices dans le catalogue. Le premier est offert par Bassam El Baromi, lorsqu’il dit que l’esthétique relationnelle a été en mesure de mettre en valeur “les relations sociales, humaines et en réseau que les œuvres sont capables de produire en tant qu’horizons de possibilité, au lieu de reléguer l’art à la corrélation traditionnelle objet-sujet”. Cela ne signifie pas qu’au XXIe siècle, l’œuvre d’art ne doit plus être une peinture ou une sculpture, mais que l’art peut également être compris comme un processus dynamique qui implique des communautés, même si ce n’est que pour une courte durée.Une grande partie de l’art contemporain est orientée vers des processus qui favorisent la participation, l’invasion de l’espace public et la transformation des lieux d’art eux-mêmes en ateliers.
Le deuxième indice provient de l’essai de Sara Arrenhuis : “Un aspect de la pratique de l’esthétique relationnelle dans l’art contemporain qui ressort aujourd’hui, rétrospectivement, est qu’elle préfigure et anticipe la marchandisation de l’interaction sociale qui domine notre culture actuelle”. Il s’agit d’un sujet extrêmement actuel, même si, au cours de l’exposition, il reste presque ignoré, ou du moins n’apparaît pas aussi clairement. De nombreux artistes relationnels semblent presque avoir prévu l’arrivée d’une époque qui a transformé toute relation en un produit, mesurable et soumis à la logique du profit : le meilleur exemple et le plus clair est celui des réseaux sociaux, qui façonnent la façon dont nous observons la réalité de manière de plus en plus invasive, et qui font du profit non seulement sur nos interactions sociales, mais aussi sur notre superficialité, nos angoisses, nos peurs, et le contenu que nous consommons par le biais des plates-formes. Non seulement cela, mais les artistes relationnels ont compris bien à l’avance que la valeur se déplacerait des choses vers les relations, des objets vers les contacts. Le problème est que tous ceux qui détiennent et exercent le potentiel de transformer les interactions entre les êtres humains en produits commercialisables, avec les résultats que nous connaissons aujourd’hui, l’ont également compris. La sociabilité planifiée de Tiravanija, qui consistait à inviter des inconnus à dîner dans un musée dans les années 1990, était un geste de rupture ; aujourd’hui, c’est le mécanisme de base de tant de plateformes qui s’appuient sur la marchandisation des relations. Et s’il y a trente ans, les artistes essayaient d’envahir les interstices, aujourd’hui l’espace de ces interstices s’est considérablement réduit. Le défi d’un art, relationnel ou autre, qui nous incite à réfléchir à la qualité de nos interactions, qui exprime un désaccord, qui offre des formes de résistance, est beaucoup plus difficile à relever que ceux auxquels les artistes relationnels étaient confrontés il y a trente ans.

L'auteur de cet article: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.